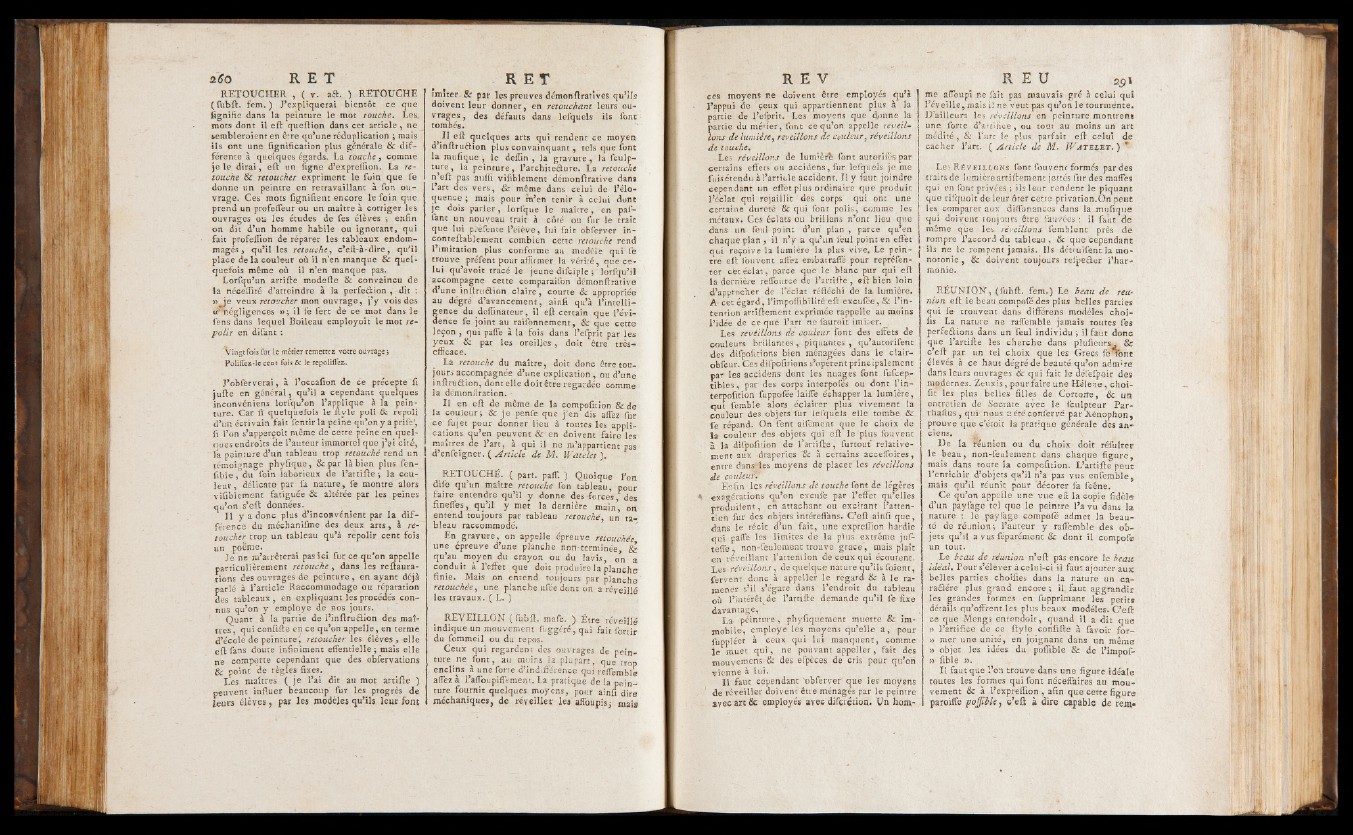
RETOUCHER , ( v . aft. ) RETOUCHE
(fubft. fem. ) J’expliquerai bientôt ce que
lignifie dans la peinture le mot touche. Les.
mots dont il eft queftion dans cet artic le, ne
sembleroient en être qu’ une réduplicatiort ; mais
ils ont une lignification plus générale & différente
à quelques égards. La touche 3 comme
je le dirai, eft un ligne d’ expreïfion. La retouche
& retoucher expriment le foin que fe
donne un peintre en retravaillant à fon ouvrage.
Ces mots lignifient encore le foin que
prend un profelfeur ou un maître à corriger les
ouvrages ou les études de fes élèves \ enfin
on dit d’ un homme habile ou ignorant, qui
fait profelïion de réparer les tableaux endommagés
, qu’ il les retouche, c’eft-à-dire, qu’ il
place de la couleur où il n’en manque 8c quelquefois
même où il n’en manque pas.
Lorfqu’ un artifte modefte & convaincu de
la néceflité d’atteindre à la perfe&ion , dit :
» J e veux retoucher mon ouvrage, j’y vois des
«^négligences »; il fe fert de ce mot dans le
fens dans lequel Boileau employoit le mot repolir
en difant :
Vingt fois fur le métier remettez votre ouvrage j
Poliffez-le cent fois 5: le repolilTez.
J’obferverai, à l’occafion de ce précepte fi
jufte en général, qu’il a cependant quelques
inconvéniens lorfqu’on l’applique à la peinture.
Car fl quelquefois le ftvle poli & repoli
d’ un écrivain fait l'entirla peine qu’onyaprife',
fi l’on s’apperçoit même de cette peine en quelques
endroits de l’auteur immortel que j’?i cité,
la peinture d’un tableau trop retouché rend un
témoignage phyfique, & par là bien plus fen-
fib le , du foin laborieux de l’attifte ; la coule
u r , délicate par fa nature, fe montre alors
vifiblement fatiguée & altérée par les peines
qu’on s’eft données.
I l y a donc plus d’ inconvénient par la différence
du méchanifine des deux arts, à retoucher
trop un tableau qu’à repolir cent fois
un poème.
Je ne m’arrêterai pas ic i fur ce qu’on appelle
particulièrement retouche., dans les reftaura-
tions des ouvragés de peinture , en ayant déjà
parlé à l’article Raccommodage ou réparation
des tableaux , en expliquant les procédés connus
qu’on y employé de nos jours.
Quant à la partie de l’ inftru&ion des maîtres,
qui confifte en ce qu’on-appelle, en terme
d’ école de peinture^ retoucher les élèves , elle
e f t fans doute infiniment effentielle ; mais elle
ne comporte cependant que des obfervations
& point de règles fixes.
Les maîtres ( je l’ai dit au mot artifte )
peuvent influer beaucoup fur les progrès de
leurs élève s, par les modèles qu’ ils leur font
imiter, 8c par lçs preuves démonftratîves qu’ ils
doivent leur donner, en retouchant leurs ouvrages
, des défauts dans lefquels ils font
tombés.
Il eft quelques arts qui rendent ce moyen
d inftruétion plus convainquant, tels que font
la mufique\ le deffin , la gravure, la fculp-
ture, la peinture, l’architeélure. La retouche
n’eft pas aufli vifiblement démonftrative dans
l ’art des vers, & même dans celui de l’élo-
quence ; mais pour m’en tenir à celui dont
je dois parler, lorfque le maître, en paf-
fant un nouveau trait à côté ou fur le trait
que lui pjèfenté l’élève, lui fait obferver in-
conteftablement combien cette retouche rend
1 imitation plus conforme au modèle qui le
trouve préfent pour affirmer la vérité, que c e lui
qu’avoit tracé le jeune difçiple -, lorfqu’ il
accompagne cette comparaifon démonftrative
d’ une inftru&ion cla ire, courte 8c appropriée
au dégré d’avancement, ainfi qu’ à l’intelligence
du deflinateur, il eft certain que l’évidence
fe joint au raisonnement, & que cette
leçon , qui paffe à la fois dans l’ efprit par les
yeux & par les oreilles , doit être très-
efficace.
La retouche du maître, doit donc être tou*
jours accompagnée d’ une explication , ou d’une
inftruâion, dont elle doit être regardée comme
la démoniîration. •
I l en eft de même de la compofition & d e
la couleuri & je penfe que j’en dis affez fur
ce fujet pour donner lieu à toutes les applications
qu’en peuvent & en doivent faire les
maîtres de l’ art, à qui il ne m’appartient pas
d’enfeigner. ( Article de M. Watelet ).
RETOUCHÉ. ( part. paff. ) Quoique Ton
dife qu’ un maître retouche fon tableau, pour
faire entendre qu’ il y donne des forces, des
fineffes, qu’il y met la dernière main, on
entend toujours par tableau retouché, un tableau
raccommodé.
En gravure, on appelle épreuve retouchée
une épreuve d’ une planche non-terminée &
qu’au moyen du crayon ou du lavis, on a
conduit à l’effet que doit produire la planche
finie. Mais on entend toujours par planche
retouchée, une planche ufée dont ôn a réveillé
les travaux. ( L. )
REVEILLON ( iubft. mafe. ) Être réveillé
indique un mouvement fuggéré., qui fait fortir
du fommeil ou du repos.
Ceux qui regardent des ouvrages de peinture
ne font, au moins la plupart, que trop
enclins à une forte d’ in différence qui reffemblë
affez à l’ affoupiffement. La pratique de la peinture
fournit quelques moyens, pour ainfi dire
méchaniques, de réveiller les'affoupisj mai»
ces moyens ne doivent être employés qu’à
l ’appui de ceux qui appartiennent plus à la
partie de l’ efprit. Les moyens que donne la
partie du métier, font ce qu’ on appelle reveillons
de lumière, reveillons de couleur, réveillons
de touche.
Les réveillons de lumière font autorifés par
certains effets ou accidèns, fur lefquels je me
fuis étendu à l’article accident. Il y faut joindre
cependant un effet plus ordinaire que produit
l ’éclat qui rejaillit des corps qui ont une
certaine dureté & qui font polis, comme les
métaux. Ces éclats ou brillans n’ont lieu que
dans un feul point d’un plan, parce qu’ en
chaque plan, il n’ y a qu’ un feul point en effet ,
qui reçoive la lumière la plus vive. Le pein- j
tre eft fouvent affez embarraffé pour repréfen-
ter cët éclat, parce que le blanc pur qui eft
la dernière reffource de l’ artifte, eft bien loin
d’approcher de le clat réfléchi de la, lumière.
A cet égard, l’ impoflibiliréeft exeufée, & Tin-
tenrion artiftement exprimée rappelle au moins
l ’ idée de ce que l’art ne fauroit imiter. ,
Les revèillons de couleur font des effets de
couleurs brillantes, piquantes , qu’ autorifent
des difpofitions bien ménagées dans le clair-
obfcur. Ces difpofitions s’opèrent principalement
par les accidèns dont les nuages font fufeep-
tibles, par des corps interpolés ou dont l’ in-
terpofition fuppôfée laiffe échapper la lumière,
qui femblë alors éclairer plus vivement la
couleur des objets fur lefquels elle tombe &
fe répand. On fent aifémént que le choix de
la couleur des objets qui eft le plus fouvent
à la difpofition de l ’artifte, furtout relativement
aux draperies ~8c à certains acceffoires,
entre dansTes moyens de placer les réveillons
de couleur.-
Enfin les réveillons de touche font de légères
exagérations qu’on exeufe par l’ effet qu’elles
produilënt, en attachant ou excitant l’attention
fur des objets intéreffans. C’eft ainfi que,
élans le récit d’un fait, une expreffion hardie
qui paffe les limites de la plus extrême juf-
teffe, non-feulement trouve grâce, mais plaît
en réveillant l'attention de ceux qui écoutent.
Les réveillons, de quelque nature qu’ils foient,
fervent donc à appeller le regard 8c à le ramener
s’ il s’égare dans l’endroit du tableau
où l’ intérêt de l’artifte demande qu’ il fe fixe
davantage,
La- peinture, phyfiquement muette & immobile,
employé les moyens qu’elle a , pour
fuppléer à ceux qui lui manquent, comme
le muet q u i, ne pouvant appeller, fait des
mouvemens & des efpèces de cris pour qu’on
vienne à lui.
I l faut cependant ''obferver' que les moyens
de réveiller doivent être ménagés par lé peintre
a y e c a r t& employés avec diferétion. Un homme
affoupî ne fait pas mauvais gré à celui qui
l’éveille, niais il ne veut pas qu’on le tourmente.
D’ailleurs les réveillons en peinture montrent
une forte d’artifice, ou tout au moins un art
médité, & l ’art le plus parfait eft celui de
cacher l’art. ( Article de M. JVa t e ie t . ) *
Les Réveillons font fouvent formés par des
traits de lumière artiftement jettés fur des maffes
qui en font privées ; ils leur rendent le piquant
que rifquoit de leur ôter cette privation.On peut
les comparer aux diffonances dans la .mufique
qui doivent toujours être fauvées : il faut de
même que les. réveillons femblent près de
rompre l’accord du tableau, & que cependant
ils ne le rompent jamais. Ils détruifont la monotonie
, & doivent toujours refpe&er i’har-
monie.
RÉUNION, (fubft. fem.) Le beau de reunion
eft le beau compofédes plus belles parties
qui fe trouvent dans différens modèles choi-
fis La nature ne raffemble jamais toutes fes
perfections dans un feul individu -, il faut donc
que l ’artifte les cherche dans plufieurs^ &
c’eft par un tel choix que les Grecs folbnc
élevés à ce haut dégré de beauté qu’on admire
dans leurs ouvrages 8c qui fait le défefpoir des
modernes. Zeuxis,.pourfaire une Hélène, choi-
fit les plus belles filles de Cortoite, & un
entretien de Socrate avec le fculpteur Par-
rhafius , qui 'nous a été confervé par Xénophon,
prouve que c ’écoit la pratique générale des anciens.
De la réunion ou du choix doit réfulter
le beau, non-feulement dans chaque figure,
mais dans toute la compofition. L’artifte peut
l’enrichir d’objets qu’ il n’a pas vus enfemble,
mais qu’ il réunit pour ’décorer fa fcêne.
Ce qu’on appelle une' vue eft la copie fidèle
d’un payfage tel que le peintre l’a vu dans la
nature : le payfage compofe admet la beauté
de réunion-, l’auteur y raffemble des objets
qu’ il a vus féparément 8c dont il compofe
un tout.
Le beau de réunion n’eft pas encore le beau
idéal. Pour s’élever à celui-ci il faut ajouter aux
belles parties choifies dans la nature un ca-
raélére plus grand encore ; il. faut aggrandir
les grandes formes en fupprimant les petits
détails qu’offrent-les plus beaux modèles. C’ eft
ce que Mengs entendoit, quand il a dit que
! p l’artifice de ce ftyle confifte à favoir for-
! » mer une unité^ en joignant dans un même
» ob je t, les idées du pofllble & de l’impof*
» fible ».
Il faut que l’on trouve dans une figure Idéale
toutes les formes qui font néceffaires au mouvement
& à l’ expreffion , afin que cette figure
paroiffe pojfîble, c’eft à dire capable de rem