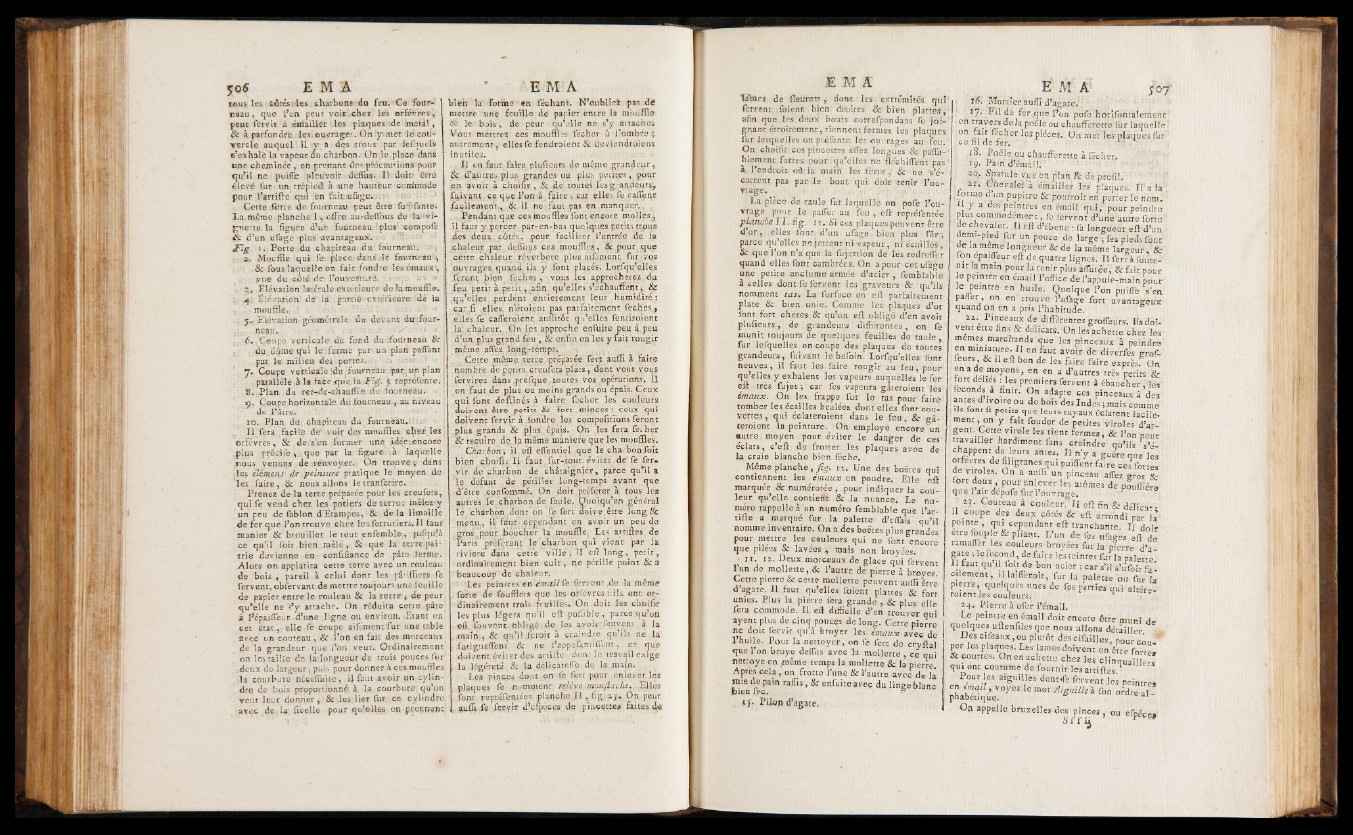
tous les côeés . les . charbons du feu. Ce fouf-
siâ'au, que l’on peut voir,chez les orfèvres',
peut fervir ‘-à «mailler ■ lès plaques .de «nôtàl,
8c à parfondrè : les. ouvrages. On!y?met le couv
erc le auquel il y a des trous: par lefquels
s’exhale la vapeur du charbon. On le place dans
une cheminée, en prenant des.précautions pour
qu’ il ne puiffe pleuvoir, defîus. I l doit» être
élevé fur un trépied; à une hauteur conimode
■ pour l’artifte qui en faitaufage.o: r
Çette forte de fourneau peut être fu^pfante»
1 b i e n l a f o rm e e n L é c h a n t . N ’ o u b l i e i p a s . d é
L a même planche I , offre: au-deffous dela-vh-
guette la figure d’.ur fourneau Iplus1 compofé
8c d’ un ufage plus avantageux. ;
tFig- i . P o r te ,du chapiteau du foumea'n. ‘
z . Mo.uffle qui fe place dani >îé fourneau ; ;
.& fous laquelle on fait fondre lés émaux , ;
yue du côté .de. .l’ouy.ei'turë. r.r;
q,. Élévation latérale eXteoieure de la.moufîl^. '
4. Élé va tion'd e'la partie extérieure dé la
• mouffle.
y. Élévation géométrale du devant dtr;four- '
nea.u..
’ 6 . [Coupe verticale du fond du:foürneau 8c ,
du dçmeq'ui le 'fermé par un plan paflant ;
par le milieu des . portes-.::: :> ;it
\ y. Coupe verticale !du •fourneau: par . u,n .plan ;
parallèle jàyla face que la Jp/g!. | repréfente. !
5. Plan du rez^de^ehaufleé du .tonrnéau.
Coupe horizontaie, du fourneau^, au hiv-eau ;
de Pâtre,.
10. Plan du; chapiteau du fourneau.; r
I l fera facile de’ voir des rmniffles chezf le s .
Orfèvres, & de,s’en former une idéeteneore
plus tprécife-, : que par la figure,- : à laquelle
nous venons de .renvoyer.: Oh trOjUve ç dans
-les élc/fiens de.peinturé pratique le moyen de
les faire, & nous allons le tranfcrire..
Prenez de la terre préparée pour les creufets,
qui fe vend chez les potie.rs déterre:; hvetez-y
un peu de fablon cfÉtampes, & ;4 e'la limaille
de fer que l’on trouve chez les;ierruri.ers. Il faut
manier & brouiller le tout; .enfembler, ;jufqu5à
ce qu’il foit bien mêléfcc & que la çerrçjpat-
trie devienne ën confiflance de pâte ferme.
Alors on applâtira cette terre ayec un rouleau
de bois , pareil à celui dont les pâtifliers -fe
fervent, obfervant de mettre toujours une feuille
de papier entre le rouleau & la terre , de peur,
qu’elle n e If y attache. On réduira cette.pâte à l’épaiffeur d’ une ligne ou environ. Etant en
cet état, elle fé coupe aifémentfur une table
avec un couteau , & l ’on en fait des morceaux
<Je la grandeur que l’on veut. Ordinairement
on les taille de la-longueur de trois pouces fiir
.deux de largeur; puis pour donner a ces mouffl.es
Ja courbure néceffaire, il faut avoir un cylindre
de bois proportionné à la courbure, qu’on
veut leur donner, & ..les, lier fur ce cylindre
avec de la ficelle pour qu’elles en prennent:
m e t t r e u n e f e u i l l e d é p a p i e r e n t r e l a m o u f f l e
f e l e 1 b o i s , d e p e u r > q u ’ e l l e n e s’ y a t t a c h e *
V o u s m e t t r e z c e s m o u f f l e s l é c h e r à l ’ o m b r e ;
a u t r e m e n t , e l l e s l é f e n d r o i e n t & d e v i e n d r a i e n t
i n u t i l e s .
I l e n f a u t f a i r e p lu f l e u r s d e m êm e g r a n d e u r ,
& d ’ a u t r e s plu s . g r a n d e s o u p lu s . p e ç i t - e s , p o u r
■ ep a v o i r à c h o i f i r , & d e t o u t e à l e s g ! ;an ,t ieu r s y
f i^ iv ^ n t c e q u e l ’ o n à , f a i r e ; c a r e l l e s fe ç a f f ç n t
f a c i l e m e n t . , ÿç, i l n e f a u t pa s e n m a n q u e r ,
P e n d a n t q u e c e s m o u f f l e s fo n t e n c o r e m o lle s ,^
i l f a u t y p e r c e r p a r - e n - b a s q u e lq u e s p e t i t s t r p u s
.d e s : d e u x . c ô t é s , p o u r f a c i l i t e r l ’ e n t r é e d e l a
j ç h a l e u r p a r d e f f o y s c e s ,m o u f f l e s , & p o u r q u e
. c e t t e c h a l e u r ; r é , y e r b e t e p lu s a i f ém e n t fu r < v o s
o u v r a g e s , qua^nà i l s y f o n t p la c é s 1:, L o r f q u ’ e l l e s
'f ç x ç tn t £>iqn f e c h é ? . , • v ç tfis M a i a p p r o c h e r e z d u
f e u p e t i t a b ê t i t , .a f in q u ’ e l l e s s’ é c h a u f f e n t j &
.q u ’ e l l e s .p e r d e n t e n t i è r e m e n t l e u r h u m i d i t é . :
c a r .fi e l l e s , n ’é t o i e n t p a s p a r f a i t em e n t f e c h ê s . ,
e l l e s fe c a f l e r q ié n t . aulTit'ô c q u ’ e l l e s f e n t i r o i e n t
l a . , c h a l e u r . O n l e s a p p r o c h e e n f u i t e p e u à p e u
d ’ u n plus, g r a n d f e u , & , e n f in o n l e s y f a i t r o u g i r
m êm e a f le z l o n g - t e m p s , .
C e t t e m ê m e , , t e r r e p r é p a r é e f e r t a u f f i à f a i r e
n o m b r e d e p e t i t s , p r e u ie t s p l a t s , d o n t v o u s .y p u s
f e r v i r e z d a n s ,n r è f q p e f pout*ës. v o s o p é r a t io n s . I l
L e i ï f a u t d e p lu s o u m o in s g r a n d s o u é p a i s . C e u x
q u i f o n t d e f t in é s à - fa i r e f é c h e r l e s c o u l e u r s
d o i v e n t ê t r e p e t i t s & f p r t . m in c e s : c e u x q u i
d o i v e n t f e r v i r à fo n d r e l e s c o m p o f i t io n s f e r o n t
p lu s g r a n d s & p lu s , é p a i s . O n ' l'e s f e r a f é c h e r
& r e c u i r e ,d e l a m êm e m a n i é r é q u e l e s m o u f f l e s .
\ C h a rb o n ; i l e f t e f t e n t î e l q u e l e c h a r b o n f o i t
b i e n c h o i f i . - I l f a u t f u r - f o u t . é v i t e r d e f e f e r *
’v i r d p 'c h a r b o n d e / c h â t a i g n i e r , p a r c e q u ’ i l a
’l e ! d é f a u t d e p e ^ E e r l o n g 7t em p s a v a n t q u e
d * ê t r é c p n lb m m ë . O n d o i t p r é f é r e r à t o u s l e s
a u t r e s , l è f c h a r b o n f a u l e . Q u o i q u ’ e n g é n é r a l
l e 'c h a r b o n .d o n t o n f e f e r t d o i v e ê t r e l o n g &
m e n u , , i l f f â p t c e p e n d a n t e h a v o i r u n p e u d e
. g r o s / p o u r É ô u c h i e r l a m o u f f l e . L e s a r t i f t e s d e
P a r i s p r é f é r e n ç l e c h a r b o n q u i v i e n t p a r l a
r i v i e r é d a n s c e t t e v i l l e ; i l e f t l o n g , p e t i t ,
P r d in a i r em é .f t t b i e n c u i r , l i e p é t i l l e p o in t & a
b e a u c o u p d e c h a l e u r .
. L e s p e in t r e s ’e n ém a il f e f e r v e n t d e l a m êm e
• f o r t e d e f ô u f f l e t s q u e l e s o r f è v r e s v i l s , o n t o r -
d in a i t - em e n t t r o i s - f e u i l i é s . O n d o i t : l e s c h o i f t r
l e s p lu s l é g e r s q u ’ i l e f t p o f f i b l e , p a r c e q u ’ o n
e f t f o u v ê n t , , bh .l.ig ? d e , l e s a v o i r ; io i^ v e n i à l a
m a in , & q u ’ i l , 'f e r o k à c r a in d r e q u ’ i l s n e l a
f a t i g u a f f é n t ' & ne l ’ a p p e f a n t i f f e n t , c e q u e
d o i v e n t é v i t e r d e s a r t iile .-; d o n : l e t r a v a i l e x i g e
l a l é g é r e t é & l a d é l i ç â t e f f e d e l a m a in .
L e s p in c e s d o n t ;o n fe . 1è r e p p u r e n l e v e r l e s
p l a q u e s l e n om p v e n t , relève-mou flaçke * E l l e s
f o n t r e p r g f e n t é e s , p l a n c h e I I , fig.- z j » O n p e u t
âu lT i f e f e r y l r d ’ e fp è c e s d e p i n c e t t e s f a i t e s d p
lifthes; de fleurets, dont les ^ extrémités quP
lérrent foienc bien droites & bien plattès,-
afin que les deux bouts correfpondans fe^ jo ignant
étroitement, tiennent fermes, les plaques
fur lesquelles on préfénte lés haïr rages au feu.
On choifii ces pincettes aflez longues & pafla- •
blement fortes pour .'qu’ elles ne flèchiflent pas 1
à l ’endroit où la main les ferre, & nè ’s’écartent
pas par le bout qui doit tenir l’ou-
f rage.
La pièce de taule fur laquelle on pofe l ’ouvrage
pour le pafîer au feu , eft repréfentée
planche I I . fi g. i i . Si ces plaques peuvent être
d’o r , , elles .font; .-d’ un ufage bien plus fêr ;
parce qu’elles ne jettent ni vapeur, ni écailles ,
8c què l ’on n’a que la fujettion de les redr-eflèr
quand elles font cambrées. On a pour cet ufage
une petite enclume armée d’acier , femblable
à celles dont fe fervent les graveurs & qu’ils
nomment tas. La furface en eft parfaitement
plate & bien unie. Comme les-plaques d’or
lont fort cheres & qu’on eft obligé d’ en avoir
plufieurs , de grandeurs différentes, on fe
munit toujours de quelques feuilles de taule,
fur lefquelles on coupe des plaques de toutes
grandeurs, fuivant le bëfoin. Lorfqu’elles font
neuves, il faut les faire rougir au feu, pour
qu’elles y exhalent les vapeurs auquelles le fer
eft très fuje t; car fes vapeurs gâteroient les
émaux. On les frappe fur le tas pour faire
tomber les écailles brûlées dont elles font couvertes
, qui éclateroient dans le feu, & 'g â teroient
la peinture. On employé encore un
autre moyen pour éviter le danger de ces-
éclats , c’eft de frotter lès plaques avec de
la craie blanche bien féche.
Même planche, fig. n . Une des boëres qui
contiennent les émaux en poudre. Elle eft
marquée & numérotée , pour, indiquer la couleur
qu’elle contient & la nuance. Le numéro
rappelle à'un numéro femblable que l’ar-
tifte a marqué fur la palette d’ eflais qu’il
nomme.inventaire. On a des boëtes plus grandes
pour mettre les Muleurs qui ne font encore
que pilées & lavées , mais non broyées.
• 11. 12. Deux morceaux de glace qui fervent
lu n de mollette, & l’autre de pierre à broyer
Cette pierre & cette mollette peuvent auffi être
d’agate. Il faut qu’elles Ibient plattes & fort
unies. Plus la pierre fêta grande , & pfos elle
fera commode. I l eft difficile d’en trouver qui
ayent plus de .cinq pouces de long. Cette pierre
ne doit fervir qu’à broyer les. émaux avec de
l ’huile. Pour la nettoyer, on fe fert de cryftal
que l’on broyé deffus avec la mollette , ce qui
nettoye en .même temps la mollette & la pierre.
Après cela, on frotte l’une & l’autre, avec de là
mie de pain raffis, & enfoiteaveç du linge blanc
piei* fec. 9 -
, 15. Pilon d’agatç,
16’. Mortiêr.auffi d’agate; -
! 17. Pii de fer .que l ’on pofè horîfonra! ornent*
en travers de la poëleou chaufferette fur laquelle.'
on fait fécher les pièces. On met les plaques fur
fc e fild e fo r . ' s , >
i chaufferette à fécher,
19. Pain d’émâii.'
i g a rn ie yué'.fen plan & de profil. ‘
i f ' 2 1 ' -émail 1er les plaques. I f a la .
:torme d un pupitre & pourrait en porter le nom.
1 y a des peintres en émail qui, pour peindre
Iplus commodémert, fefervent d’une autre forte '
•de chevalet II eft d’ébehe*: fa longueur eft d’ un
demi-pied fur un pouce de large ; fes pieds font
de la même longueur & de la même la rg eu r ,'&
fon epaiffeur eft de quatre lignes; Il fert à foute-
mr la main pour la tenir plus affûtée, &faitpour
e peintre en émail l’office de l’appuie-main pour1
le peintre en huile. Quoique‘l ’on puiffe s'en
paffer on en trouve l’ufage fort avantageux
quand on en a pris l ’habitude.
Z2*', P*nccaux de différentes groffeurs. Us doivent
erte fins & délicats. On les achette chez les
memes marchands que les pinceaux à peindra
en miniature. I l en faut avoir de diverles groffeurs
& ,1 eft bon de les faire faire exprès. On
en a de moyens, en en a d’autres très perits &
fort déliés t les premiers.fervent à ébaucher les
.féconds à finir. On adapte ces pinceaux à ’des
antes d ivoire ou de bois des Indes ; mais comme
■: ils lont 11 petits que leurs tuyaux éclatent facile,
ment, on y fait fouder de petites viroles d’argent.
Cette virole les tient fermes, & l’on peut
travailler hardiment fans craindre qu’ ils s’é- '
chappent de leurs antes. I l n’y a guère que les
orfèvres de filigranes qui puiffent faire çes fortes
de viroles. On a auffi un pinceau affez gros Sr
fort doux pour enlever les atêmes de pouffière
que l’air depofe for l’ouvragé. *r
z j . Couteau à couleur, Il eft fin & délica- •
il coupe de* deux côtes & eft arrondi par la’
pointe , qui cependant eft tranchante. Il doit
etre foup c & pliant. L’ un de fes nfages eft de
ramaffer les couleurs broyées for la pierre d’a-
gate ; lefepond, de faire les teintes for la palet-e"
Il faut qu il foit de bon acier ; car s’il s’ufoir fo’
cilement, iflaifferoit, for la palette ou for la
pierre quelques unes de fos parties qui altère-
rôient les couleurs. J 1
24. Pierre'à ufer l’émail.
Le peintre en émail doit encore être muni de
quelques uftenfiles que nous allons détailler * K
Des cifeàux, ou plutôt descifailfos, pour cou.""
per les plaques. Les lames doivent en être fohe ï
& courtes. On en achette chez les clinquaillers
qui ont coutume de fournir les artiftes
Pour les aiguillés dontffe fervent le i peintres
pbabétique!°^eZ | ^ W , ^
On appelle bruxelles des pinces , ou efpécrs
S f f i j