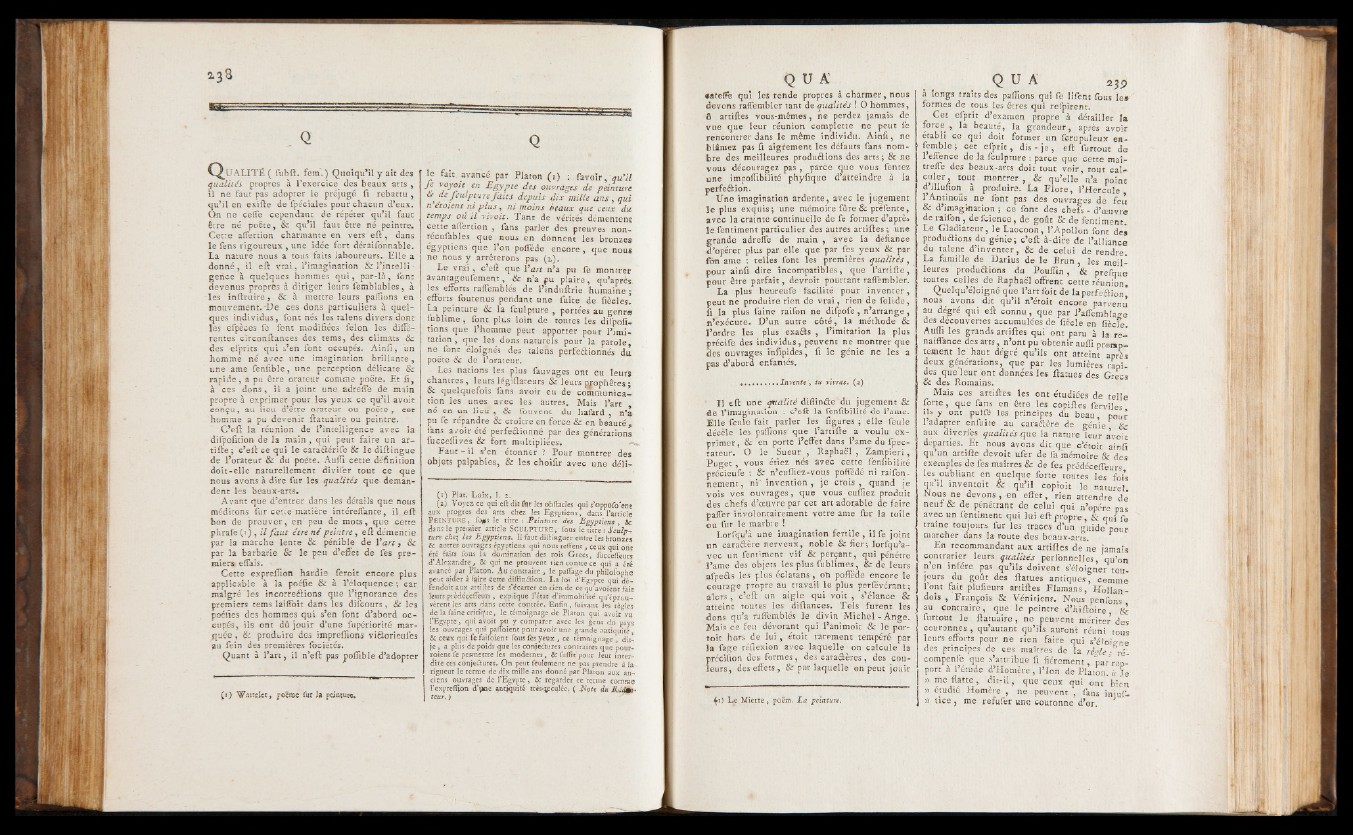
Q Q
Q u a l i t é ( fubft. fem'.) Quoiqu’ il y ait des I
qualités propres à l ’exercice des beaux arts ,
il ne faut pas adopter le préjugé fi rebattu ,
qu’ il en exifie de fpéciales pour chacun d’eux.
Qn ne ceffe cependant de répéter qu’il faut
être né poète, & qu’ il faut être né peintre.
Cette affertion charmante en vers e f t , dans
le fens rigoureux , une idée fort déraifonnable.
La nature nous a tous faits laboureurs. Elle a
donné, il eft vrai-j l’imagination & l’in te l ligence
à quelques hommes q u i, par-là, font
devenus propres à diriger leurs femblables, à
les inftruire 9 & à mettre leurs pallions en
mouvement.'De ces dons particuliers à quelques
individus, font nés les talens divers dont
les efpèces fe font modifiées félon les différentes
circonftances des tems, des climats &
des el'prits qui s’en font occupés. A in fi, un
homme né avec une imagination brillante,
une ame fenfible, une perception délicate & ,
rapide, a pu être orateur comme poète. Et fi,
à ces dons, il a joint une adreffe de main
propre à exprimer pour les yeux ce qu’il avoit
conçu, au lieu d’être orateur ou poète, cet
homme a pu devenir ftatuaire ou peintre.
C ’eft la réunion de l’ intelligence avec la
difpofition de la main , qui peut faire un ar-
tifte ; c’eft ce qui le cara&érife & le diftingue
de l’orateur & du poète. Aufïi cette définition
doit-elle naturellement divifer tout ce que
nous avons à dire fur les qualités que demandent
les beaux-arts.
Avant que d’entrer dans les détails que nous
méditons fur cette matière intéreffante, il eft
bon de prouver, en peu de mots, que cette
phrafe (? ), i l faut être né peintre, eft démentie
par la marche lente & pénible de l’art 3 &
par la barbarie & le peu d’effet de fes premier*
effais.
Cette expreffion hardie feroit encore plus
applicable à la poéfie & à l’éloquence -, car
malgré les incorre&ions que l ’ignorance des
premiers tems lâiffoit dans les difcours, & les
poéfies des hommes qui s’ en font d’abord occupés,
ils ont dû jouir d’une fupériorité marquée
, & produire des impreffions viâorieufes
au fein des premières fociétés.
Quant à l’art, il n’pft pas poffible d’adopter
le fait avancé par Platon (1) ; favoir, qu’ il
Je voyait en Egypte des ouvrages de peinture
, . f clL^Pture fu it s depuis dix mille ans , q u i
n étaient ni p lu s , ni moins beaux que ceux du
temps ou i l vivait. Tant de vérités démentent
cette affertion , fans parler des preuves non-
reçu fables que nous en donnent les bronzes
égyptiens'que l’on poffède encore, que nous
ne nous y arrêterons pas (2,).
Le v r a i, c’ eft que l’art n’ a pu fe montrer
avantageufement, & n’a pu plaire, qu’après.
les efforts raffemblés de l’ induftrte humaine ;
efforts foutenus pendant une fuite de fiècles.
La peinture &: la fculpture , portées au genre
fublime, font plus loin de toutes les difpofi-
tions que l’homme peut apporter pour l’ imitation
, que les dons naturels pour la parole,
ne font éloignés des talens perfedionnés du
poète & de l’orateur.
Les nations les plus fauvages ont eu leurs
chantres, leurs légiflateurs 8c leurs prophètes ;
& quelquefois fans avoir eu de communication
les unes avec les autres. Mais l ’art
né en un lieu , & fouvent du hafard , n’a
pu fe répandre & croître en force & en beauté,
fans avoir été perfectionné par des générations
fucceflives & fort multipliées-.
F a u t - i l s’en étonner ? Pour montrer des
objets palpables, & les choifir avec une déli-
(1) Plat.-Loix, 1. 2.
(?) Voyez ce qui eft dit fur les obftades. qui s’oppofo'enç
: aux progrès des arts chez les Egyptiens, dans l’article
P e in tu r e , fq^js le titre : Peinture des Egyptiens , 5c
dans le premier article SCULPTURE, fous le titre : Scitlp-r
ture che{ les Egyptiens. Il faut diftinguer entre les bronzes
& autres ouvrages.égyptiens qui nous reftènt ceux qui ont
été faits fous la domination des rois Grecs, fuçceffeurs
d’Alexandre, & qui ne prouvent tien contre ce qui a été
avancé par Platon. Au.contraire , le paffage du philofophe
peut aider à flaire cette diftinâion. L a loi d’Egypte qui dé-
fendoit aux attiftes de s’écarter en rien de ce qu’avoient fait
leurs prédéceffeurs , explique l’état d’immobilité qu’éprouvèrent
les arts dans cette contrée. Enfin, fuivant "les règles
de la faine critfque, le témoignage de Platon qui avoir vu
l’Egypte, qui avoit pu y comparer avec les £cns du- pays
les ouvrages qui paffoient pour avoir une grande antiquité,
& ceux qui fe faifoient fous fes yeux , ce témoignage , dis-r
j e , a plus de poids que les conjectures contraires que pour-
roient fe permettre les modernes, $ç fuffic' pour leur interdire
ces conjectures. On peut feulement ne pas prendre à la
rigueur le rerme de dix mille ans donné par Platon aux an-
Iciens ouvrages de l’Egypte, & regarder ce terme comme
l’exprçfljon d’poe antiquité très-^çqléei ( flo te du Rédjp-
(1) Wattelctf poërae fur la peinture. teur. )
«afeffs qui les rende propres â charmer, nous
devons raffembler tant de qualités ! O hommes,
ô artiftes vous-mêmes, ne perdez jamais de
vue que leur réunion complette ne peut fe
rencontrer dans le même individu. Ainfi, ne
blâmez pas fi aigrement les défauts fans nombre
des meilleures produélions des arts ; & ne
vous découragez pas , parce que vous fentez
une impoffibilïté phyfique d’atteindre à la
perfeétion.
Une imagination ardente, avec le jugement
le plus exquis; une mémoire fûre & préfente,
avec la crainte continuelle de fe former d’aprèa
le fentiment particulier des autres artiftes ; une
grande adreffe de main , avec la défiance
d’opérer plus par elle que par fes yeux & par
fem ame : telles font les premières qualités,
pour ainfi dire incompatibles, que l’arrifte,
pour être parfait, devroit pourtant raffembler.
La plus heureufe facilité pour inventer,
peut ne produire rien de v ra i, rien de folide,
fi la plus faine raifon ne difpofe , n’arrange,
n’èxécute. D’un autre côté, la méthode &
l ’ordre les plus exaéls , l’imitation la plus
précife des individus, peuvent ne montrer que
des ouvrages înfipides, fi le génie ne les a
pas d’abord enfantés.
.................Invente', tu vivras, (a)
I l eft une qualité diftinéfce du jugement &
de l’ imagination : c’eft la fenfibilité de l’ame.
Elle feule fait parler les figures ; elle feule
décèle les pallions' que l’artifte a voulu exprimer,
& en porte l’effet dans l’ame du fpec-
tateur. O le Sueur , Raphaël , Zampîeri,
P u g e t , vous étiez nés avec cette fenfibilité
précieufe : & n’eulfiez-vous pofledé ni raifon-
nement, ni" invention, je c ro is , quand je
vois vos ouvrages, que vous eulfiez produit
des chefs d’oeuvre par cet art ador.able de faire
paffer involontairement votre ame fur la toile
ou fur le marbre !
Lorfqu’à une imagination fe r tile , il fe joint
un caraélère nerveux, noble & f ie r ; lorfqu’a-
vec un fentiment v if & perçant, qui pénétre
l ’ame des objets les plus fublimes, & de leurs
afpeéts les plus éclatans, on pofféde encore le
courage propre au travail le plus perféverant;
a lors , c’eft un aigle qui voit , s’ élance &
atteint toutes les diftances. Tels furent les
dons qu’ a raffemblés le divin M ich e l-A n g e .
Mais ce feu dévorant qui l’anîmoit & le por-
toit hors de lu i , étoit rarement tempéré par
la fage réflexion avec laquelle on calcule la
précifion dès formes, des caractères , des couleurs,
des effets, & par laquelle on peut jouir
a longs traits des pallions qui fe lifent fous le»
formes de tous les êtres qui refpirent.
Cet efprit d’examen propre à détailler la
force , la beauté, la grandeur, après avoir
établi ce qui doit former un fcrupuleux en-
femble; cet efprit, d i s - j e , eft furtout de
1 effence de la fculpture : parce que cette maî-
treffe des beaux.-arts doit tout voir, tout calculer
, tout montrer , & qu’elle n’a point
d’illufion à produire. La F lo re , l ’Hercule
l’Antinous ne lônt pas des ouvrages de feu
& d’imagination ; ce font des chefs - d’oeuvre
de raifon, de fcience, de goût & de fentiment
Le Gladiateur, le Laocoon, l’Apolion font de»
produélions du génie; c’ eft'à-dire de l’alliance
du talent d’ inventer, & de celui de rendre.
La famille de Darius de le Brun, les meilleures
produélions du Pouffin, & prefque
toutes celles de Raphaël offrent cette réunion.
Quel qu’éloigné que l’art foit de laperfeftion*
nous avons dit qu’ il n’étoit encore parvenu
au degré qui eft connu, que par l’affemblage
des découvertes accumulées de fiècle en fiècle.
Audi les grands artiftes qui ont paru à la rei
naiffance des arts, n’ont pu obtenir aulîi promptement
le haut degré qu’ ils ont atteint apres
deux générations, que par les lumières rapides
que leur ont données les ftatues des Grecs
8c des Romains,
Mais ces artiftes les ont étudiées de telle
forte, que fans en être les copiftes ferviles
ils y ont puifé les principes du beau, pour
l’adapter enfuite au caraftère de génie * &
aux diverfes qualités que la nature leur a’voit
départies. Et nous avons dit que c’étoit ainfi
qu un artifte devoir ufer de fa mémoire & des
exemples de fes maîtres & de Ces prédéceffeurs
les oubliant en quelque forte toutes les fois
qu’il inventoit & qu’ il copioit le naturel
Nous ne devons, en effet, rien attendre dé
neuf & de pénétrant de celui qui n’opére pas
avec un fentiment qui lui eft propre, & qui fo
traîne toujours fur les traces d’un guide pour
marcher dans la route des beaux-arts. r
En recommandant aux artiftes de ne jamais
contrarier leurs qualités perfonnelles, qu’on
n’en infère pas qu’ ils doivent s’éloigner toujours
du goût des ftatues antiques, comme
l’ont fait plufieurs artiftes Flamans, Hollandais
, François & Vénitiens. Nous penfons
au contraire, que le peintre d’hiftoire &
furtout le ftatuaire, ne peuvent mériter des
couronnes , qu’autant qu’ ils auront réuni tous
leurs efforts pour ne rien faire qui s’éloigne
des principes de ces maîtres de la rè«le • ré-
compenfe que s’attribue fi fièrement, par rapport
à l’ étude d’Homère, l’ Ion de Platon. « Je
» me flatte, dit- il, que ceux qui ont bien
» éfud‘é Homère , ne peuvent , fans injuf-
f i ) L e Mieire, poëm. l a peinture. » t ic e , me refufer une couronne d’or.