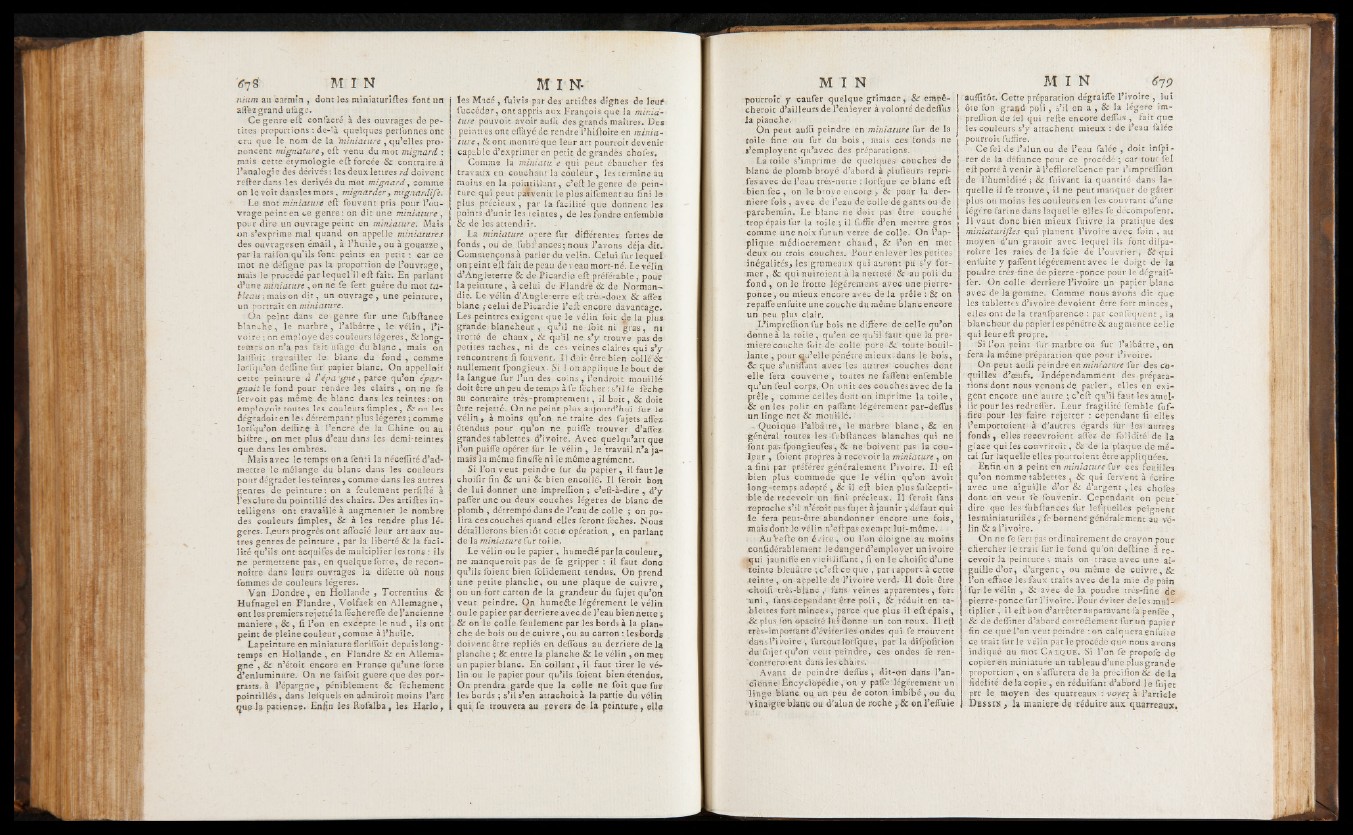
nittm au carmin , dont les miniaturises font un-
affez grand ulage.
Ce genre eft confacré à des ouvrages de petites
proportions : de-’à quelques perl’onnes ont
cru que le nom de la miniature , qu’elles prononcent
mignature y eft venu du mot mignard :
mais cette étymologie eft forcée & contraire à
l’analogie des dérivés: les deux lettres rd doivent
refter dans les dérivés du mot mignard, comme
on le voit dansles mots , mignarder, mignardife.
Le mot miniature êft fouvent pris pour l’ouvrage
peint en ce genre : on dit une miniature ,
pour dire un ouvrage peint en miniature. Mais
on s’ exprime mal quand on appelle miniatures
des ouvragesen émail, à l ’h u ile , ou à gouazze,
par la raifon qu’ ils font points en petit : car ce
mot ne déligne pas la proportion de l’ouvrage,
mais le procédé par lequel il eft fait. En parlant
d’ une miniature , on ne fe fert guère du mot tableau
■> mais on d it , un ouvrage, une peinture,
un portrait en miniature.
On peint dans ce genre fur une fubftance
blanche, le marbre, l’albâtre , le vélin , l’ ivoire
: on employé des couleurs légères, &long-
temps on n’a pas fait ulage du blanc , mais on
laiffoit travailler le blanc du fond , comme
lorfqu’ on defline fur papier blanc. On appelloit
cette peinture à Vépa g n e , parce qu’on épargnait
le fond pour rendre les clairs , on ne fe
l'ervait pas même de blanc dans les teintes : on
employoit toutes les couleurs fi triples , & on les
dégradoiten les détrempant plus légères jxomme
lorfqu’on deflir.e à l’encre de la Chine ou au
biftre , on met plus d’ eau dans les demi-teintes
que dans les ombres.
Mais avec le temps on a fenti la néceflité d’admettre
le mélange du blanc dans les couleurs
pour dégrader les teintes., comme dans les autres
genres de peinture: on a feulement perfifté à
l’exclure du pointillé des chairs. Des artiftes in-
telligens ont travaillé à augmenter le nombre
des couleurs fimples, & à les rendre plus légères.
Leurs progrès ont affocié leur art aux autres
genres de peinture , par la liberté & la facilité
qu’ ils ont acquifes de multiplier lestons : ils
ne permettent pas, en quelque forte, de recon-
noître dans leurs ouvrages la difette où nous
fouîmes de couleurs légères.
Van Dondre, en Hollande , Torrentius &
Hufnagel en Flandre, Volfaek en Allemagne,
ont les premiers rejette la féchereffe de l’ancienne
maniéré , & , fi l ’on en excepte le nud , ils ont
peint de pleine couleur, comme à l’huile.
La peinture en miniature floriffoit depuis longtemps
en Hollande , en Flandre & en Allemagne
, & n’étoit encore en France qu’une forte
d’enluminure. On ne faifoit guere que des portraits,
à l’épargne, péniblement & féchement
pointillés-, dans lefquelson admiroit moins l ’art
que la patience. Enfin les Rofalba, les H^rlo,
les Macé , fuivis par des artiftes dignes de leuf
(uccéd.er, ont appris aux François que la miniature
pouvoir avoir aufli des grands maîtres. Des
peintres ont effayé de rendre l’hiftoire en miniature
, & ont montré que leur art pourroit devenir
capable d’exprimer en petit de grandès choies.
Comme la miniatu e qui peut ébaucher fes
travaux en couchant la couleur , les termine au
moins en la pointiltent, c’eft le genre de peinture
qui peut parvenir le plus aifement au fini le
plus précieux , par la facilité que donnent les
points d’unir les teintes , de les fondre enfembla
& de les attendrir.
La miniature orere fur différentes fortes de
fonds , ou de fubfrances; nous l’avons déjà dit.
Commençons à parier du vélin. Celui fur lequel
on peint eft fait de peau de veau mort-né. Le vélin
d’Angleterre & de Picardie eft préférable , pour
la peinture, à celui do Flandre & de Normandie.
Le vélin MAngleterre eft très-doux & afl'ez
blanc ,• celui dePicardie l ’eft encore davantage.
Les peintres exigent que le vélin fait de la plus
grande blancheur, qu’ il ne - foi t ni gras, ni
trotté de chaux, & qu’il ne s’y trouve pas de
petites taches, ni de ces veines claires qui s’y
rencontrent fi fouvent. Il doit être bien colle &
nullement fpongieux. Si 1 ou applique le bout de
la langue fur l’ un des coins , l’endroit mouillé
doit être un peu de temps à fe fécher : s’ il' Ce féche
au contraire ^très-promptement, il boit, & doit
être rejette. On ne peint plus aujourd’hui fur le
vélin , à moins qu’on ne traite des fujets affez
étendus pour qu’on ne puiffe trouver d’affez
grandes tablettes d’ ivoire. Avec quelqu’art que
l’on puiffe opérer fur le vélin , le travail n’ a jamais
la même fineffe ni le même agrément.
Si l’on veut peindre fur du papier , il faut le
choifir fin & uni & bien encollé. Il lèroit bon
de lui donner une impreflion ; c’ eft-à-dire , d’y
pafferuneou deux couches légères de blanc de
plomb, détrempé dans de l ’eau de colle ; on po-»
lira ces couches quand elles feront féches. Nous
détaillerons bientôt cette opération , en parlant
de la miniature lur toile.
Le vélin ou le papier , humeété parla couleur,
ne manqueroit pas de fe gripper : il faut dons
qu’ ils foient bien folidement tendus. On prend
une petite planche, ou une plaque de cuivre,
ou un fort carton de la grandeur du fujet qu’on
veut peindre. Qn humeéte légèrement le vélin
ou le papier par derrière avec de l’eau bien nette ;
- & on le colle feulement par les bords à la planche
de bois ou de cuivre, ou au carton : les bords
doivent être repliés en deffous au derrière de la
planche ; & entre la planche & le vélin , on meç
un papier blanc. En collant, il faut tirer le vélin
ou le papier pour qu’ ils foient bien étendus.
On prendra garde que la colle ne foit que fu?
les bords ; s’ il s’en attachoicà la partie du vélin
qu^ fe trouvera au jreyers de la peinture , elle
pourroit y -caufer quelque grimace, & empê- J
cheroit d’ailleurs de l’enleyer à volonté de deffus I
la pianche.
On peut aufli peindre en miniature fur de la j
toile fine ou fur du bois, mais ces fonds ne
s’employent qu’avec des préparations.
La toile s’imprime de quelques couches de
blanc de plomb broyé d’abord à plufleurs repri-
fesavec de l’ eau très-nette : lorfque ce blanc eft
bien fec , on le broyé encore > & pour la dernière
fois , avec de l’eau dé collé de ga'nts ou de j
parchemin. Le blanc ne doit pas être couché
trop épais fur la toile $ il fuffit d’en mettre gros
comme une noix fur un verre de colle. On l’applique
médiocrement chaud, & l’on en met
deux ou trois couches. Four enlever les petites
inégalités, les grumeaux qui auront pu s’y former
, & qui nuiroient à la netteté & au poli du
fond , on le frotte légèrement avec une pierre-
ponce , ou mieux encore avec de la prêle : & on
repaffe enfuite une couche du même blanc encore
un peu plus clair.
L’ impreflion fur bois ne différé de celle qu’on
donne à la toile , qu’en ce qu’il faut que la première
couche fuit de colle pure & toute boüi'l- j
lante , pour qu’ elle pénétre mieux-dans le bois,
& que s’unifiant avec les autres couches dont
elle fera couverte, toutes ne faffent enfemble
qu’ un feul corps. On unit ces couches avec de la
prêle, comme celles dorit on. imprime la toile,
& on les polit en paffant légèrement par-deffus ;
un linge net & mouillé. |
.-Quoique l’albâtre, le marbre blanc, & en
général toutes les -fubftances blanches qui ne :
font pas fpongieufes, & ne boivent pas la couleur
, foient propres à recevoir la miniature , on
a fini par préférer généralement l’ ivoire. I l eft
bien plus Commode que le vélin qu’on avoit
long-temps adapté , 8c il eft bien plus fulcepti- -
•ble de recevoir un fini précieux. Il ferait fans
reproche s’ il n’étoit pas fujet à jaunir ; défaut qui
le fera peut-être abandonner encore une fois,
mais dont le vélin n’ eftpas exempt lui-même.
- A u ’refte On é vite-, ou l ’on éloigne au moins
confidérablement le danger d’employer un ivoire
iqui jauniffe en vieiUiffant, fi on le choific d’une
"teinte bleuâtre ; c’ eft ce que , par rapport à cette
te in te , on appelle de l’ ivoire verd. I l doit être
■ choifi très-blanc ,* fans veines apparentes , fore
u n i, fans cependant ôtl«e poli, & . réduit: ien tablettes
fort minces, parce que plus il eft épais,
■ •& plus fôn opacité lui donne un ton toux. Il eft
très-important d’éviter les ondes qui fe trouvent
dans l’ ivoire furtoutlôrfque, par la idifpofition
du fujet qu’on veut peindre, ces ondes fe ren-
contreroient dans les-fchairs.' - ■
Avant de peindre' deffus , dit-o-n dans l’ancienne:
Éncyclbpédie, on y paffe légèrement un
linge blanc ou un peu de cocon imbibé-, ou du
vinaigre blanc ou d’alun de roche , & on l’effuie
auflîtôt. Cette préparation dégraiffe l’ ivoire , lui
ôte fon grand p o li, s’ il en a , & la légère im-
prefïion de fel qui refte encore deffus , fait que
les couleurs s’y attachent mieux : de l’eau falée
pourroit fuffire.
Ce fel de l’ alun ou de l’ eau falée , doit infpi»
rer de la défiance pour ce procédé ; car tout fel
eft porté à venir à l’efflorefcence p arl’ impreflion
de l'humidité; & fuivant la quantité dans laquelle
il fe trouve , il ne peut manquer de gâter
plus ou moins les couleurs en les-convrant d’une
légère farine dans laquelle elles fe décompofenr.
Il vaut donc bien mieux fuivre la pratique des
miniaturijîes qui planent l ’ivoire avec foin . au
moyen d’un gratoir avec lequel ils font difpa-
roître les raies de la fe ie de l ’ouvrier, & qui
enfuite y paffent légèrement avec le doigt de la
poudre très-fine de pierre-ponce pour le dégrailler.
On colle derrière l’ivoire un papier blanc
avec de lagomme. Comme nous avons dit que
les tablettes d’ ivoire devaient être fort minces,
elles ont de la tranfparence : par confëquent, la
blancheur du papier les pénétre & augmente celle
qui leur eft propre.
Si l’on peint lur marbre ou fur l’albâtre, on
fera la même préparation que pour i’ i voire.
On peut aufli peindre en miniature fur des Coquilles
d’oeufs. Indépendamment des préparations
dont nous venons de parler , elles en exigent
encore une autre ; c’ eft qu’ il faut les amollir
pour les redreffer. Leur fragilité femble fuf-
fire pour les faire rejetter : cependant fi elles
l’ emportoient à d’autres égards fur les autres
fonds, elles recevraient afl’ez de fol suitede la
glace qui les couvriroit, & de la plaque de métal
fur laquelle elles pourroient être appliquées.
Enfin on a peint en miniature fur ces feuilles
qu’on nomme tablettes , & qui fervent à écrire
avec une aiguille d’or & d’argent, les chofes
dont-ton veut fe, fou venir. Cependant on peut
dire que les fubftances fur lefqdelles peignent
lesminiaturifles ^febernen't généralement au vélin
& a l’ ivoire.
On ne fe fert pas ordinairement de crayon pour
chercher le trait fur le fond qu’on deftine a recevoir
la peinture -, mais on trace, avec une aiguille
d’or, d’argent, ou même de cuivre, &
l’on efface les faux traits avec de la mie de pain
i Tut-le vélin , & avec de là poudre très-fine de
pierre-ponce fur l ’ ivoire. Pour éviter de les mu ltiplier
, il eft bon d’arrêter auparavant fa penfée,
& de de Cm et d’abord coi reftement fur un papier
fin ce que l ’on veut peindre : on calquera enfuite
ce trait furie vélin par le procédé que nous avons
indiqué au mot C alque. Si l’on fe propofe de
copier en miniature un tableau d’une plus grande
proportion , on s’affurera de la précifion 8c de la
fidélité de la copie , en réduifant d’abord le fujet
prr le moyen des quarreaux : voye% à l’ article
D essin , la maniéré de réduire aux quarreaux*