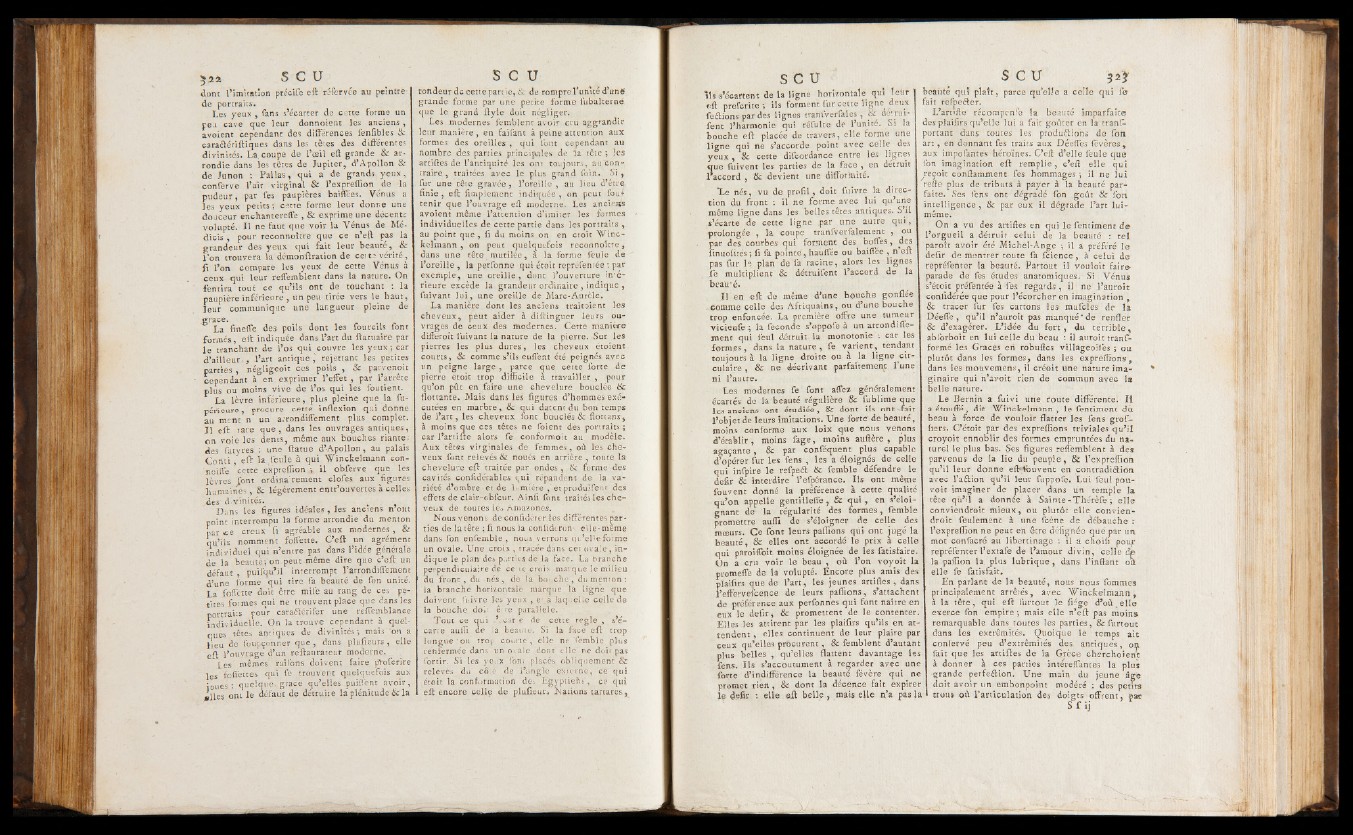
dont l’ imitation précife eft réfer vée au peintre-
de portrairs.
Les yeux , fans s’écarter de cette forme un
peu cave que leur donnoient les anciens ,
avoient cependant des différences fenfibles &
cara&ériftiques dans les têtes des différentes
divinités. La. coupe de l’oeil eft grande & arrondie
dans les têtes de Jupiter, d’Apollon &
de Junon : Pallas, qui a de grands^ y e u x ,
conferve l’ air virginal & l’ exprefîion de la
pudeur, par lés paupières baiflees. Vénus a
les yeux pecits-, cette forme leur donne une
douceur enchantereffe , & exprime une décente
volupté. Il ne faut que voir la Vénus de Mé-
dicis , pour reconnoître que ce n’eft pas la
grandeur des yeux qui fait leur beauté, &
l'on trouvera la démonftration de ceite vérité,
fi l’on compare les yeux de cette Vénus à
ceux qui leur refTemblent dans la nature. On
fentira tout ce qu’ ils ont de touchant ; la
paupière inferieure , un peu tirée vers le haut,
leur communique une langueur pleine de
grâce.
La fineffe des poils dont les fourcils font
formés, eft indiquée dans l’ art du ftatuaire par
le tranchant de l’os qui couvre les yeux*, car
d’ailleur^, l’arc antique rejettant les petites
parties , négligeoit ces poils , & parvenoit
cependant à en exprimer l ’effet , par l’arrête
plus ou moins vive de l’os qui les foutient.
La lèvre inférieure, plus pleine que la fu-
pérteure, procure cette inflexion qui donne_
au ment n un a.rondiffement plus complet.
I l eft rare q u e , dans les ouvrages antiques,
on voie les dems, même aux bouches riante;
des fatyres ; une ftatue d’*Apollon, au palais
Gonti , eft la.feule à qui Winckelmann con-
noiflé cette expreflion *, il obferve que les
lèvres Jfont ordina’rement clofes aux figures
humaines, & légèrement entr’ouvertes à celles
des' divinités.
Dans les figures idéales, les anciens n ont
point interrompu la forme arrondie du menton
par «ce creux fl agréable aux modernes, &
qu’fis nomment foffette. C’eft un agrément
individuel qui n’entre pas dans l ’ idée générale
de la beauté*, on peut-même dire que c’ eft un
défaut , puifqu’ il interrompt l’arrondiffement.
d’une forme qui tire fa beauté de fon unité.-
La foffette doit être mife au rang de ces petites
formes qui ne trouvent place que dans les
portraits pour caraétérifer une reffemblance
individuelle. On la trouve cependant à quelques
têtes antiques de divinités ; mais on a
lieu de foupçonner q u e , dans plusieurs, elle
eft l’ouvrage d’ un reftaurateur moderne.
Les mêmes rail’ons doivent faire pVofcrire
les follettes qui fe trouvent quelquefois aux
loues : quelque, grâce qu’elles puiftent avoir,
ille s ont le défaut de détruire la plénitude & la
rondeur de cette partie, de rompre l’unité d’une
grande forme par une petite forme fubalterné
que le grand ftyle doit négliger.
Les modernes femblent avoir cru agg^andir
leur manière, en faifant à peine attention aux
formes des oreilles , qui font cependant au
nombre des parties principales de la tête *, les
artiftes de l’antiquité les ont toujours, au contraire
, traitées avec le plus grand foin. S i,
fur une tête gravée, l’oreille , au lieu d’être
finie , eft Amplement indiquée , on peut foijt
tenir que l ’ouvrage eft moderne. Les anciens
avoient même l’attention d'imiter les formes
individuelles de Cette partie dans les portraits ,
au point que , fi du moins on en croit Winc-
kelmann, on peut quelquefois reconnoître,
dans une tête mutilée, à la forme feule de
l’oreille , la perfonne qui étoit représentée : par
exemple, une ore ille , dont l’ ouverture in*é-
rieure excède la grandeur ordinaire , indique ,
fuivant Jui, une oreille de Marc-Aurèle.
La manière dont les anciens traitoient les
cheveux, peut aider à diftinguer leurs ouvrages
de ceux des modernes. Cette manière
diftéroit fuivant la nature de la pierre. Sur les
pierres les plus dures, les cheveux étoient
courts, & comme s’ils euflent été peignés avec
un peigne large , parce qu§ cette forte de
pierre étoit trop difficile à travailler , pour
qu’on pût en faire une chevelure bouclée &
flottante. Mais dans les figures d’hommes exécutées
en marbre, & qui datent du Bon temps
de l’arr, les cheveux font bouclés & flottans,
à moins que ces têtes ne foient des portraits ;
car l’artifte alors fe conformoit au modèle.
Aux têtes virginales de femmes, où les cheveux
font relevés & noués en arrière , toute la
chevelure eft traitée par ondes , . & forme des
cavités confidérables qui répandent de la va-
l riété d’ombre et de lumière , et produi.fenc des
effets de clair-obfcur. Ainfi font traités les cheveux
de toutes le* Amazones.
Nous venons de confidérer.les différentes parties
de la tête ; fi nous la conlidtron' elle-même
dans fon enfemble, nous verrons qu’elle forme
un ovale. Une croix , tracée dans cet ovale , radique
le plan des parties de la face. La branche
perpendiculaire de ceue croix marque le milieu
du front, du nés , de la bouche, du menton:
la branché horizontale marque la ligne que
doivent fuivre les yeux , e r à laquelle celle de
la bouche doit è re parallèle. '
Tout ce qui A-car e de cette réglé , s’écarte
aulli de a beauté. Si la face eft trop
lo n gu e ’ou trop courte, elle ne femble plus
renfermée dans un ovale dont elle ne doit pas
fortir. Si les yeux font placés obliquement &
relevés du côté. de l’angle externe, ce qui
étoit la conformation des Egyptiehs, ce qui
eft encore celle de plufieurc Nations tartares,
Ils s’écartent de la ligne horizontale^ qui jeü f
eft preferite *, ils forment fur cette ligne deux
fe étions par des lignes traniVerfales , & détrui-
fent l’harmonie qui réfulte de l’unité. Si la
bouche eft placée de travers, elle forme une
ligne qui ne s’accorde point avec celle des
y e u x , & cette difcordance entre les lignes
que fuivent les parties de la face , en détruit
l ’accord , & devient une difformité.
Xe nés, vu de profil, doit fuivre la direction
du front : il ne forme avec lui qu’ une
même ligne dans les belles têtes antiques. S’il
s’écarte de cette ligne .par une autre q u i,
prolongée , la coupe tranfv-erfalement , ou
par des courbes qui forment des boffes, des
finuolirés; fi 1a pointé, hauffée ou baiffée , n eft
pas fur le plan de fa racine, alors les lignes
fe multiplient & détruifent l’ accord de la
beaü*é»
Il en eft de même d’une bouche gonflée
comme celle des Afriquains, ou d’ une bouche
trop enfoncée. La première offre une tumeur
vicieufe ; la fécondé s’oppofe -a un arrondiffe-
menc qui l’eul d«étruit la monotonie *. car les
formes, dans la nature, fe varient, tendant
toujours à la ligne droite ou a la ligne circulaire
, & ne décrivant parfaitement Tune
ni l ’autre.
Les modernes fe font affez généralement
beauté qui plaît, parce qu’elle a celle qui fe
fait refpeéter.
L’artifte récompenfe la beauté imparfaite
des pïaifirs qu’elle lui a fait goûter en latrans portant
écartés de la beauté régulière & fublime que ;
les anciens ont étudiée $ & dont ils ont fait ,
l ’objet de leurs imitations. Une forte de beauté, j
moins conforme aux loix que nous yenons !
d’établir, moins fage, moins auftère , plus
agaçante, & par conféquent plus capable
d’opérer fur les fens , les a éloignés de celle
qui infpire le refpeéb & femble défendre le
defir & interdire l’efpérance. Us ont même
fouvent donné la préférence à cette qualité
qu’on appelle gentilleffe, & qui , en s’éloignant
de la régularité des formes, femble
promettre aufli de s’éloigner de celle des
moeurs. Ce font leurs pallions qui ont jugé la
beauté, & elles ont accordé le prix à celle
qui paroiffoit moins éloignée de les fatisfaire.
On a cru voir le beau , où l’on voyoit la
promeffe de la volupté. Encore plus amis des
pïaifirs que de l’art, les jeunes artiftes, dans
l ’effervefcence de leurs pallions, s’attachent
de préférence aux perfonnes qui font naître en
eux le delir, & promettent de le contenter.
Elles les attifent par les pïaifirs qu’ ils en attendent
, elles continuent de leur plaire par
ceux qu’elles procurent, & femblent d’autant
plus belles , qu’elles flattent davantage les
fens. Us s’accoutument à regarder avec une
forte d’ indifférence la beauté févère qui ne
promet rien , & dont la décence fait expirer
le defir : elle eft b e lle , mais elle n,’a pas la
dans toutes les productions de fon
a r t , en donnant fes traits aux Déeffes févères,
aux impofantes héroïnes. C’ eft d’ elle feule que
l’on imagination eft remplie, c’eft elle qui
reçoit conftamment fes hommages; il ne lui
refte plus de tributs, à payer à la beauté parfaite.
Ses fens ont dégradé fon goût & fon
intelligence, & par eux il dégrade l ’art lui-
même;
On a vu des artiftes en qui le fentiment d&
l’orgueil a.détruir-celui de la beauté : tel
paroît avoir été Michel-Ange ; il a préféré le
defir de montrer toute fa fcience, à celui de
repréfenter la beauté. Partout il vouîoit faire-
parade de fes études anatomiques. Si Vénus
s’étoit préfentée à fes regards, il ne l’auroit
conlîdérée que pour l’écorcher en imagination ,
& tracer fur fes cartons les mufcles de la
: Déeffe, qu’ il n’auroit pas manqué* de renfler
& d’exagérer. L’ idée du fort , du terrible,
abforboit en lui celle du beau : il aurait transformé
les Grâces en robuftes villageoifes j ou
plutôt dans les Formes, dans les expreffrons,
dans les mouvement, il créoit une nature imaginaire
qui n’avoit rien de commun avec la
belle nature.
Le Bernin a fuivi une route différente. I l
a étouffé, dit Winckelmann , le fentiment du
beau à force de vouloir flatter les fens greffiers.
C’étoit par des expreflions triviales qu’ il
croyoit ennoblir des formes empruntées du naturel
le plus bas. Ses figures refl'emblent à des
parvenus de la lie du peuple, & l’ expreflion
qu’ il leur donne efbfcuvent en contradiction,
avec 1’aCtion qu’ il leur fuppofe. Lui feul pou-
voix imaginer de placer dans un temple la
tête qù’ il a donnée à Sainte-^Thérèfe ; elle
conviendroit mieux, ou plutôt elle convien-
droit feulement à une fcène de débauche ?
l’expreflion ne peut en être défignée que par un
mot confacré au libertinage : il a choifi pou,r
repréfenter l’extafe de l’amour divin, celle dis
la paflion la. plus lubrique, dans l’ inftant où
elle fe fatisfait.
En parlant de la beauté, nous nous fommes
principalement arrêtés, avec Winckelmann,
à la tête, qui. eft furtout le fiége d’o ù ,e lle
exerce fon empire ; mais elle n’eft pas moins
remarquable dans toutes tes parties, & furtout
dans les extrémités. Quoique le temps ait
confervé peu d’extrémités des. antiques, on
lait que les artiftes de la Grèce cherchoient
à donner à ces parties intereffantes la plus
grande perfection. Une main du jeune âge
doit avoir un embonpoint modéré ; des petits
trous où l ’articulation des doigts offrent, par
S f ij