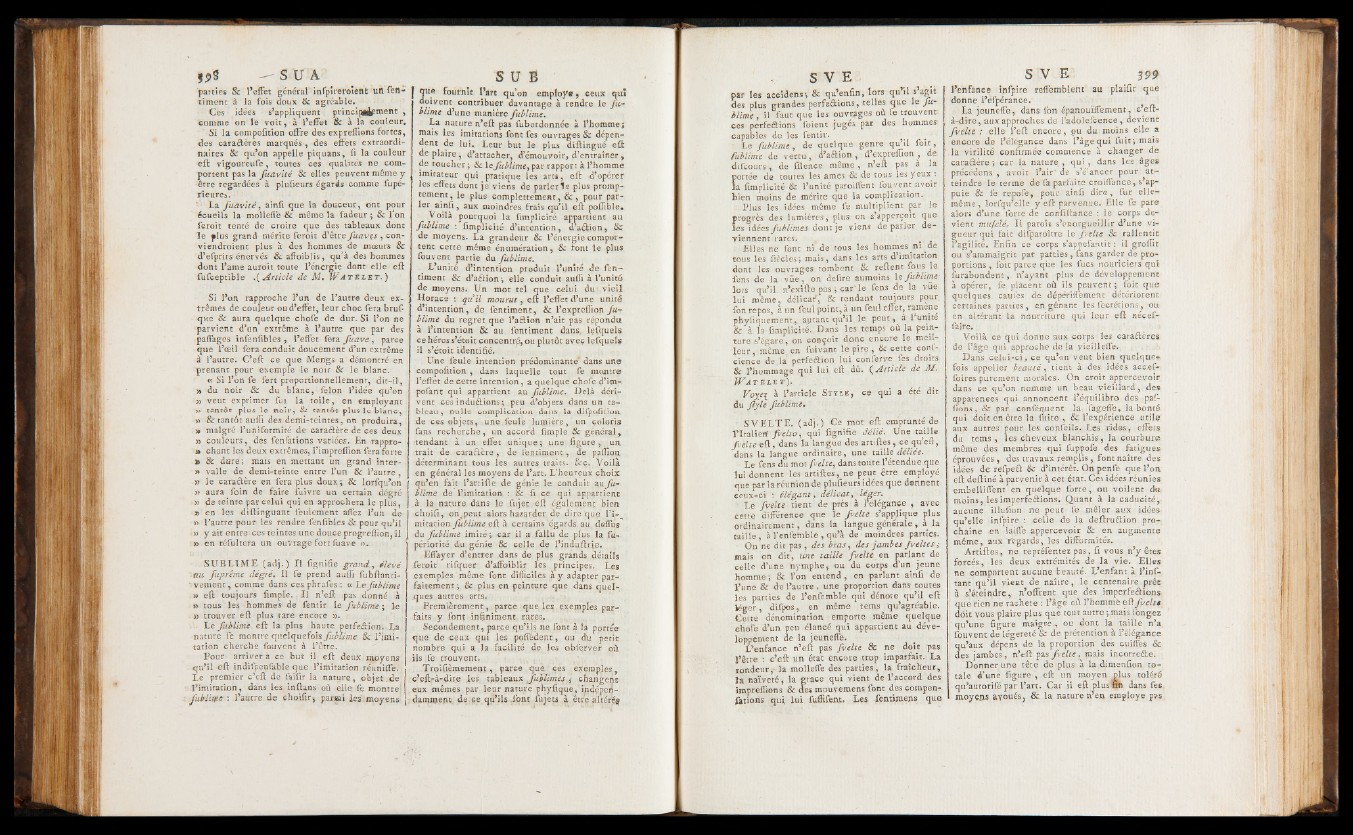
- S U A
parties & l’effet généraL infpirero'ent un fen-
timent à la fois doux & agréable.
Ces idées s’appliquent ; principiipment ,
comme on le v o it , à l’ effet & à la couleur.
‘ Si la eompofition offre des exprefîions fortes,
des c-ara&ères marqués , des effets extraordinaires
& qu’on appelle piquans, fi la couleur
eft vigoiireufe, toutes ces qualités ne comportent
pas la fu a v ité & elles peu vent même y
•être regardées à plufieurs égards comme fupé-
rieures.
La fu a v ité , ainfi que la douceur, ont pour
écueils la mollefle & même la fadeur ; & Ton
feroit tenté de croire que des tableaux dont
le plus grand mérite feroit d’être fu a v ç s , con-
viendroient plus à des hommes de moeurs &
d’efprits énervés & affoiblis, qu’à des hommes
dont l’ame auroit toute l’énergie dont elle eft
fufceptible .( A rticle de M , TVa t e l e t .)
Si l’on rapproche l’ un de l ’autre deux extrêmes
de couleur ou d’ effet, leur choc fera brul-
que & aura quelque chofe de dur. Si l’on ne
parvient d’un extrême à l’ autre que par des
partages infenfibles , l’effet fera fu a v e , parce
que l’oeil fera conduit doucement d’ un extrême
à l’autre. C’ eft ce que Mengs a démontré en
prenant pour exemple le noir & le blanc.
« Si l’on fe fert proportionnellement, d it- il,
» du noir & du blanc, félon l’ idée qu’on
» veut exprimer fui la toile, en employant
» tantôt plus le noir, & tantôt plus le blanc, ■
» & tantôt aufli des demi-teintes, on produira,
» malgré l’ uniformité de caraétère de ces deux
» couleurs, des fenfations variées. En rappro- .
» chant les deux extrêmes, l ’impreflion fera forte .
s* & dore; mais en mettant un grand inter-
» valle de demi-teinte entre l’un & l’autre,
» le caractère en fera plus doux ; & lorfqu’on
» aura foin de faire fuivre un certain degré
» de teinte par celui qui en approchera le plus,
» en les diftinguant feulement aflez l ’ un de
y> l ’autre pour les rendre fenfibles & pour qu’il
» y ait entre ces teintes une douce progreflïon, il
» en réfultera un ouvrage fort fuave ».■
S U B L IM E (ad j.) I l fignifie g r a n d , élevé
-au fuprêm e dégré. Il fe prend aufli fubftanti-
• vement, comme dans ces phrafes.: « Le fublime
» eft toujours fimple. I l n’eft pas donné à
» tous les hommes de fentir le fub lim e ; le
» trouver eft plus rare encore ».
Le fib lim e . eft la plus haute perfection. La
nature fe montre quelquefois fub lim e & l ’imitation
cherche feuvent à l ’être. ^
Pour arrivera ce but il eft deux moyens
. qu’ il eft indifpenfable que l’ imitation réunifie. I
Le premier c’eft de faifir la nature, objet.de;
l ’ imitation, dans les inftans où elle.'fe montre
fublime : l’ autre de choifirj parmi les moyens
s u B que fournît Part qu’on employé, ceux quï doivent contribuer davantage à rendre le fu -
hlimt d’une manière fublime.
La nature n’eft pas fubordonnée à l’homme*
mais les imitations font fes ouvrages & dépendent
de lui. Leur but le plus diftingué eft
d ép laire , d’attacher, d’émouvoir, d’entraînery
de toucher ; & le fublime, par rapport à l’homme
imitateur qui pratique les arts, eft d’opérer
les effets dont je'viens de parler le plus promptement,
le plus complettement, & , pour parler
ainfi, aux moindres frais qu’ il eft poflible.
voilà pourquoi la fimplicité appartient au
fublime : fimplicité d’intention, d’av io n , &
de moyens. La grandeur & l’énergie comportent
cette même énumération, & font le plus
fou vent partie du fublime.
L’ unité d’intention produit l’ ijnité de fen-
timent & d’aélion; elle conduit aufli à l’unité
de moyens. Un mot tel que celui du?,v ieil
Horace : q u il mourut, eft l’ effet d’une unité
d’ intention, de fentiment, & l’expreflion fu blime
du regret que l’aélion n’ait pas répondu
à l ’ intention & au fentiment dans, lefquels
ce héros s’étoit concentré, ou plutôt avec lefquels
il s’étoit identifié.
Une feule intention prédominante1 dans une
eompofition , dans laquelle tout fe montre
l ’effet de cette intention, a quelque chofe d’ im-,
pofant qui appartient au fublime,. Delà dérivent
ces induirions; peu d’objets dans un tableau,
nulle complication dans la difpofition.
de ces objets, une.feule lumière, un çoloris
fans recherche, un accord fimple & général,
.tendant à un effet unique; une figure, un
trait de caraétère, de fentiment, de paflion
déterminant tous les autres traits. &rç. Voilà
en général les moyens de l’ art. L’heureux choix
qu’en fait l ’artifte de génie le conduit au fu blime
de l’ imitation : & fi ce qui appartient
.à. la nature, dans le fujet e ft égalerrient bien
choifi, on^peut alors hazarder dç dire que l ’i-
mitation. fublime eft à certains égards au çleflus
du fublime imité; car il a fallu de plus la fus
périorité du. génie & celle de l’induftrie* ’ ,
Eflayer d’ entrer dans de plus grands détails
ferpit1 rifquer d’affaiblir les principes, Les
.exemples même font difficiles à y adapter parfaitement;
& plus en peinture que dans quel*,
ques autres arts.
Premièrement, parce que lestexemples parr
faits y font infiniment, rares.,
Secondement, parce qu’ils ne font à la pprtée
que de ceux qui les pofiedent, ou d*u petit
nombre qui a la facilité de les obfqrver où
ils ;fe trouvent.
Troifièmement, parce què. çes exemples,
c’eft-à-dire .les, tableaux fublimés j changent
eux mêmes, par leur nature pHyfique, indépendamment
dç;çe qu’ ils .font fujets à être altères?
S V E
par les accidens; & qu’enfin, lors qu’il s agit
des plus grandes perfeétions, telles que fu blime,
il faut que les ouvrages où fe trouvent,
ces perfeétions foient juges par des hommes?
capables de les fentir* •
Le fublime, de quelque genre q u il fo it,
fublime de vertu, d’aélion , d’expreffion , de
difeours, de fîlence même , n’eft pas à la
portée de toutes les âmes & de tous les yeux :
la fimplicité & l ’ unité paroiflent fou vent avoir
bien moins de mérite que la complication.
, Plus les idées même fe multiplient par le
progrès des lumières, plus on s’apperçoit que
les idées fublimes dont je viens de parler deviennent
rares. f •
Elles ne font ni de tous les hommes ni , de
tous les fiècles; mais , dans les arts d’imitation
dont les ouvrages tombent & reftent fous le,
fens de la vüe, on defire aumoins 1 e fublime
lors qu’ il n’exifte pas ; c ar 'le fens de la vüe
lui même, délicat', & rendant toujours pour
fon repos, à un feul point, à un feul effet, ramene
phyfiquement., autant qu’il le peut, à 1 unité
& à la fimplicité. Dans les temps où la peinture
.s’égare, on conçoit donc encore le meille
u r , même en fuivant le p ire, & cette conf-
cience de la perfeélion lui conferve fes droits
& l’hommage qui lui eft dû. ( Article de M.
W a t e l e t ;)* •
Voyei à l’article Style, ce qui a été dit
du Jlyle fublime.
S V E L T E , (adj.) Ce mot eft emprunté de
lTtalierf fvelto, qui fignifie délié. Une taille
fvelte dans la langue des artiftes, ce qu’efi,
dans la langue ordinaire, une taille déliée.
Le fens du mot fvelte, dans toute l’étendue que
lui donnent les artiftes, ne peut être employé
que par la réunion de plufieurs idées que donnent
ceux-ci : élégant, délicat, léger.
Le fvelte tient de près à l’élégance , avec
cette différence que le Jv.elte s’applique plus
ordinairement, dans la langue générale , à la
ta ille , à l’enfemble , qu’à de moindres parties.
On ne dit pas, des bras, des jambes fveltes ;
mais on dit, une taille fvelte en parlant de
celle d’une nymphe, ou du corps d’un jeune
homme ; & l’on entend, en parlant ainfi de
l’ une & de l’autre , une proportion dans toutes
les parties de l’enfemble qui dénote qu’ il eft
lé g e r , difpos, en même tems qu’agréable.
Cette dénomination emporte même quelque
cliote d’un peu élancé qui appartient au développement
de lajeunefle.
L’enfance n’eft pas fvelte & ne doit pas
l’être : c’eft un état encore trop imparfait. La
rondeur,« la mollefle des parties, la fraîcheur,
3â naïveté, la grâce qui vient de l’accord des
impreflions & des mouvemens font des compen-
fations qui lui fuffifent. Les -fentimens que
S V E 399
l’enfance ijifpire reflemblent au plaifir que
donne l’èfpérance.
La jeunefle, dans fon épanouïflement, c’eft-
à-dire, aux approches de l’adolëfcence , devient
fvelte : elle l’eft encore, çu du moins elle a
encore de l’élégance dans l’âge qui fuit; mais
la virilité confirmée commence à changer de
cara&ère ; car la nature,, qui , dans les âges
précédens , avait l ’air' de s’é!ancer pour atteindre
le- terme de fa parfaite croiflance, s’ appuie
& fe repofe, pour ainfi dire, fur e lle -
même, lorfqu’elle y eft parvenue. Elle fe pare
alors d’une forte de confiftance : le corps devient
mu/clé. I l parole s’enorgueillir d’ une vigueur
qui fait difparoître le fvelte & rallentit
l’agilité. Enfin ce corps s’àppefantit : il grofiit
ou s’ammaig'rit par parties, fans garder de proportions
, foit parce que les fucs nouriciers qui
furabondent, n’ayant plus de développement
à opérer, fe placent où ils peuvent; foit que
quelques caufes de dépériflement détériorent
certaines parties, en gênant lesfecrétions, ou
en altérant la^ nourriture qui leur eft nécef-
faire.
Voilà ce qui donne aux corps les caraétères
de l’âge qui approche de la yieillefle..
Dans c e lui-c i, ce qu’on veut bien quelque-,
fois appeller beauté , tient à des idées accef-
foires purement morales.. On croit appercevoir
dans ce qu’on nomme un beau vieilla rd, des
apparenees qui annoncent l’équilibre des parlions,
& par conféquent la fagefle, la bonté
qui doit en être la fuite , & l’expérience utile
aux autres'pour les confeîls.; Les rides, effets
du tems, les cheveux blanchis, la courbure-
même des membres qui fuppofe des fatigues
éprouvées , des travaux remplis , font naître des
idées de refped & d’ intérêt. Oti penfe que l’on
eft deftiné à parvenir à cet état. Cesidées réunies
embelliflent en quelque forte, ou voilent du
moins, lesimperfeélions. Quant à la caducité,
aucune illufiun ne peut fe mêler aux idées
qu’elle infpire, : celle de la deftruélion prochaine
en laifle appercevoir & en augmente
même, aux regards, les difformités.
Artiftes, ne. repréfentez pas, fi vous n’y êtes
forcés, les deux extrémités de la vie. Elles
ne comportent aucune beauté. L’ enfant à l’inf-
tant qu’ il vient de naître, le centenaire, prêe
à s’éteindre, n’offrent que des imperfeélions
que rien ne racheté : l’âge où l’homme eft fvelte
doit vous plaire plus que tout autre ; mais longez
qu’une figure maigre., ou dont la taille n’a
fou vent de légèreté & de prétention à l’élégance
qu’aux dépens de la proportion des cuifles &
des jambes, n’eft pas fve lte , mais incorreéte.
Donner une tête de plus à la dimenfion totale
d’une figure , eft un moyen plus toléré
qu’autorifé par l’art. Car il eft plus fin dans fes.
moyens avoués, & la nature n’ en employé pas