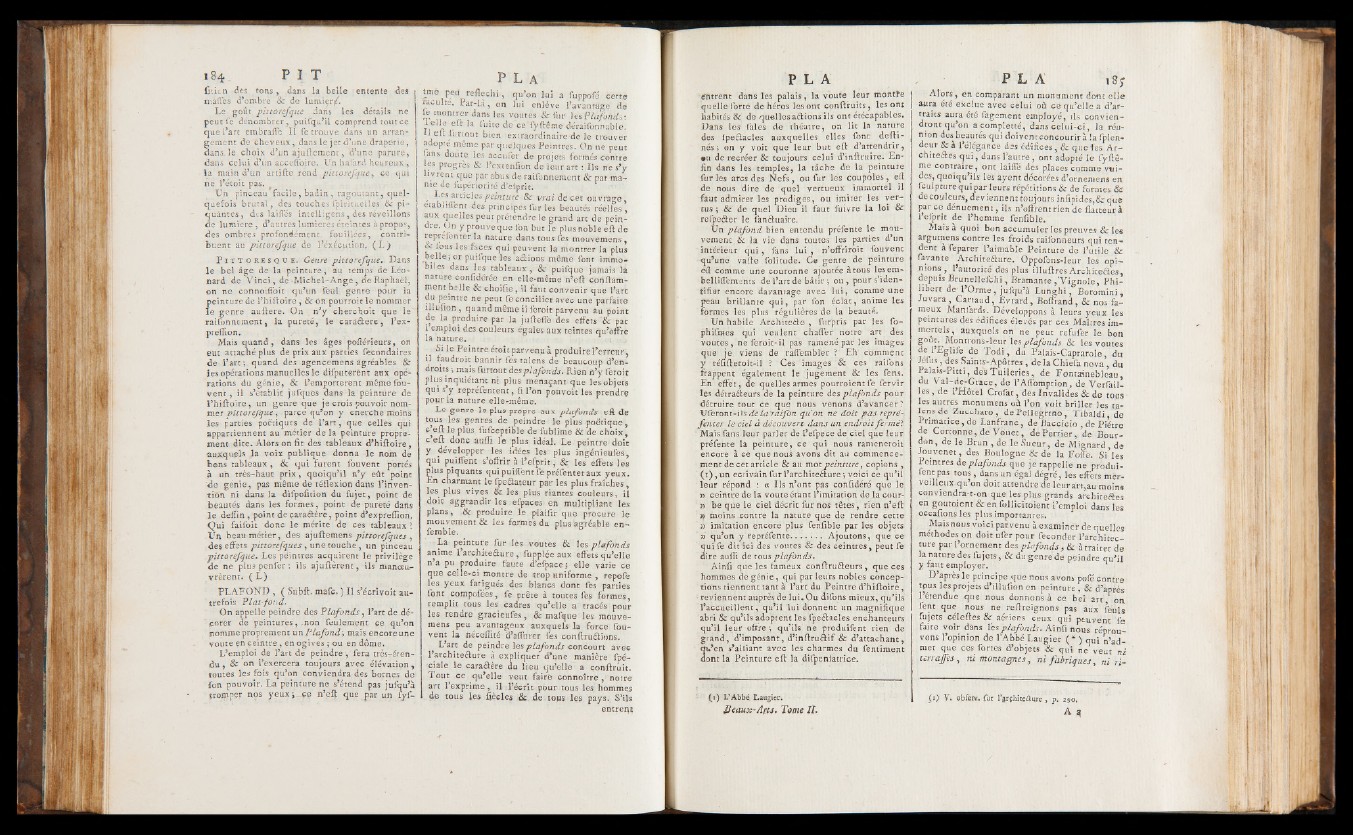
fi tien des tons, dans la belle entente des
màffes d’ombre & de lumierj^.
Le goût pittorefque dans les détails ne
peut fe dénombrer, puifqu’ il comprènd tout ce
que l’art embraffe II fe trouve dans un arrangement
de cheveux, dans le jet d’une draperie,
dans,le choix d’ un ajufiement, d’une parure,
dans celui d’ un accefloire. Un hafard heureux ,
la main d’ un artifte rend p i t to r e fq u e , ce qui
ne l’étoit pas.
Un pinceau facile, badin , ragoûtant, quelquefois
brutal, des touches fpirituelles & piquantes,
des laides intelligens, des réveillons
de lumière, d’autres lumières éteintes à propos,
des ombres profondément fouillées, contribuent
au p it to r e fq u e de l ’exécution, ( L )
P i t t o r e s q u e . Genre pittorefque. Dans
le bel âge de la peinture j au temps de Léonard
de V in c i, de -Michel-Ange , de Raphaël,
on ne connoiffoit qu’ un feul genre pour la
peinture de l’h iflo ire , 8c ôn pourroit le nommer
le genre auftere. On n’y cherchoit que iev
raifonnement, la pureté, le cara âere, l’ex-
prefïion.
Mais quand, dans les âges poflérieurs, on
eut attaché plus de prix aux parties fecondaires
de l’ art ; quand des agençemens agréables &
les opérations manuelles le difputerènt aux opérations
du génie, & l’emporterent même fou-
v e n t , il s’établit jufquds dans la peinture de
l ’ hiftoire, un genre que je crois pouvoir nommer
pittorefque, parce qu’on y enerche moins
les parties poétiques dé l ’a r t, que celles qui
appartiennent au métier de la peinture proprement
dite. Alors on fit des tableaux d’hiftoire,
auxquels la voix publique donna le nom de
bons tableaux , & qui fuient fouvent portés
à un trèsr-haut prix, qûoiqu’ il n’y eût point
de génie, pas même de réflexion dans l’ invention
ni dans la difpoficion du fujet, point de
beautés dans les formes, point de pureté dans
le deffin , point de çaraélère, point d’expreffion,
Qui fai l'oit donc le mérite de ces tableaux ? 1
Un beau métier, des ajuftemens pittorefques,
des effets pittorefques , une touche, un pinceau
pittorefque. Les peintres acquirent le privilège
de ne plus penfer : ils ajulcèrent, ils manoeuvrèrent*
( L )
P LAFOND , ( Subft. mafe. ) Il s’écrivoit autrefois
Plat-fond.
On appelle peindre des "Plafonds, l’ art de dé-
’ .corer de peintures, , non feulement ce qu’on
nomme proprement un Plafond \ mais encore une
voûte en peintre, en ogives ; ou en dôme.
L’emploi de l’art dé peindre’, fera très-étendu
, & on l’exercera toujours avec élévation,
toutes les fois qu’on conviendra des bornes de
fon pouvoir. La peinture ne s’étend pas jufqu’à
tromper nos y eu x,_ çe n’eft que par un fyftme
peu réfléchi, qu’on lui a fuppofé cette
faculté. Par-là, on lui enlève l’avantage de
te montrer dans les voûtes & fur 1 es Plafonds:
l elle eft la fuite de"ce'fyflême déraifonnable.
le l t Surtout bien extraordinaire de le trouver
adopte même par quelques Peintres. On ne peut
ans doute les acculer de projets formés contre
les progrès 8c î’extenfion de leur art : Us ne s’y
livrent que par abus de raifonnement & par manie
de fiipériori'cé d’elprit.
, Les articles peinture & vrai de cet ouvrage,
etabliflent des principes fur les beautés réelles ,
aux quelles peut prétendre le grand art de peindre.
On y prouveque fon but le plus noble eft de
reprefenter la nature dans tous les mouvemens,
oc fous les faces qui peuvent la montrer la plus
pelle j or puifque les aélions même font immobiles
dans les tableaux, & puifque jamais la
nature confidérée en elle-même n’eft conftàm^
ment belle & choifie, il faut convenir que Part
du peintre ne peut fe concilier avec une parfaite
illufton, quand même il feroit parvenu au point
de la produire par la jufteffe des effets '& par
1 emploi des couleurs égales aux teintes qu’offre
la nature. • . i - • t
Si le Peintre étoit parvenu à produire l’ erreur ,
il faudroit bannir fes talens de beaucoup d’ endroits
•, mais furtout àesplafonds. Rien n’y feroit
plus inquiétant ni plus menaçant que lès-objets
qui s’y repréfentent, fi l’on pouvoit les prendre
• pour ia nature elle-même.
Le genre le plus propre aux plafond* eft de
tous les genres de peindre le plus poétique,
ç’eft le plus fufceptible de fublime & de choix j
c eft^ donc auffi le plus idéal. Le peintre-doit
y développer les idées les plus ingénieufes,
qui puiffent s’offrir à l’efprit, & les effets les
plus piquants qui puiffent fe préfenter aux yeux.
En charmant le fpeâateur par les plus fraîches,
les plus vives & les plus riantes couleurs, il
doit aggrandir les efpaces en multipliant les
plans, & produire le plàifir que procure le
mouvement & les formes du plus agréable en-
femble.
La peinture fur lès voûtes Bc les plafonds
anime l’architeâure, fupplée aux effets qu’elle
n’ a pu produire faute d’efpacei elle varie ce
que celle-ci montre de trop uniforme , repofb
les yeux fatigués des blancs dont fes parties
font compofées, fe prête à toutes fes formes,
remplit tous les cadres qu’elle a tracés pour
les rendre gracieufes, & mafque les mouvemens
peu avantageux auxquels la force fou-
vent la néceflité d’affurer fes conftriiétions.
L’art de peindre les plafonds concourt avec
l’architeélure à expliquer d’une manière fpé-
xiale le caraélere du lieu quelle a çonftruit.
Tout ce qu’elle veut faire connoître , notre
art l’exprime, il l’écrit pour tous les hommes
de tous les fiècles & de tous les pays. S’ils
entrent
élurent dans les palais, la voûte leur montîe
quelle forte de héros les ont conftruits, les ont
habités & de quelles aélions ils ont étécapables.
Dans les l'aies de théâtre, on lit la nature
des fpeélacles auxquelles elles font defti-
nés ; on y voit que leur but eft d’attendrir,
•u de recréer & toujours celui d’inftruire. Enfin
dans les temples, la tâche de la peinture
furies arcs des N e fs , ou fur les coupoles, eft
de nous dire de quel vertueux immortel il
faut admirer les prodiges, ou imiter les vertus
; & de quel Dieu il faut fuivre ia loi &
refpeéler le lanéluaire.
Un plafond bien entendu préfente le mouvement
8c la vie dans toutes les parties d’ un
intérieur q u i, fans lui , n’offriroit fouvent
qu’ une vafte folitude. Ce genre de peinture
éft comme une couronne ajoutée à tous lesem-
belliffèments de l’art de bâtir ; ou , pour s’identifier
encore davantage avec lu i, comme une
peau brillante q ui, par fon éclat, anime les
formes les plus régulières de la beauté.
Un habile Architeéle , furpri.s par les fo-
phifmes qui veulent chaffer notre art des
voûtes, ne feroit-il pas ramené par les images
que je viens de raffembler ? Eh comment
y réfifteroit-il ? Ces images & ces raifons
frappent également le jugement 8c les fens.
En effet, de quelles armes pourroientfe fervir
les détraéleurs de la peinture des plafonds pour
détruire tout ce que nous venons d’avancer ?
Uferont-ils dela'raifon q uoh ne doit pas repré-,
fenter le ciel à découvert dans un endroit fermée
Mais fans leur parler de Fefpece de ciel que leur
préfente la peinture, ce qui nous rameneroit
encore à ce que nous avons dit au commencement
de cet article & au mot peinture, copions ,
( i ) , un écrivain fur l’architeélure *, voici ce qu’ il
leur répond : « Us n’ont pas confidéré que le.
» ceintre de la voûte étant l’imitation de la cour-
» be que le ciel décrit fur nos têtes , rien n’eft
2? moins contre la nature qu-e de rendre cette
» imitation encore plus ferifible par les objets
» qu’on y repréfente............Ajoutons, que ce
qui fe dit ici des voûtes & des Peintres, peutfe
dire aufli de tous plafonds.
Ainfi que les fameux conftruéleurs, que ces
hommes de génie, qui parleurs nobles conceptions
tiennent tant à l’art du Peintre d’hiftoire,
• reviennent auprès de lui. Ou dilons mieux, qu’ ils
l’accueillent, qu’ il lui donnent un magnifique
abri & qu’ ils adoptent les fpeélacles enchanteurs
qu’il leur offre •, qu’ ils ne produifent rien de
grand, d’imposant, d’ inftruélif & d’attachant,
u’en s’alliant avec les charmes du fentiment
ont la Peinture eft la difpenlàtrice.
( ï ) L’Abbé Laugier*
idéaux-Atts* Tome IL
Alors, en comparant un monument dont elle
anra été exclue avec celui où ce qu’elle a d’ar-
traits aura été fagement employé, ils conviendront
qu’on acompletté, dans celui-c i, la réunion
des beautés qui doivenrconcourirà la Iplen»
deur & à l’élégance des édifices, 8c que les A r -
chitëéles qui, dans l’autre, ont adopté lè fyftê-
me contraire, ont laifle des places comme vtii-
des, quoiqu’ ils les ayent décorées d’ornemens en
fculpturequipar leurs répétitions 8c de formes 8c
de couleurs, deviennent toujours infipides,&que
par ce dénuement, ils n’offrentriende flacteurà
1 efprit de l’homme fenfible.
Mais a quoi bon accumuler les preuves 8c les
argumens contre les froids raifonneurs qui tendent
a feparer l’aimable Peinture de l’utile &
favante Architeélure. Oppofons-ïeur les opinions,
l’autorité des plus illuftres A rchiteéles,
depuis Brunellefchi, Bramante ,'V ignole, Philibert
de1 l’Orme, jufqu’à Lunghi, Boromini,
Juvara, Cartaud, Evrard, Boffrand, 8c nos fameux
Manlàrds. Développons à leurs yeux lps
peintures des édifice? élevés par ces Maîtres immortels,
auxquels on ne peut refufer le bon
goût. Montrons-leur les plafonds 8c les voûtes
de l’Egîife de T o d i, du Palais-Caprarole, du
Jefus, des Saints-Apôtres , de la Chiefa nova du
Palais-Pitti, des Tuileries, dç Fontainebleau,
du Val-de-Grace, de l’Affomption, de Verfaii-
les , de l’Hôtel Crofac, des Invalides & de tous
les autres monumens où l’on voit briller les talens
de Zuccharo , de P e lle g r ih o T ib a ld i de
Primatice, de Lanfranc, de Baccicio , de Piètre
de Cortonne, de V ouet, de Perrier, de Bourdon,
de le Brun , de le Sueur, de Mignard, de
Jouvenet, des Boulogne & de la Foftê. Si les
Peintres àe plafonds que je rappelle ne produifent
pas tous , dans un égal degré, les effets merveilleux
qu’on doit attendre de leur art,au moins
conviendra-t-on qu.e les plus grands architeéles
en goutoient & en folliciroient l’emploi dans les
occafions les plus importantes.
Maisnous voici parvenu à examiner de quelles
méthodes on doit ufer pour féconder l’architecture
par l’ornement des plafonds, 8c à traiter de
la nature des fu jets , & du genre de peindre qu’ il
y faut employer.
D’après le principe que nous avons pofé contre
tpus les projets d’ illufion en peinture, & d’après
l ’étendue que nous donnons à ce bel art on
fent que nous ne reftreignons pas aux feuls
fujets céleftes 8c aériens ceux qui peuvent fe
faire , voir dans les plafonds. Ainfi nous réprouvons
l’opinion de l’Abbé Laugier (* ) qui n’admet
que ces fortes d’objets & qui ne veut ni
terrajfes, ni montagnes, ni fabriques, ni rim
Y. obferv. fur l’grçbiteûure, p. 250.
A a