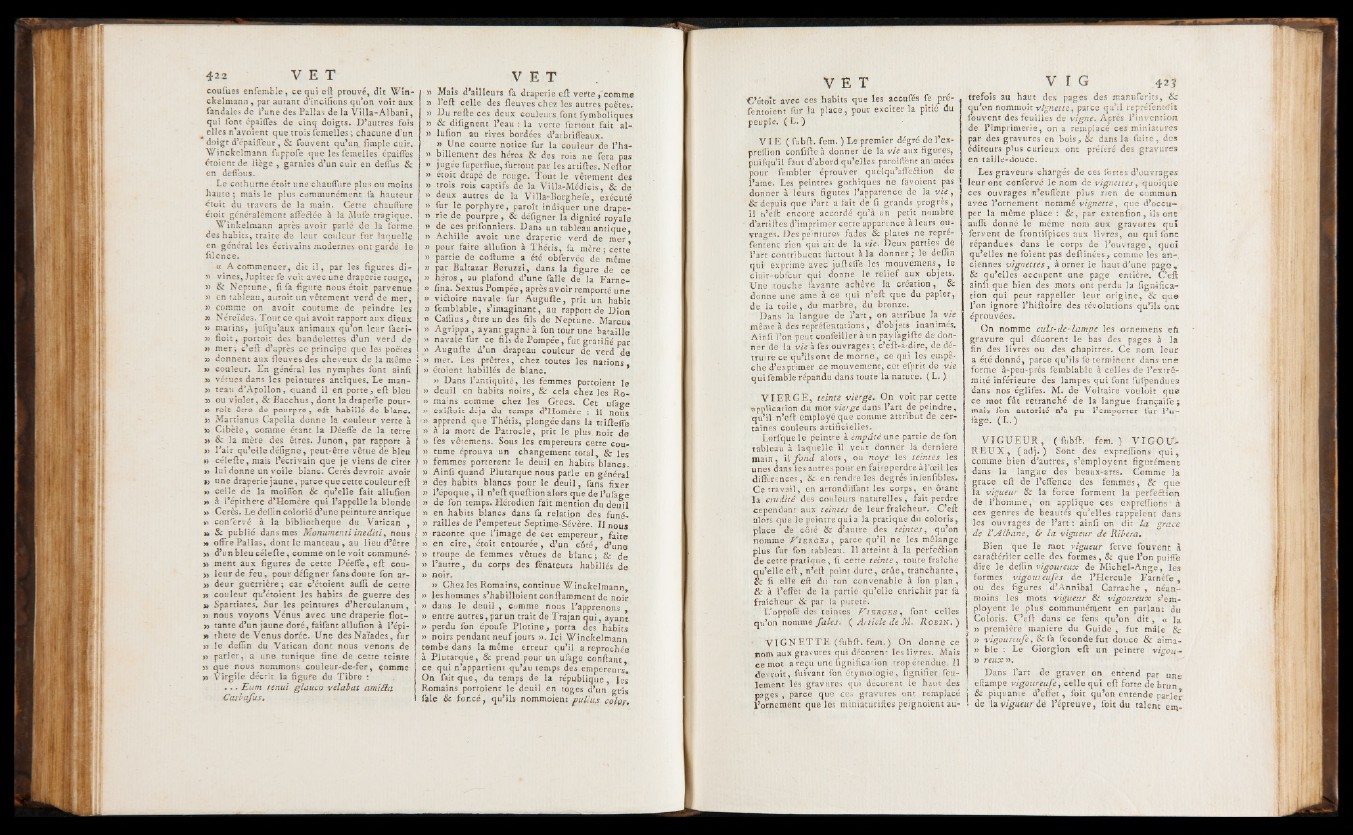
coufues enfemble, ce qui eft prouvé, dit Win-
ckelmann, par autant d’incifions qu’on voit aux
fandales de l’une des Pallas de la V illa -A lb an i,
qui font épaiffes de cinq doigts. D’autres fois
elles n'avoient que trois femelles; chacune d’un
doigt d’épaiffeur , & fouvent qu’ un fimple cuir.
Wincke Imann fuppofe que les femelles épaiffes
étoient de liège , garnies d’un cuir en deffus &
en deffous.
Le cothurne étoit une chauffnre plus ou moins
haute ; mais le plus communément fa hauteur
étoit du travers de la main. Cette chauflure
étoit généralement affeélée à la Mufe tragique.
Winkelmann après avoir parlé de la forme
des habits, traite de leur couleur fur laquelle
en général les écrivains modernes ont gardé le
filence.
« A commencer, dit i l , par les figures dî-
» vines, Jupiter fe voit avec une draperie rouge,
» & Neptune, fi fa figure nous étoit parvenue
» en tableau, auroit un vêtement verd de mer,
» comme on avoir coutume de peindre les
» Néreïdes. Tout ce qui avoir rapport aux dieux
» marins, jufqu’aux animaux qu’on leur facri-
» fioit, portoic des bandelettes d’ un verd de
» mer; c’eft d’après ce principe que les poètes
» donnent aux fleuves des cheveux de la même
» couleur. En général les nymphes font ainfi
» vêtues dans les peintures antiques. Le man-
» teau d'Apollon, quand il en porte, eft bleu
» ou v iolet, & Eacchus, dont la draperie pour-
» roic être de pourpre, eft habillé de blanc.
» Martianus Capella donne la couleur verte à
» Cibè le, comme étant la Déeffe de la terre
» & la mère des êtres. Junon, par rapport à
» l'air qu’ elle défigne, peut-être vêtue de bleu
» célefte, mais l’écrivain que je viens de citer
» lui donne un voile blanc. Cerès devroit avoir
» une draperie jaune, parce que cette couleur eft
» celle de la moïffon & qu’elle fait allufion
» à l’épithete d’Homère qui l’appelle la blonde
» Cerès. Le deflin colorié d’ une peinture antique
r> conservé à la bibliothèque du Vatican ,
» & publié dans mes Monumenti inéditi, nous
» offre Pallas, dont le manteau, au lieu d’ être
» d’ un bleu célefte, comme on le voit communé-
» ment aux figures de cette Déeffe, eft cou-
» leur de feu, pourdéfigner fans doute fon ar-
» deur guerrière ; car c’étoient auffi de cette
» couleur qu’étoient les habits de guerre des
» Spartiates. Sur les peintures d’herculanum,
» nous voyons Vénus avec une draperie flot-
» tante d’un jaune doré, faifant allufion à l’cpi-
» thete deVenus doféè. Une des Naïades, fur
» le deflin du Vatican dont nous venons de
» parler, a une tunique fine de cette teinte
» que nous nommons couleur-de-fer, çomme
» Virgile décrit la figure du Tibre :
. . . Eum tenui glauco velabat amiâla
Car b afus.
•» Mais d’ailleurs fa draperie eft vefte/comme
» 1 eft celle des fleuves chez les autres poètes.
» Du refte ces deux couleurs, font fymboliques
» & difignent l’eau : la verte furtôut fait al-
» lufion au rives bordées d’avbriffeaux.
» Une courte notice fur la couleur de l’ha-
» billement des héros 8c des rois ne fera pas
» jugée fuperflue, furtout par les artiftes. Neftor
» étoit drapé de rouge. Tout le vêtement des
» trois rois captifs de la Villa-Médicis, & de
» deux autres de la Villa-Borghefe, exécuté
» fur le porphyre, paroît indiquer une drape-
» rie de pourpre, & défigner la dignité royale
» de ces prilonniers. Dans un tableau antique,
» Achille avoir une draperie verd de mer
» pour faire allufion à Thétis, fa mère ; cette
» partie de coftume a été obfervée de même
» par Baltazar Beruzzi, dans la figure de ce
» héros, au plafond d’une falle de la Farne-
» fîna. Sextus Pompée, après avoir remporté une
» viéloire navale fur Augufte, prit un habit
» femblable, s’ imaginant, au rapport de Dion
>5 Caflius j être un des fils de Neptune. Marcus
» Agrippa , ayant gagné à fon tour une bataille
» navale fur ce fils de Pompée, fut gratifié par
| » Augufte d’ un drapeau couleur de verd de
» mer. Les prêtres, chez toutes les nations .
» étoient habillés de blanc.
» Dans l’antiquité, les femmes portoient le
» deuil en habits noirs, 8c cela chez les Ro-
» mains comme chez les Grecs. Cet ufage
» exiftoit déjà du temps d’Homère : il nous
•» apprend que Thétis, plongée dans la trifteffe-
» à la mort de Patrocle, prit le plus noir de
» fes vêtemens. Sous les empereurs cette cou-
» tume éprouva un changement total, & les
» femmes portèrent le deuil en habits blancs. ■
» Ainfi quand Plutarque nous parle en général
» des habits blancs pour le deuil, fans fixer
» l’époque, il n’eft qu eft ion alors que de l’ufage
» de fon temps. Hérodien fait mention du deuil
» en habits blancs dans fa relation des funé-
» railles de l’empereur Septime-Sévère. Il nous
» raconte que l’image de cet empereur, faite
! » en cire, étoit entourée, d’ un côté, d’une
» troupe de femmes vêtues de blanc ; & de
» l’autre, du corps des fénateurs habillés de
» noir.
» Chez les Romains, continue Winckelmann
» les hommes s’habilloient conftaroment de noir
» dans le deuil , çomme nous l'apprenons
» entre autres, par un trait de Trajan qui, ayant
» perdu fon époufe Plotine, porta des habits
» noirs pendant neuf jours ». Ici NVinckelmann
tombe dan^ la même erreur qu’ il a reprochée
à Plutarque, & prend pour un ufage confiant
ce qui n’appartient qu’au temps des empereurs.
On fait que, du temps de la république, Jes
Romains portoient le deuil en toges d’ un gris
fale & foncé, qu’ ils nommoient pullus colçy.
C ’étoît avec ces habits que les accufés fe pré-
fentoient fur la place, pour exciter la pitié du
peuple. ( L. )
V I E ( fubft. fem. ) Le premier degré de l’ex-
preiïion confifte à donner de la vie aux figures,
puifquil faut d’abord qu’celles paroiffent animées
pour fembler éprouver quelqu’affe&ion de
l’ame. Les peintres gothiques ne favoient pas
donner à leurs figutes l’apparence de la v i e ,
& depuis que Part a fait de fi grands progrès,
il n’eft encore accordé qu’à un petit nombre
d’arriftes d’imprimer cette apparence àieurs ouvrages.
Des peintures fades 8c plates ne repré-
fentent rien qui ait de la vie. Deux parties de
l’art contribuent furtout à la donner ; le deflin
qui exprime avec jufteffe les mouvemens, le
clair-obfcur qui donne le relief aux objets.
Une .touche favante achève la création, &
donne une ame à ce qui n’eft que du papier,
de. la to ile , du marbre, du bronze.
Dans la langue de l’art, on attribue la vie
même à des repréfentations, d’objets inanimés,
Ainfi l’on peut confeiller à un payfagifte de donner
de la vie à fes ouvrages ; c’eft-à-dire, de détruire
ce qu’ils ont de morne , ce qui les empêche
d’exprimer ce mouvement, cet efprit de vie
qui femble répandu dans toute la nature. ( L. )
V I E R G E , teinte vierge. On voit par cette
application du mot vierge dans l’ art de peindre,
qu’ il n’eft employé que comme attribut de certaines
couleurs artificielles.
Lorfque le peintre à empâté une partie de fon
tableau à laquelle il veut donner la derniere
main, i l fond alors, ou noyé les teintes les
unes dans les autres pour en faire perdre à l’oeil les
différences, 8c en rendre les degrés infenfibles.
Ce travail, en arrondiffant les corps, en ôrant
la crudité des couleurs naturelles, fait perdre
cependant aux teintés de leur fraîcheur. C’ eft
alors que le peintre qui a la pratique du coloris,
place de côté 8c d’autre des teintes, qu’on
nomme Vierges, parce qu’il ne les mélange
plus fur fon tableau. Il atteint à la perfeâion
de cette pratique, fi cette teinte, toute fraîche
qu’elle eft , n’eft point dure, crée, tranchante,
8c fi elle eft du ton convenable à fon plan ,
8c à l’effet de la partie qu’elle enrichit par fa
fraîcheur & par la pureté.
L’ oppofé des teintes V ie rges , font celles
qu’on nomme fales. ( Article de M. Robin. )
• V IG N E T T E (fubft. fem.) On donne ce
nom aux gravures qui décorent les livres. Mais
ce mot a reçu une lignification trop étendue. Il
devroit, fuivant fon étymologie, lignifier feulement
les gravures qui décorent le haut des
pages , parce que ces gravures ont remplacé
l’ornement que les miniaturiftes peignoient autrefoîs
au haut des pages des raamifcrits, 8c
qu'on nommoir vignette, parce qu’il repréfentdit
fouvent des feuilles de vigne. Après l’ invention
de l’ imprimerie, on a remplacé ces miniatures
par des gravures en bois, 8c dans la fuite, des
éditeurs plus curieux ont préféré des gravures
en taille-douce.
Les graveurs chargés de ces fortes d’ouvrages
leur ont confervé le nom dz vignettes, quoique
ces ouvrages n’euffent plus rien de commun
avec l’ornement nommé vignette, que d’occuper
la même place : & , par extenfion, ils ont
aufli donné le même nom aux gravures qui
fervent de frontifpices aux livres, ou qui font
répandues dans le corps de l'ou vra ge, quoi
qu’ elles ne foient pas deftinées, comme les an-,
ciennes vignettes, à orner le haut d'une page ,
8c qu’elles occupent une page entière. C ’eft
ainfi que bien des mots ont perdu la fignifica-
tion qui peut rappeller leur origine, & qu®
l’on ignore l’hiftoire des révolutions qu’ ils ont
éprouvées.
On nomme culs-de-lampe les ornemens eft
gravure qui décorent le bas des pages à la
| fin des livres ou des chapitres. Ce nom leur
a été donné, parce qu’ ils fe terminent dans une
forme à-peu-près femblable à celles de l’extrémité
inférieure des lampes qui font fufpendues
dans nos églifes. M. de Voltaire vouloir que
ce mot fût retranché de la langue francaife ;
mais fon autorité n’a pu l ’emporter fur l'u -
fâge. (L .)
V IG U E U R , ( fub ft. fem .) V IG O U R
E U X , ( adj. ) Sont des expreflions q u i,
comme bien d'autres, s’employent figurément
dans la langue des beaux-arts. Comme la
grâce eft de l’effence des femmes, & que
la vigueur 8c la force forment la perfection
de l’homme, on applique ces expreflions à
ces genres de beautés qu’elles rappèlent dans
les ouvrages de l’art : ainfi on dit la grâce
de VAlbane, & la vigueur de Ribera,
Bien que le mot vigueur ferve fouvent à
caraétérifer celle des formes, 8c que l’on puifle
dire le deflin vigoureux de Michel-Ange, les
formes vigoureufes de l’Hercule Farnèfe ,
ou des figures d’ Annibal Carrache , néanmoins
les mots vigueur 8c vigoureux s’employent
le plus communément en parlant du
Coloris. C’eft dans ce fens qu’on d i t , « Ja
» première manière du Guide , fut mâle &
» vigoureufe, & fa fécondé fut douce 8c aima-
» ble : Le Giorgion eft un peintre vigou-
» reux ».
Dans l’art de graver on entend par une
| eftampe vigoureufe, celle qui eft forte de brun
j & piquante d’ e ffet, foit qu’on entende parler
i de la vigueur de l’épreuye, foit du talent en*-