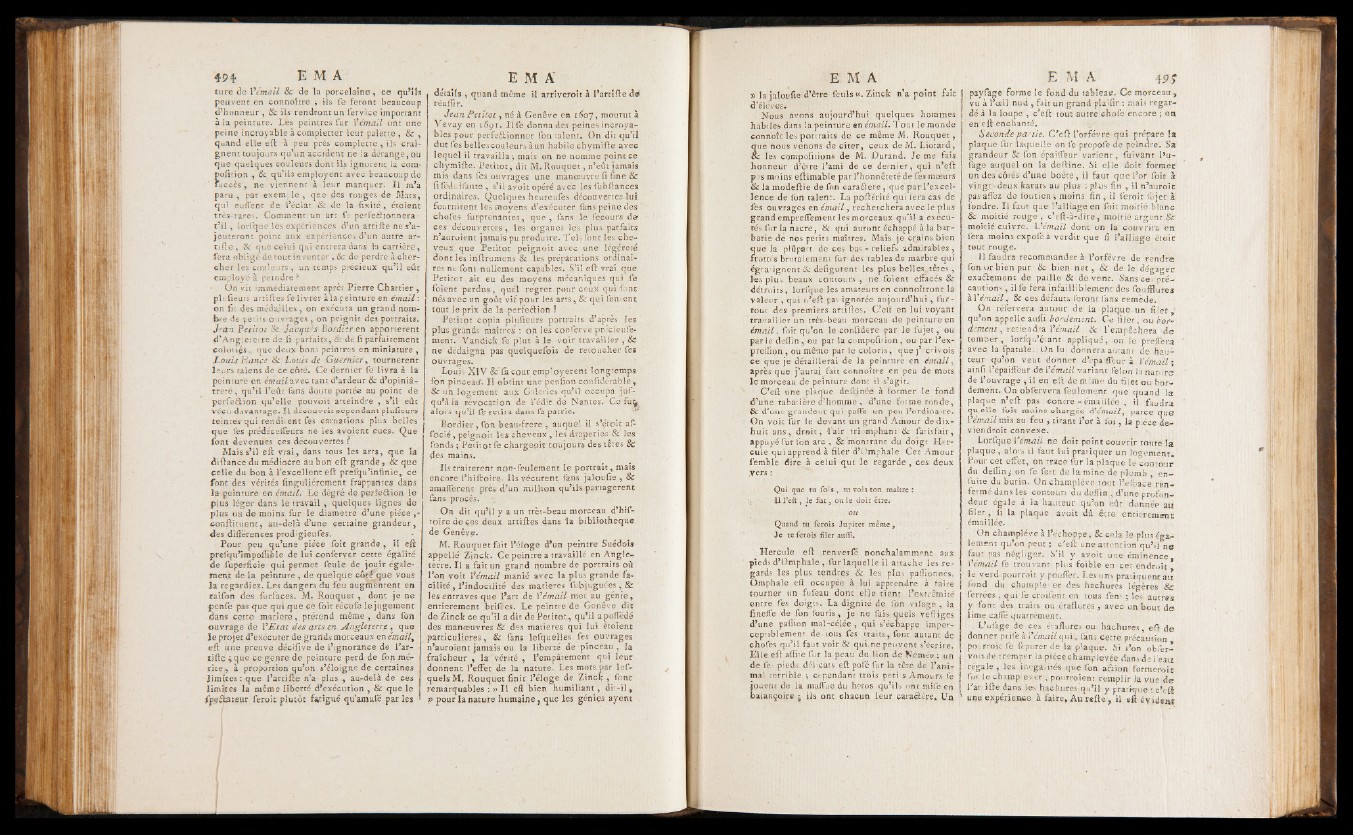
ture de l’émail & de la porcelaine, ce qu’ ils
peuvent en connoltre--, ils le feront beaucoup
d’honneur , & ils rendront un fervice important
à la peinture. Lès peintres fur Vémail ont une
peine incroyable à corn-pi ettçr leur palette , & ,
quand elle eft à peu près complette , ils craignent
toujours qu’ un accident ne la dérange, ou
que quelques couleurs dont ils ignorent la com-
pofition & qu’ils employent avec beaucoup de
fuccès, ne viennent à leur manquer. Il m’a
paru , par exem; le , qae des rouges de Mars,
qui euflent de l’éclat & de la -fix ité, étoient
très-rares. Comment un art fs perfefchonnera-
t’ i l , lorfque les expériences d’ un artifte ne s’ajouteront
point aux expériences d’ un autre artifte
, & que celui qui entrera dans la carrière,
fera obligé de tout inventer 1 8c de perdre à chercher
les couleurs , un temps précieux qu’ il eût
employé à peindre ?
On vit immédiatement après Pierre Chartier ,
plufieurs artifres fé livrer à la peinture en email :
on fit.des médailles, on exécuta un grand nombre
de petits ouvrages . on peignit des portraits.
Jeçtn Pecitoc & Jacques Bordizr en apportèrent
d’Angleterre de fi parfaits, & de fi parfaitement
coloriés,, que deux bons peintres en miniature,
Louis Hançe & Louis de Guernier, tournèrent
leurs talens de ce côté. Ce dernier fe liyra à la
peinture en émail avec tant d’ ardeur & d’opiniâ^-
treré, qu’ il l’eût fans doute portée au point de
perfection qu’elle pouvoit atteindre , s’il eût
vécu davantage. I l découvrit cependant plufieurs
teintes'qui rendirent fes carnations plus belles
que fes prédécefleurs ne les a voient eues. Que
font devenues ces découvertes ?
Mais s’ il eft vrai, dans tous les arts, que la
diftance du médiocre au bon eft grande , & que
celle du bon à l’excellent eft prefqu’infinie, ce
font des vérités finguliérement frappantes dans
la peinture en émail. Le dégré de perfection le
plus léger dans le travail , quelques lignes de
plus ou de moins fur le diamètre d’une pièce y
constituent, au-delà d’une certaine grandeur,
<3es différences prodigieufes.
Pour peu qu’une pièce foie grande , il eft
prefqu?impofIible de lui conferyer cette égalité
de luperficie ' qui permet feule de jouir égale-.
men.t de la peinture , de quelque côté que vous
la regardiez. Les dangers du feu augmentent en
raifon des furfaçeS; M. Rouquet , dont je ne
jpcnfe pas que qui que ce foit réeufe le jugement
dans cette matière, prétend m ân e , dans fon
ouvrage de P E ta t des arts en Angleterre, que
le projet d’exécuter de grands morceaux en émaily
eft une preuve décifive de l’ ignorance de l’ar-
îilte|>que ce genre de peinture perd de fon mér
rite,, à proportion qu’on s’éloigne de certaines
limites: que l’artifte n’a plus , au-delà de ces
limites la même liberté d’exécution , & que le
fpeélateur feroic plutôt fatigué qu’amule par les
détails , quand même il arriveroit à l’artifte dei
réuflîr.
Jean Petitot, né à Genève en 1607, mourut à
Vevay en 1Ô91. I l fe donna des peines incroyables
pour perfectionner fon talent. On dit qu’il
dut fes belles couleurs à un habile chymifte avec
lequel il travailla:, mais on ne nomme point ce
chymifte. Petitot, dit M. Rouquet, n’eût jamais
mis dans les ouvrages une manoeuvre fi fine &
fi fedu liante , s’ il avoit opéré avec les fubftances
ordinaires. Quelques heureulès découvertes lui
fournirent les moyens d’exécuter fans peine des
choies furprenantes, que , fans le fecours do*
ces découvertes, les organes les plus parfaits
n’auroient jamais pu produire. Tels font les cheveux
que Petitot peignoit avec une légiféré
dont les inftrumcns & les préparations ordinaires
ne font nullement capables. S’il eft vrai que
Petitot, ait eu des moyens mécaniques qui fe
foient perdus, quel regret pour ceux qui font
nés avec un goût v if pour les arts, & quiTentent,
tout le prix de la perfection !
. Petitot copia plufieurs portraits d’après les
plus grands maures : on les conferve précieufe-
ment. Vandick fe plut à le voir travailler , &
ne dédaigna pas quelquefois de retoucher fes
ouvrages.
Louis X IV $c fa cour employèrent longtemps
fon pinceâif. Il obtint une penfion con fi dé râble,
& un Logement aux Galeries qu’ il occupa juf~
qu’à la révocation de l’édit de Nantes. Ce fu^
alors qu’il fe retira dans fa patrie.
Bordier, fon beau-frere , auquel il s’étoit a£
focié, peignpit les cheveux, les draperies & les
fonds ; Petitot fe chargeait toujours des têtes 8c
des mains.
Ils traitèrent non-feulement le portrait, mais
encore l’hiftoirç, Ils vécurent fans jaloufie , &
amafterent près d’ un million qu’ ils^partagerent
fans proçès,
On dit qu’ il y a un très-beau morceau d’hif-
toire de çes deux artiftes dans la bibliothèque
de Genêye.
M. Rouquet fait l’éloge d’un peintre Suédois
appellé Zinck. Ce peintre a travaillé en Angleterre.
Il a fait un grand nombre de portraits où
l’or» voit Vémail manié avec la plus grande fa*
c ilité , l’indocilité des matières fubjuguées , &
les entraves que l’art de V émail met au génie,
entièrement brifées. Le peintre de Genève dit
de Zinck ce qu’ il a dit de Petitot , qu’ il apoffedé
des manoeuvres & des matières qui lui étoient
particulières, & fans lefquelles fes ouvrages
n’auroient jamais eu la liberté de pinceau , la
fraîcheur , laTvérité , l’empâtement qui leur
donnent l’effet de la nature. Les mots par lefr
quels M, Rouquet finit- l’éloge de Zinck , font
remarquables : » Il eft bien humiliant, dir-il f
» pour la nature humaine, que les génies ayçnt
» la jaloufie d’ être feuls «. Zinck n’ a point fait
d’élèves.;
Nous avons aujourd’hui quelques hommes
habiles dans la peinture en émail. Tout le monde
connoîc les portraits de ce même M. Rouquet,
que nous venons de citer, ceux de M. Liotard,
& les compofitions de M. Durand. Je me fais
honneur d’être l’ami de ce dernier, qui n’eft
pas moins eftimable par l’honnêteté de fes moeurs
& la modeftie de fon caraftere , que par l ’excellence
de (on talent. La poftérité qui fera cas de
fes ouvrages en émail, recherchera avec le plus
grand empreffement les morceaux qu’ il a exécutés
fur la nacre, & qui auront échappé à la barbarie
de nos petits maîtres, Mais je crains bien
que la plûpart de ces bas-reliefs admirables,
frottés brutalement fut des tables de marbre qui
égratignent 8c défigurent les plus belles ;têtes,
les plus beaux contours , ne. foient effacés &
détruits, lorfque les amatéurs en connoîtront la
valeur , qui r.’eft pas ignorée aujourd’ hui , fiur-
touc des premiers artiftes. C’ eft en lui voyant
travailler un très-beau morceau de peinture en
émail, foit qu’on le confidere par le fuje t, ou
parle deftin , ©u par la compofition , ou par l’ex-
preffion, ou même par le coloris, que ]’ crivois
ce que je détaillerai de la peinture en émail,
après que j’aurai Tait connoître en peu de mots
le morceau de peinture dont il s’agit.,
C ’eft une plaque deftjnée à former le fond
d’une, tabatière d’homme , d’une forme ronde-,
& d’ une grandeur qui paffe un peu l’ordinaire.
On voit fur le devant un grand Amour de dix-
huit ans, droit, l'air triomphant 8c farisfair,
appuyé fur fon arc, & montrant du doigt Hercule
qui apprend à filer d’ ümphale Cet Amour
lèmble dire à celui qui le regarde , ces deux
yers :
Qui que tu fois , tu vois ton maître:
l i l ’eft , le fut, ou le doit être.-
ou
Quand tu ferois Jupiter même,
Je te ferois -filer auflî.
Hercule eft renverfé nonchalamment aux
pieds d’Omphale , fur laquelle il attache les rer
gards ies plus tendres 8c les plus paffionnés.
Omphale eft occupée à lui apprendre à faire
tourner un fufeau dont elle tient l’extrê'mké
entre fes doigts. La dignité de l’on vilàge , la
fineffe de fon lôuris, je ne fais quels veftiges
d’une pafiion maî-célée , qui s’échappe imperceptiblement
de-tous fes traits, font autant de I
chofes qu’ il faut voir 8c qufine peuvent s’écrire. j
Elle eft affite fur la peau du lion de Némée ; un {
de fes pieds délicats eft pofé fur la tête de l’ani- j
mal terrible •, cependant trois peti s Amours fe I
jouent de la maftue du héros qu’ ils ont mile en I
balançoire * ils ont chacun leur cara&ère» Un *
payfage forme le fond du tableau. Ce morceau ,
vu à l’oeil nud , fait un grand plaifir : mais regardé
à la loupe , c’eft tout autre çhofe encore ; on
en eft enchanté.
Seconde partie. C ’eft l’orfèvre qui prépare la
plaque fur laquelle on fe propofe de peindre. Sa
grandeur & fon épaiffeur varient, fuivant l ’ u-
fage auquel on la deftine. Si elle doit former
un des côtés d’ une boëte, il faut que l’or foit à
vingt-deux karats au plus ; plus fin , il n’auroit
pas a (fez de foutien ; moins fin , il feroit lu jet à
fondre. Il faut que l’alliage en foie moitié blanc
& moitié rouge , c’eft-à-dire, moitié argent 8c
moitié cuivre. L'émail dont on la couvrira en
fera moins expoféà verdir que fi l ’alliage étoic
tout.rouge.
Il faudra recommander à l’orfévre de rendre
fon or bien pur & bien n e t , & de le dégager
exactement de paille & de vent. Sans ee\ précautions
, ilfe fera infailliblement des foufflures
à P émail, & ces défauts l’eront fans remède.
On réfervera autour de la plaque un filet
qu’ on appelle auffi bordemznt. Ce file t, ou b or-
dzment, retiendra Pémail ik l ’empêchera de
tomber, lorfqu’érant appliqué, on le preffera
avec la fpatule. On lu donnera autant de hauteur
qu’ôn veut donner d’épaiffeur à P émail ;
ainfi l’épaiflèur de P émail variant félon la nature
de l’ouvrage , il en eft de même, du filet ou bor-
dement. On obfervera feulement que quand la
plaque n’eft pas contré - émaillée , il faudra
qu elle foit moins chargée émail, parce que
P émail mis au feu , cirant l’or à fo i , la pièce de-
vieridroit convexe. .
Lorfque Pémail ne doit point couvrir route la
plaque , alors il faut lui pratiquer un logemenr.
Pour cet effet, on trace fur la plaque le contour
du deffin,- on fe fert de lamine de plomb en-
fuite du burin. Onchampléve tout l’efpace jrèn-
fermé dans les contours du deffin , d’une profondeur
égale à la hauteur qu’on eût donnée au
filer , li la plaque avoit dû être entièrement:
émaillée.
On champléveà l’échoppe, & cela le plus également
qu’on .peut ; c ’eft une attention qu’ il ne
faut pas négliger. S’ il y avoit mie éminence
Pémail fe trouvant plus foibîe en cet endroit
le verd pourroic y pouffer. Les uns pratiquent au
fond du chample.er des hachures légères &
ferrées , qui fie croifenr en tous fiens ; les autres
y font des traits ou éraflures, avec un bout de
lime cafte quarrément.
L’ulage de ces éraflures ou hachures, eft de
donner prilè à Pémail qui , fans cette précaution
pourroit; fe feparer de la plaque. Si i’ on obfer-
vottde tremper la piècechampievée dans-de l'eau
régale, les inégalités que fon aftion formeroiü
fur le champ e ver , pourroient remplir la vue de
l ’ar ifte dans les hachures qu’il y pratique : c’cff
une expérience à faire. Au refte., il eft évident