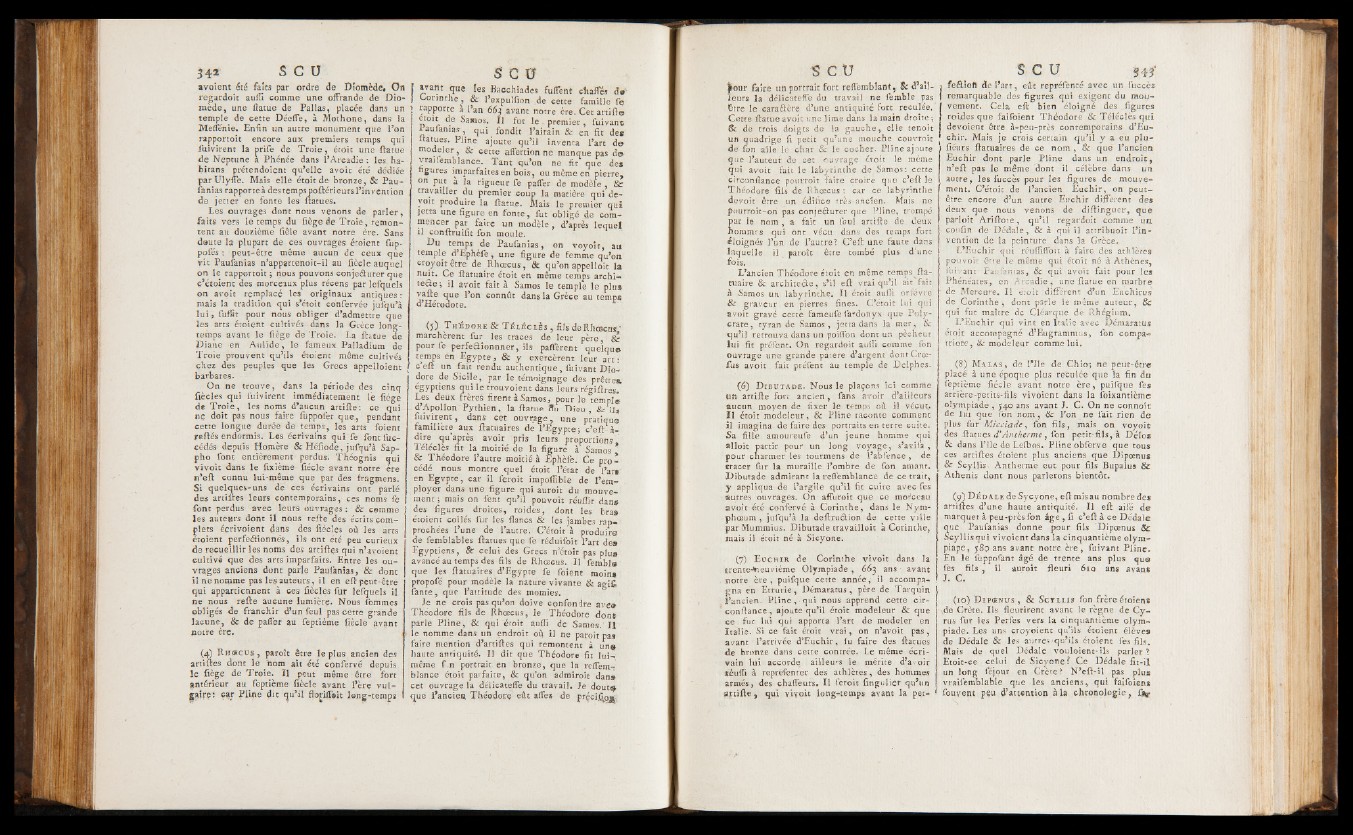
» v o ie n t été fa its par ordre d e D iom ède« O n ]
rega rd oît aufli. com m e u n e offrande d e D io - }
m e d e , un e flatu e de P al la s, p lacée dans un |
tem p le de c e tte D é e fle , à M o th o n e , dans la '
M eftén ie. E n fin u n autre m o n um en t q u e l’on
rapportoit en core au x prem iers tem ps q u i
fu iviren t la prife de T r o ie , é to it u n e ftatu e
d e N ep tu n e a P lién ée dans l ’A r c a d ie : le s , ha-
b itan s préten d oien t qu’e lle a v o ic été d édiée
p a r U ly ffe . M ais e lle éto it d e b r o n z e , & P a u -
fà iiia s rapporte à des tem ps poftérieurs l’in v e n tio n
d e j etter en fo n te le s ftatu es.
L es o u vra ges d o n t n o u s v en o n s d e p a rler,
fa its v ers le tem ps d u fièg e d e T r o ie , rem o n te
n t au dou zièm e ü ê le avan t n o tre ère. Sans
d o u te la plupart d e ces o u vra ges écoien t fup-
pofés : p e u t-ê tr e m êm e aucun d e ceu x q u e
v it Paufanias n ’a p p arten o it-il au fiè c le a u q u el
o n le rapportoit ; nou s p ouvons conje& urer qu e
e ’éto ie n t des m orceaux plus récens par lefq u els
o n a v o it rem placé les o rig in a u x an tiq u es :
m ais la trad itio n q u i s’éto it con ferv ée ju fq u ’à
l u i , fu fit pour nou s o b lig e r d’adm ettre que
le s arts éto ie n t c u ltiv é s dans la G rèce lo n g tem
p s a van t le fièg e de T r o ie . La ftatu e d e
D ia n e e n A u lid e , le fam eu x P a llad ium de
T r o ie p ro u ven t qu’ils éto ien t m êm e cu ltivés
c h e z d es p eup les q u e les G recs a p p ello ien t
b arbares.
O n n e tr o u v e , dans la période des cin q
fiè c le s q u i fu iv iren t im m éd iatem en t le fièg e
d e T r o ie , le s nom s d’aucu n a rtifte: c e q u i
n e d o it pas n o u s faire fuppofer q ue., p endant
c e tte lo n g u e durée d e tem p s, les arts fo ien t
r e lié s end orm is. L es écriv ain s q u i fe fon t fu c-
çéd és depuis H om ère & H é fio d e , ju fq u ’à Sap-
p h o fon t en tièrem en t perdus. T h é o g n is qu i
v iv o it dans le fix ièm e fié c le a van t n otre ère
n ’e ft con n u lu i-m êm e q u e par des fragm ens.
S i q u e lq u e s-u n s d e ces écriv ain s o n t parlé
d es a rtiftes leu rs con tem p o ra in s, ces nom s fe
fo n t perdus a v e c leu rs o u vra ges : & cem m e
le s auteu rs d o n t il n o u s r e lie d es écrits com p
lets é ç r iv o ie n t dans des fiècles o ù les arts
é to ie n t p erfectio n n és, ils o n t été peu cu rieu x
d e re c u e illir le s nom s des a rtiflçs q ui n’avo ien t
c u ltiv é q u e des arts im parfaits. E n tre le s ou v
ra g e s a n cien s d o n t parle P a u fa n ia s, & dont
il n e n om m e pas le s a u teu rs, il en e ll peut-être
q u i ap partienn ent à ces fiècles fur lefq u els il
n e nous r e lie a u cu ne lum ière. N o u s Ibmtnes
o b lig és de fran ch ir d’un feu l pas c e tte gran de
la c u n e , & d e paffer au fep tièm e fiècle av^nt
n o tre ère.
(4) Rhoecus, paroît être le plus a n cien des
a rtiftes d on t le nom a it été c o n ferv é depuis
Je fièg e d e T r o ie . I l peut m êm e être fort
in tér ie u r au fep tièm e fiè c le a van t l’èrç v u lg
a ire : car P lin e d it q u’il floçiffoit lo n g -tem p s
a van t q u e le s B a cch ia d es fu flen t ch aflcs â g
C o r in th e , & l’exp u lfion d e c e tte fam ille fç
rapporte a l’an 662 avan t n otre ère. C et a r tillo
e to it d e Samos. I l fu t le . prem ier , fu ivan c
p a u fa n ia s, q u i fon d it l ’airain & en fit de®
lta tu es. P lin e ajou te qu ’il in v en ta l’art d e
m o d e le r , & c e tte affertion n e m an q u e pas d e
v ra ifem b la n ce. T a n t qu’on n e fit q u e de*
figu res im parfaites en b o is , ou m êm e en pierre*
on put a la rig u eu r fe paffer de m o d èle , &
trav ailler du prem ier cou p la m atière q u i d e -
v o it produire la flatu,e. M ais le prem ier q u i
jetta u n e fig u re en fo n te , fu t o b lig é d e com m
en cer par faire u n m o d è le , d’après le q u e l
il con ftru ifit fo n m o u le.
D u tem ps d e P a u fa n ia s, on v o y o it, au
tem p le d’E phèfe j u n e figu re d e fem m e qu’on
cro y o it être d e R h oe c u s, & qu ’on a p p elloit la
n u it. C e fla tu a ire étoit en m êm e tem ps a r c h i-
te é le -, il a v o it fa it à Samos le tem p le le plu*
v a fle q u e l’o n con n û t dans la G rèce au tem ps
d H érod ote.
(5 ) T hédore & T éléclés , fils de R hoe cus,'
m arch èren t fur les traces d e leu r p è r e ,: &
pour fe p erfeélio n n n er, ils paffèrent q u e lq u e
tem ps en E g y p te , & y ex ercèren t leu r a rt:
c’e ft un fait ren d u a u th e n tiq u e , fu iv a n t D io -
dore d e S ic ile , par le tém o ig n a g e des prêtre*
égy p tien s q u i le tro u v o ien t dans leu rs régiftres.
L es d eu x frèreé firen t à S am o s, pour le tem p le
d’A p o llo n P y th ie n , la fia tu e 8u D ie u , & il*
fu iv ir e n t, dans c e t o u v r a g e , u n e p ratique
fam ilière aux ftatu aires d e l’E g y p te ; c’e ft-à -
O T q u ’après avo ir pris leu rs proportions*
T é lé c lè s fit la m o itié d e la fig u re à Sam os ■
& T h éo d o re l’autre m o itié à E p h èfe. C e pro -
céd é n o u s m on tre q u el é to it l’état d e l’art
en E g v p te , car il fe r o it im p offib le d e l’em p
loy er dans u n e fig u re q u i au roit du m o u v em
en t ; m ais o n fen t q u ’il p o u v o it réuffir dan*
| d es fig u res d r o ite s, r o id e s , don t le s bras
éto ien t c o llés fur les flancs & les jam bes rapproch
ées l’u n e d e l’au tre. C’éfo it à produire
d e fem b lab les ftatu es q u e fe réd u ifoit l’art d e s
E g y p tie n s, &: c e lu i d es G recs n ’étoit pas plu»
avancé au tem ps des fils d e R h oe cu s. I l fem bl®
q u e le s ftatu aires d’E g y p te fe fo ie n t m o in s
propofé pour m od èle la n atu re v iv a n te & agiC»
fa n te , q u e l’attitu d e des m om ies.
Je n e crois pas qu ’on d o iv e con fo n d re a v e*
T h éo d ore fils d e R h oe cu s, le T h éo d ore don#
parle P lin e , & q u i é to it aufli d e Sam os. I l
) le n om m e dans un en d ro it où il n e paroit pas
faire m en tion d’artiftes q u i rem on ten t à un®
h au te a n tiq u ité. Il d it q u e T h éo d ore fit lu i-
m êm e f .n portrait en b ro n ze, q u e la reffem -
b la n ce éto it p a rfa ite, & qu’on adm iroit dan*
c e t o u vra ge la d élicateffe du trav ail. Je dout«*
q u e l ’an ciesi T h éo d ore eû t affe* d e précij^oft
$>our faire un portrait fort reffem b îan t, & d’a illeu
rs la d élicateffe du travail n e fem b le pas
être le ca ra â ère d’une a n tiq u ité fort reculée.*
C e tte ftatu e avo it u n e lim e dans la m ain droite ;
& d e trois d o ig ts d e la g a u c h e , e lle te n o it
un q u a d rig e fi p etit qu ’u n e m o u ch e cou vro it
de' fon a île le ch ar & le co ch er. P lin e ajoute
q u e l’auteu r d e c e t o u v ra g e é to it le m êm e
q u i avoic fait le la b y rin th e d e S am os: cette
circon ftan ce pourroit faire croire q u e c’e ft le
T h éo d ore fils d e R h oe cu s : car ce lab y rin th e
d e v o it être un éd ifice très-a n cien . Mais n e
p o u rroit-o n pas con jeéiu rer q u e P lin e, trompé
par le n o m , a fait un feu l artifte d e d eux
h om m es q u i o n t v écu dans d es tem ps fort
é lo ig n é s l’un de l’autre? C’e.fl u n e fau te dans
la q u e lle il v paroît être tom b é plus d ’une
fo is.
L ’an cien T h éo d ore éto it en m êm e tem ps jfta-
tuaire & a rc h ite& e , s’il e ft vrai qu’il ait fait,
à Samos un la b y rin th e. I l étoit aufli orfèv re
& gra veu r en pierres fin es. C’éto it lu i q ui
avoic gravé c e tte fam eu fe fardonyx- q u e P o ly -
c r a te , tyran de S am o s, jetta dans la m e r , &
q u ’il retrouva dans un poiffon don t un pécheur
lu i fit préfent. O n regard oît aufli com m e fon
o u vra ge u n e gran d e patere d’a rg en t d o n tC roe -
lu s a v o it fait préfent au tem p le de D elp h es.
(6) Dibutade. N o u s le p laçon s ici com m e
u n artifte fort a n c ie n , fan s avo ir d’ailleu rs
a u cu n m o yen d e fixer le tem ps où il v écu t.
I l éto it m o d e leu r , & P lin e racon te com m en t
il im ag in a d e faire des portraits en terre cu ite.
S a fille am oureufe d’un jeu n e hom m e q ui
a llo it partir pour un lo n g v o y a g e , s’a v ifa ,
p o u r charm er les tou rm ens d e l’ab fen ce , de
tracer fur la m u raille l’om bre d e fon amant.
D ib u ta d e adm irant la reffem b lan ce d e c e trait,
y appliqua de l’a rg ile q u ’il fit cu ire a v ec fes
a u tres o u vra ges. O n affuroit q u e ce m orceau
a v o it été con fervé à C o r in th e , dans le N ym -
p hoe um , jufqu’à la d eftru élion d e c e tte v ille
par M um m ius. D ib u ta d e crav ailloit à C o rin th e,
m ais il éto it n é à S ic y o n e .
(y) E uchir d e C o rin th e v iv o it dans la
tren te-n eu v ièm e O lym p iad e , 663 ans • avant
n o tre ère , p u ifq u e ce tte a n n é e , il accom pag
n a en E tr u r ie , D ém ara tu s, père de T a rq u in
l ’an cien . P lin e , q u i nous apprend c e tte c ir -
c o n fla n c e , ajou te q u ’il éto it m o d eleu r & q u e
c e fuc lu i q u i apporta l’art d e m o d eler en
I ta lie . Si ce fa it étoit v r a i, on n’a vo it p a s,
a va n t l’arrivée d’E u c h ir , fu faire des ftatues
d e bronze dans c e tte con trée. L e m êm e écriv
ain lu i accord e a illeu rs le m érite d’avo ir
xéufli à repréfenter d es a th lè te s, des hom m es
a rm és, des ch affeu rs. I l ièro it fin g u lier qu ’un
a r tifte , q u i yiyoit lo n g -tem p s ayan t la per-
1 fe& îofl d e l’a r t, eû t repréfenté a v e c u n fuccèa
| rem arq u ab le des fig u res q u i e x ig e n t du m o u - Îv em e n t. C ela e ft b ien é lo ig n é des fig u res
roijdes q u e fa ifo ie n t T h é o d o r e & T é lé c lè s q u i
I d é v o ien t être à -p eu -p rès con tem p o ra in s d’E u -
' ch ir. M ais je crois certain q u ’il y a e u p lu -
fiéurs ftatu aires d e c e n o m , & q u é l’a n c ie n
E u ch ir d o n t p arle P lin e dans un e n d r o it,
n ’e fl pas le m êm e d o n t il célèb re dans un
a u tre , le s fu ccès pour le s fig u res d e m o u v em
en t. C’étoic d e l’a n cien E u c h ir , on p e u t-
être en core d’un au tre E u ch ir d ifferen t d es
d eu x q u e nous v en o n s d e d iftin g u e r , q u e
parloit A r ifto te , qu ’il rega rd oît com m e un
- con fin d e D é d a le , & à qui il a ttrib u o it l’in v
en tio n d e la peinture dans la G rèce.,
L’E u ch ir q u i réufliffoït à faire des a th lètes
p o u v o it être le m êm e q u i é to it né à A th èn es,
fu iva n t ■ P a u fa n ia s, & q u i a v o it fa it pour les
P h én éa tes, en A rca d ie., u n e ftatu e en m arbre
d e M ercu re. I l éto it différent d’un E u ch iru s
d e C o rin th e , d on t parle le m êm e a u teu r , &
q u i fu t m aître de C léarq u e d e R h égium .
L’E u ch ir q u i v in t en Ita lie a v ec D ém aratus
é to it accom p agn é d’E u gram m u s, fon com patr
io te , & m o d eleu r com m e lu i.
(8) M a l a s , d e l’U e d e C h io ; n e p e u t-ê tr e
placé à u n e ép oq u e plus recu lée q u e la fin d u
fep tièm e fié c le a va n t n otre è r e , p u ifq u e fes
a rrière-p etits-fils v iv o ie n t dans la fo ix a n tièm e
o lym p iad e , 5 40 ans a van t J. C . O n n e co n n o ît
d e lu i q u e fon n o m , & l’on n e fait rien d e
plus fur Micciadc, fon f ils , m ais o n v o y o it
des ftatu es d7 Antherme, fon p e tit-fils, à D é lo s
& dans l’île de L efb os. P lin e o b ferv e q u e tou s
ces artiftes éto ien t plus a n cien s q u e D ipoe n u s
& S c y llis. A n th erm e eu t pour fils B upalus &
A th en is d o n t n ou s parlerons b ien tô t.
(9) Dédale de S y c y o n e , e ft m is au n om b re de*
artiftes d’u n e h a u te a n tiq u ité. I l e ft aifé d e
m arquer à peu-près fon â g e , fi c’e ft à c e D éd a le
q u e Paufanias d o n n e pour fils D ip oe n u s &
S’c y llis q u i v iv o ie n t dans la cin q u a n tièm e o ly m -
p ia p e, j8ç> ans avan t n otre è r e , fu iva n t P lin e .
E n le fuppofant â gé d e tren te ans p lu s q u s
fes fils , îl au roit fleu ri 6 10 ans avanc
J. C .
(10 ) D ipoe n u s , & Sc y l l is fon frère éto ien s
>de C rète. Ils fleu riren t avan t le règ n e d e C y -
rus fur les P erfes vers la cin q u an tièm e o ly m p
iad e. L es uns c r o y o ie n t qu ’ils é to ie n t é lè v e s
d e D éd a le & les a u tres'q u ’ils éto ie n t fes fils.
M ais d e q u el D éd a le v o u lo ie n t-ils parler ?
E to it-ce c e lu i d e S ic y o n e ? C e D éd a le fit-il
un lo n g féjour en C rète? N ’e ft-il pas plus
v ra ilèm b la b le q u e -les a n c ie n s , q u i faifoien s
fou v en t p eu d’a tten tio n à la c h r o n o lo g ie , fgg