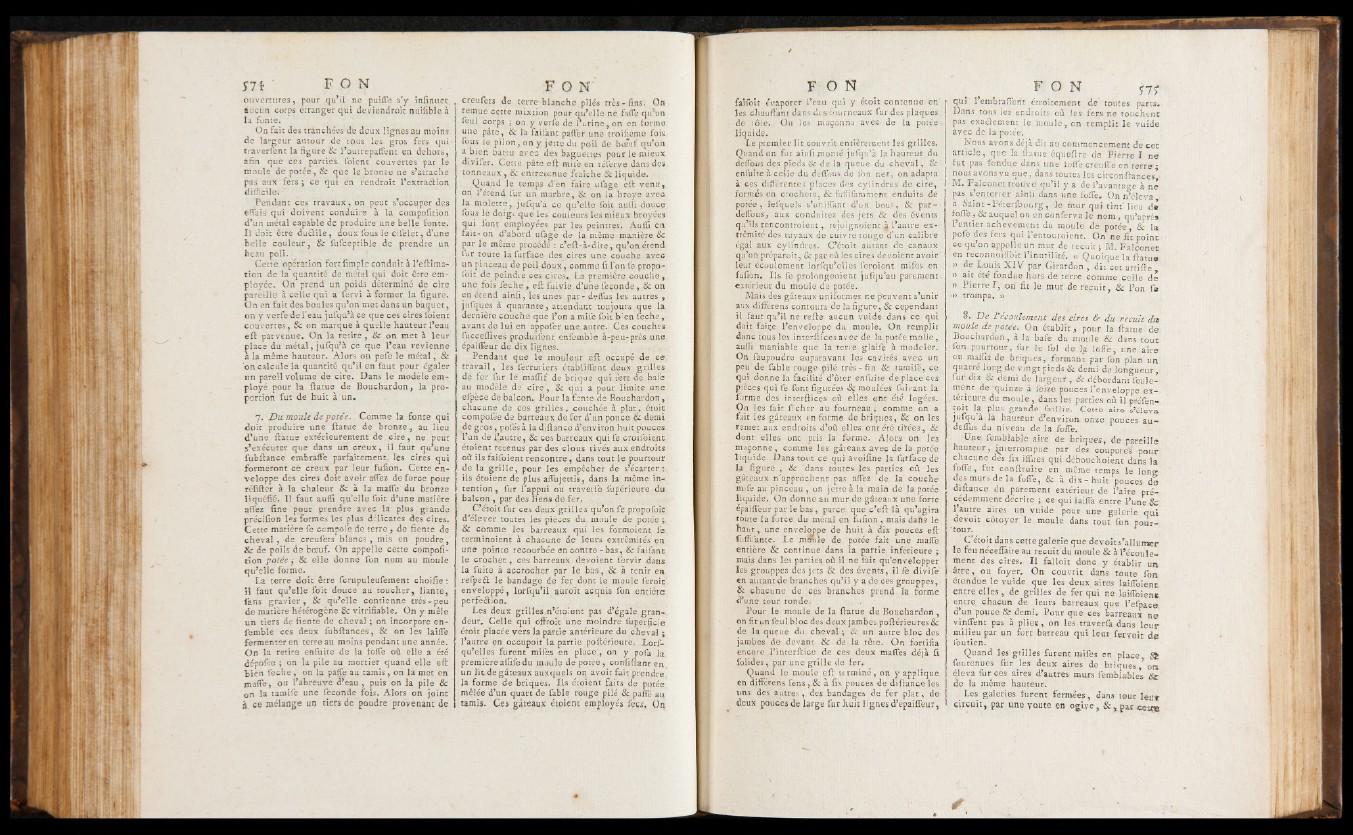
o u v e r tu r e s , pour qu’il n e puifTe s-y infirmer
a ucun corps etranger q u i d ev ien d ro it n u ifib le à
la fo n te.
O n fait d es trln ch ées-d e d eu x lig n e s au m oin s
d e largeu r autour de to u s le s gros fers qui -
trav erlen t la fig u re 8c l’autrepaffent en d eh o rs,
afin q u e ces parties, fo ien t cou vertes par le
m o u le d e p o té e , & q u e le bronze n e s’atta ch e
pas aux fers ; ce q u i en rénd roit l’extra& ion
difficile:
P en d an t ces tr a v a u x , on p eu t s’o ccu p er d es
é fiais q u i d o iv e n t con d u ire à la com pofition
d’un m étal capable d e produire u n e b e lle fo n te.
Il d o it être d u c tile , doux fous le c ife le t, d’une
b e lle c o u le u r , & fu fcep tib le d e pren d re un
beau p o li. ■ .
Cette op ération fort fim pie con d u it à l’éftim a-
tio n d e la quan tité de m étal q u i d o it être em p
lo y é e. O n prend un poids d éterm iné d e cire
p a reille à c e lle q u i a ferv i à form er la fig u re.
O n en fait des b o u les q u’on m et dans un b a q u e t,
o n y v erfe de l’eau jufq u’à c e q u e ces cires foien t
c o u v e r te s, & on m arque à q u e lle hauteur l’eau
e ft p a rven u e. O n la retire , & on m et à leu r
p la ce du m é ta l, ju fq u ’à c e q u e l’eau r ev ien n e
a la m êm e h auteu r. A lors on pefe le m é ta l, &
'on c a lc u le la q uan tité qu’il en fau t pour éga ler
u n pareil v o lum e d e cir e . D a n s le m o d èle em p
lo y é pour la ftatu e de B o u ch a rd o n , la proportion
fu t de h u it à u n . 7
creu fets d e terre b la n ch e p ilés tr è s-fin s. Oit
rem ue ce tte m ix tio n pour qu’e lle n e faffe q u ’un
feu l corps ; on y v erfe.d e l’u r in e , on en form e
u n e p â te, 8c la faifan t palier une troifièm e fois
lou s le p ilo n , on y jette du p o il d e b oe u f qu ’o n
a b ien battu a v ec des b a gu ettes pour le m ieu x
d iv ifer. C ette pâte e ft m ile en réferve dans des,
ton n eau x , & en treten u e fraîch e & liq u id e .
Q uand le tem ps d ’en faire u fage e ft v e n u ,
on l’écènd fur un m arb re, & on la B ro y é a v e c
la m o le tte , ju fq u ’à ce qu’e lle foie aufii d ou ce
lou s le d o ig e q u e les cou leu rs les m ieu x broyées
q u i fon t em p lo yées par les p eintres. A ufii en
fa it- on d’abord u fage d e la m êm e m anière 8c
par le m êm e procédé : c’e ft-à -d ir e , qu’on éten d
iu r tou te la furface des cires u n e co u ch e a vec
un pinceau d e poil d o u x , com m e fi l’on fie propo-
lbic d e peindre ces c ir e s. La prem ière c o u c h e ,
u n e fois fe c h e , eft fui v ie d’une fé c o n d é , & on
en éten d a in fi, les u n es par - défias les autres ,
ju fq u es à q u a ra n te, attend ant tou jours q u e la
de rnière c o u ch e q u e l’on a m ile foit b :en fe c h e ,
avan t d e lu i en appofer u n e autre. C es cou ch es
lu ccefiiv es prod u ifen t en fem b ie à-p eu -près u n e
épaiffeur d e d ix lig n e s.
P en d an t q u e le m ou leu r e ft occu p é d e ce
tr a v a il, le s ferruriers étab liffen t d eux g r ille s
de fer fur le m a flif de b riq u é q u i îert d e bafe
au m o d èle d e c ire , 8c q u i a pour lim ite une
efp èce d e b alcon . P ou r la fen te d e B ouchardon ,
ch a cu n e d e ces g r ille s , cou ch ée à p la t, étoit
com p ofée d e barreaux d e fer d’un p ou ce & dem i
d e g r o s , pôles à la d iftan ce d’en viron h u it.p ou ces
l’un de l’a u tre, & ces barreaux q u i fe croifioie„nc
i éto ien t retenus par des c lo u s rivés aux en d roits
où ils fa ifo ien t r e n c o n tr e , dans tou t le pourtour
d e la g r ille , pour les em p êch er d e s’écarter :
ils éto ie n t d e plus affu jettis, dans la m êm e in ten
7 . D u moule de potée. C om m e la fo n te q ui
.d oit produire u n e ftatu e de b r o n z e , au lieu
d’une ftatu e ex térieu rem en t d e c ir e , n e peut
s’exécu ter q u e dans un c r e u x , il fau t q u ’une
fu b fta n ce embraffe parfaitem ent les cires q ui
form eron t c e creu x par leu r fu fio n . C ette e n - ,
v elo p p e des cires d o it avo ir aflez d e fo rce pour
réfifter à la ch a leu r & à la maffe du bronze
liq u éfié. Il fau t aufii qu’e lle foit d'u n e m atière
aflez fin e pour prendre a v e c la plus gran d e
précifion le s Formes le s plus d élica tes des cires.
C ette m atière fe com pofe de terre , de fien te de
c h e v a l, de creu fets b lan cs , m is en p o u d re,
& de p o ils d e b oe u f. O n a p p elle c e tte com pofitio
n potée j & e lle d onn e fon nom. au m o u le
q u ’e lle form e.
La terre d o it être fcru p u leu fem en t ch o ifie :
il fau t qu’e lle fo it d o u ce au to u c h e r , lia n te ,
fans g r a v ie r , & qu’e lle co n tien n e tr è s-p e u
d e m atière h étérog èn e & vitrifiable» O n y m êle
u n tiers de fie n te de ch ev a l ; on in corp ore en -
fem b le ces d eux fu b fta n c e s, & on le s laiffe
ferm en ter en terre au m oin s pendant une année.
O n la retire en fu ite d e la foffe où e lle a été
dépofée ; on la p ile au m ortier q uand e lle e ft
b ie n f e c h e , on la pafle au tam is , on la m et en
m a ffe, o u l’a b reu ve d’eau , puis on la p ile &
o n la taroife un e fécon d é fo is. A lors on jo in t
à c e m éla n g e un tiers de poudre p roven an t de
tio n , fur l’appui ou traverfe fupérieüre du
b a lco n , par des lie n s d e fer.
C ’étoic fur ces d eux g r ille s qu’on fe propofoic
d’élev er tou tes les p ièces du. m o u le d e potée ;
& com m e le s barreaux q u i les form oien c fe.
term in o ien t à ch a cu n e d e leu rs extrém ités en
u n e p oin te recourbée en c o n tr e -b a s , & failà n t
le c r o c h e t, ces barreaux d é v o ien t feryir dans
• la fu ite à accro ch er par le b a s , & à tenir en
refp eél le b an d age de fer d on t le m o u le feroit
en v elo p p é , lorfq u ’il 3,11 roit a cq u is fon en tière
perfection .
L es d eux griljes^n’étoien t pas d’é g a le grand
eur. C e lle q u i offroit u n e m oin d re fuperficie
éto it placée v er s la partie an térieu re du ch ev a l ;
l ’autre en o ccu p oit la partie poftérieure. L orf-
qu’e lle s fu ren t m ifes en place:, on y pofa la
prem ière affile du m o u le d e p o tçe , con fiftan t en
un l it d e g âteau x au xq u els on a v o it fait prendre,
la form e d e b riq u es. I ls éroient faits d e pQtée
m êlée d’un quart de fab le rou ge p ilé & pafie au
tam is. C es g âteau # éto ien t em p loyés fecs, O n
faifoït évaporer l’eau, q ui y é to it co n ten u e en
les chauffant dàr.s des-fourneaux fur des plaqués
de tô le. O n les m açonna avec- de la p o tée,
liq u id e.
Le prem ier lit cou vrit .entièrem ent lés g rille s.
Q uand on fut ainfi m on té jufqu’à la hauteur du
deffous d es pieds 8c de la q u eu e du c h e v a l, &
enfuite à .c e lle du deffous de fon n e z , o n adapta
à ces differentes p la ces d es cy lin d res d e c ir e ,
form és en c r o c h e ts, 8c fuffifamment en d u its de
p o rée, lefq u els s’unifiant d’urr bout , 8c p a r-
d effou s, aux con d u ites des jets & des éven ts
qu ’ils r e n co n tro ien t, rejoign oien c | l’autre e x - *
trêm ité des tuyaux d e cu ivre rou ge d’un calib re
égal aux cy lin d res. C ’é to it autant de can au x
qu’on préparoit, & par où les cires d év o ien t a vo ir
leu r éco u lem en t lorfqu’e lle s fero ien t m ifes en
fufion. Ils fe p ro lo n g eo ien t ju fq u ’au parem ent,
extérieur du m o u le d e potée.
M ais des gâteau x uniform es n e p eu ven t s’unir
aux différens con tours d e la fig u re, & cependant
il faut q u ’il n e refte aucun vu id e dans c e qui
d o it faii;e l’en v elop p e du m o u le. O n rem p lit
d on c tou s les in terftices a v ec de la potée m o lle ,
aufii m aniable q u e la terre glaifie à m o d eler.
O n faupoudre auparavant le s ca v ités a v ec un
peu d e fa b le rou ge p ilé tr è s-fin & tam ifé, ce
q ui d onne la facilité d ’ôter en fu ite d e p lace ces
p ièces q ui fe fon t figurées & m ou lées fu ivan t la
form e des in terftices où e lle s o n t été lo g ées.
O n les fait fic h e r au fo u rn ea u , com m e on a
fait le s gâteau x en form e de b riq u es, & on les
rem et .aux en d roits d’où e lle s o n t été tité e s , &
d o n t e lle s o n t pris la form e. A lors on les
m a ç o n n e , com m e les gâteau x a vec de la potée
liq u id e . D an s tou t ce q u i avoifin e la furface de
la fig u re , & dans tou tes le s parties où les
g â tea u x n ’approchent pas affez d e la c o u ch e
m ife au pinceau , on jette à la m ain d e la potée
liq u id e. O n d o n n e au mur d e g âteau x u n e forte
épaifleur par le bas , parce q u e c’e ft là qu’agira
tou te la force du m étal en fufion , m ais dafts le
h a u t, une en v elop p e d e h u it à dix p ou ces eft
fuffifiante. L e m o u le d e potée fa it u n e maffe
en tière & con tin u e dans la partie in férieu re ;
mais dans les parties où il n e fait qu ’en velop p er
les grouppes des jets & d es é v e n ts , il fe d iv ife
en autant de branches qu ’il y a de ces g ro u p p es,
& ch a cu n e d e ces b ran ch es prend la form e
d’une tour ron de.
Pour le m o u le d e la ftatu e d e B o u ch a rd o n ,
on fit un feu l b loc des deux jam bes p oftérieures &
de la q u eu e du ch ev a l ; & un autre b loc des
jam bes de d evan t & de la tête. O n fortifia
encore l’in terftice de ces d eux maffes déjà fi
fo lid es, par u n e g r ille de fer.
Q uand le .m o u le e ft te rm in é, on y applique
en différens fiens, & à fix pouces de d ifta n ce les
uns des a u tre s, d es bandages de fer p la t, d e
d eux pouces de la r g e fur h u it lig n e s d’épaiffeur%
q u i l’em braflènt étroitem en t de tou tes parts«.
D a n s tou s les en d roits où les fers n e to u ch e n t
pas exa ctem en t le m o u le , on rem p lit le v u id e
a vec de la potée'.
N o u s a vo n s déjà, dît au com m en cem en t d e c e t
a r tic le , q u e -la ftatu e éq u eftre de P ierre I n e
fu t pas fo n d u e dans u n e lo fie creu fee en terre ;
nous avon s vu q u e , dans tou tes le s circo n fta n ces •
M . F a lc o n e t tr o u v é qu ’il y a d e l’ava n tag e à n e
pas s’enterrer ain fi dans u n e foffe. O n n ’élev a
à S a in t-P é te r fb o n r g , le m ur q u i tin t lieu d®
fo fle , & au q u el on en con ferv a l e n o m , qu ’après
l ’en tier a ch èv em en t du m o u le d e p o té e , & la
p ofe d es fers q u i l ’en tou roien t. O n n e fit p o in t
c e q u ’on ap p elle un mur de recu it 5 M . F a lc o n e t
en recon n oiffo it l’in u tilité . « Q u o iq u e la fta tu e
» d e L ou is X I V par G irardon , d it c e t artifte
» a it été fon d u e hors d e terre com m e c e lle d e
» P ierre I , on' fit le m ur d e r e c u it, .& l’o n fe
*» trompa» »
8 . De Vécoulement des cires & du recuit dit
moule de potée. O n é t a b lit , pour la ftatu e d e
B o u ch a rd o n , à la bafe du m o u le & dans to u t
fon pou rtou r, fur le fol d e la fo ffe , u n e a ire
ou m affif d e b riq u es, form anc par fon plan un
quarré lo n g d e v in g t pieds & d em i d e lo n g u e u r ,
fur d ix & d em i d e largeu r , & débordant feu lem
en t d e 'q u in z e à feize pouces l ’en v elop p e e x térieure
du m o u le , dans les parties où il préfen-
to it la plus gran d e fa illie . C ette aire s’é le v a
ju fq u ’à la hauteur d’en v iro n o n ze p ou ces a u -
' defius du n ivea u d e la foffe.
U n e. fem b lab le a ire de b riq u es, d e p a reille
h a u teu r, in terrom p u e par des cou pures p our
ch a cu n e des fix ifines q u i d éb o u ch o ien t dans la
fo ffe , fu t co n ftru ite en m êm e tem ps le lo n g
des murs d e la fo ffe, & à d ix - h u it p ou ces d e
d ifta n ce du p arem en t extérieu r d e l ’aire précéd
em m en t d écrite ce q u i laiffa en tre l’une &
l ’autre aires un v u id e pour u n e g a ler ie q u i
d evoir cô to y er le m o u le dans tou t fon pourto
u r . r
C ’étoit dans c e tte g a ler ie q u e d e v o its ’a llu ioe r
le feu n éceflàire au recu it du m o u le & à l’éc o u le m
e n t d es cires. I l fa llo ir d on c y étab lir u n
'â c r e , ou fo y er. On- c o u v rit dans to u te fon
éten d u e le v u id e q u e le s d eu x aires la iffo ien t
en tre e ll e s , d e g r ille s d e fer q ui n e la iffo ie n t
en tre ch a cu n d e leu rs barreaux q u e l ’efp ace
d’un p ou ce & d em i. P o u r q u e ces barreaux n e
vin ffen t pas à p lie r , on le s traverfa dans le u r
m ilie u par un fo rt barreau q u i leu r fer v o it d e
lo u tien .
Q uand les g r ille s fu ren t m ifes en p lace
fou ten u es fur les d eu x aires d e b riq u es * o n
é lev a fur c e s aires d’autres m urs femblables-
d e la m êm e h au teu r.
L es g aleries fu ren t fe rm é e s, dans tou t le ii*
c ir c u it, par u n e v o û te en o g i v e , & x gar cesc®