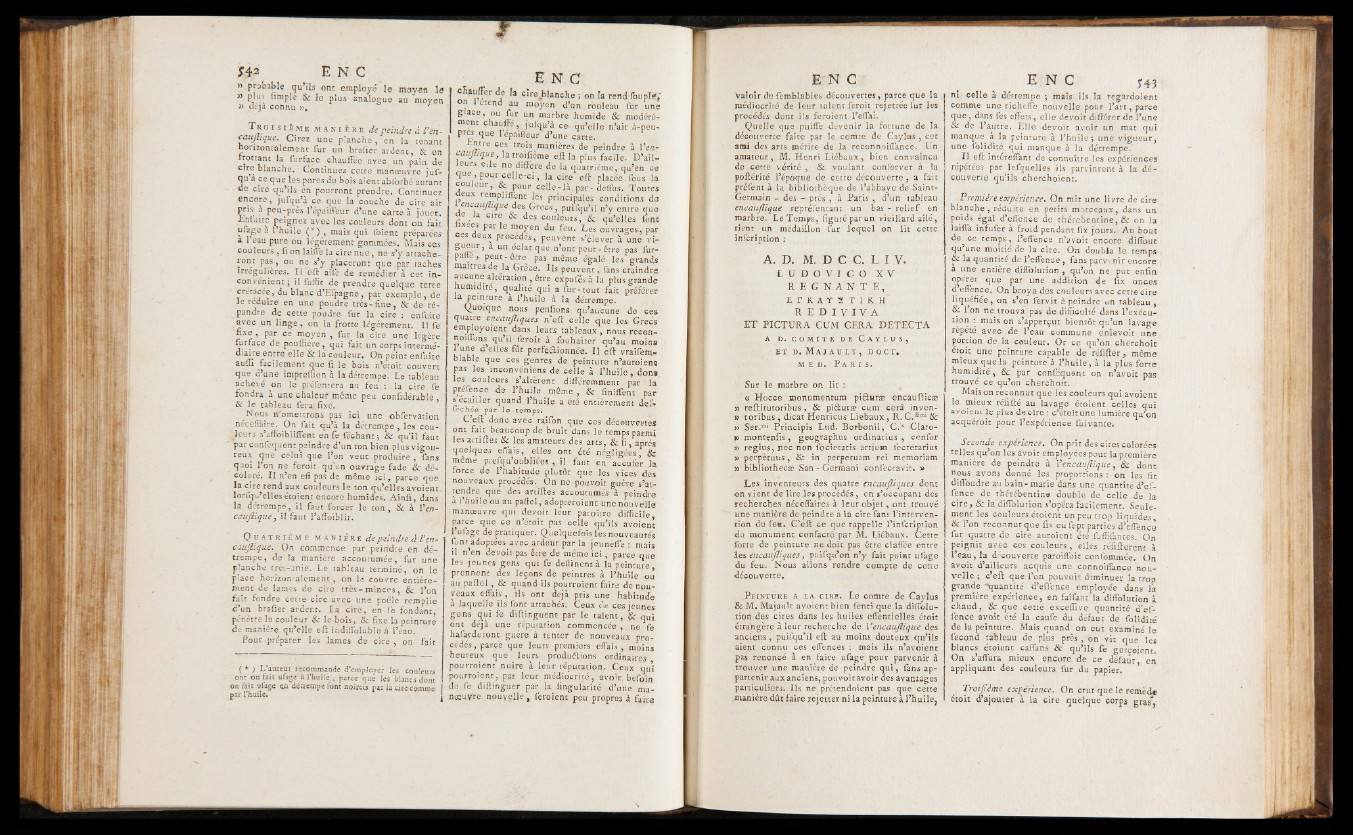
5 42 E N C
» probable qu’ ils ont employé le moyen le
J3 plus fimplé & le plus analogue au moyen
» déjà connu ».
T r ° i s i è m e m a n i è r e de peindre à Ten-
cauftique. Cirez une planche, en la tenant
horizontalemenc fur un brader ardent, & en
trottant la furfaçe chauffée avec un pain de
erre blanche. Continuez cette'manoeuvre juf-
qu à ce que les pores du bois aient abforbé autant
de cire qu’ils en pourront prendre. Continuez
encore, jufqu’ à ce que la couche de cire ait
pm a-peu-près l’épaiffeur d’ une carte à jouer.
Enluitê peigniez avec les couleurs dont on fait
ufage a l’huile (* ) , mais qui foi en c préparées a l’eau pure ou légèrement gommées. Mais ces
couleurs, fi on laiffe la cire nue, ne s’y attache-
lont pas, ou ne s’y placeront que par taches
irrégulières. Il eft aifé de remédier à cet inconvénient;
il fuffit de prendre quelque terre
crétacée, du blanc d’Efpagne, par exemple , de
le réduire en une poudre très-fine, & de répandre
de cette poudre fur la cire : enfuite
avec un lin g e , on la frotte légèrement. Il fe
f ix e , par ce moyen , fur la cire une' légère '
furface de poulîière, qui fait un corps intermédiaire
entre elle & la couleur. On peint enfuite
auffi facilement que fi le bois n’étoit couvert
que d’une impreflion à la détrempe. Le tableau
achevé on le préfentera au feu : la cire fe
fondra à une chaleur même peu confidérable
6 le tableau fera, fixé.
Nous ri’omettrons pas ici une observation
néceffaire. On fait qu’à la détrempe , les couleurs
s’affoibliffent en fe féchant -, & qu’il faut
par conféquent peindre d’un ton bien plus vigoureux
que celui que l’on veut produire , fans
quoi l’on ne feroit qu’un ouvrage fade & décoloré.
I l n’en eft pas de même i c i , parce que
la cire rend aux couleurs le ton qu’ elles avoient.
lorfqu’ eîles ëtoient encore humides. Ainfi, dans
la détrempe, il faut forcer le ton, & à Ven-
c a u f i iq u e , il faut l ’affoiblir.
Q u a t r i è m e m a n i è r e peindre 4 l ’en-
caujlique. On commence par peindre en détrempe,
de la manière accoutumée, fur une
planche très-unie. Le tableau terminé, on le
place horizontalement, on le couvre entièrement
de lames de cire très-minces, & l ’on
fait fondre cette cire avec ur.e poêle remplie
d’un brafier arder.r. La cire, en fe fondant,
pénètre la couleur & le bois, & fixe la peinture
de manière qu’ elle eft indiffoluble à l’eau.
Pour.préparer les lames de c ir e , on fait
( * J L ’auteur recommande d’employer les couleurs
ont on fait ufage à l’huile , parce que les blancs dont
on fait ufage en détrempe font noircis par la cire comme
par l’huile.
E N C
cfiauffer do la cire^blanche ; on la rend fouplrf:
on etend au moyen d’un rouleau fur une
g ace, ou fur un marbre humide & modérément
chauffé, jufqu’à ce- qu’ elle n’ait à-peu-
pres que lepaiflèur d’une carte.
ntre ces trois manières de peindre à l ’e/t-
caujüque, la troifième eft la plus facile. D’ail-
eurs elle ne diffère de la quatrième, qu’en ce
q u e , pour ce lle -c i, la cire eft placée fous la
couleur, & pour celle-là par - deffus. Toutes
; ,,eux r®oipliffent lès principales conditions de
1 encaujîique des Grecs, pui(qu’ il n’y entre que
de la cire & des couleurs, & qu’elles font
iixees par le moyen du feu. Les ouvrages, par
ces deux procédés, peuvent s’élever à une vi-
gueur, a un éclat que n’ont peut - être pas fur-
pa e , peut - être pas même égalé les grands
maîtres de la Grèce. Ils peuvent, fans craindre
aucune altération, être expofés à la plus grande
humidité, qualité qui a fur-tout fait préférer
la peinture à l’huile à la détrempe.
Quoique nous penfions qu’ aucune de ces
quatre encaufiiques n'eft celle que les Grecs
emPjoy ° îenc ^ans leurs tableaux, nous reeon-
noiffons qu’ il feroit à fou haicer qu’au moins 1 une d elles fût perfeftionnée. Il eft vraifem-
blable que ces genres de peinture n’auroien*
pas les inconvéniens de/celle à l’h u ile , don»
les couleurs s’altèrent différemment par la
P>r,e^e.nce même, & finiffenc par
s écailler quand l’huile a été entièrement de,G*
féchée par le temps.
C’eft donc avec raifon que ces découverte»
ont fait beaucoup de bruit dans le temps parmi
lesartiftes & les amateurs des arts, & fi,ap rè s
quelques effais, elles ont été négligées, &
même prelqu’oubliées , il faut en accufer la
force de l ’habitude plutôt que les vices des
nouveaux procédés. On ne pouvoït guère s’attendre
que des artiftes accoutumés à peindre
à l’huile ou au paftel, adopteraient une nouvelle
manoeuvre qui devoir leur paraître difficile
parce que ce n’étoit pas celle qu’ils avoient
* l’ufage de pratiquer. Quelquefois les nouveautés
font adoptées avec ardeur par la jeuneffe : mais
il n’en devoir pas être de même i c i , parce que
les jeunes gens qui fe deftinentà la peinture
prennent des leçons de peintres à l ’huile ou
au paftel, & quand ils pourroient faire de npu-
veaux effais, ils ont déjà pris une habitude
à laquelle ils font attachés. Ceux c3« ces jeunes
gens qui fe distinguent par le talent, &: qU;
ont déjà une réputation commencée, ne fe
hafarderont guère à tenter de nouveaux procédés
, parce que leurs premiers effais , moins
■ heureux que leurs productions ordinaires
pourroient nuire à leur réputation. Ceux qui
pourroient, par leur médiocrité, avoir, befoin
de fe diftinguer par la Angularité d’une manoeuvre
nouyçlle, feroient peu propres à faire
E N C '
Valoir de femblables découvertes, parce que la
médiocrité de leur talent feroit rejettée fur les
procédés dont ils feroient l’ effaî.
Quelle que puiffe devenir la fortune de la
découverte faîte par le comte de Caylus , cet
ami des arts mérite de la reconnoiffance. Un
amateur, M. Henri Liébaux, bien convaincu
de cette vérité , & voulant conferver à la
poftérité l’époque de cette découverte , a fait
préfent à la bibliothèque de l’abbaye de Saint-
Germain - des - prés , à Paris , d’un tableau
encaujîique repréfentant un bas - relief en
marbre. Le Temps, figuré par un vieillard ailé,
tient un médaillon fur lequel on lit cette
infeription ;
A. D. M. D C C. L I V.
L U D O V I C O X V
R E G N A N T E ,
E r K A T 2 T I K H
R E D I V I V A
ET PICTURA CUM GERA DE TE C TA
A D . C O M I T E D E C A Y I U S ,
E T D . M a J A U L T , D O C T ,
m e d . P a r i s .
Sur le marbre on lit :
« Hocce xnonumentum piéluræ encaufticæ
» reftitutoribus, & piâuræ cum cerâ inven-
» toribus , dicat Henricus Liebaux, R. C .ffiml &
» Ser.oei Principis Lud. Borbonii, C .1S Claro-
» montenfis, geographus ordinarius , cenfor
» regius, nec non focietatîs artium lecretarius
» perpêtuus, & in perpetuam rei memoriam
» bibliothecæ San - Germani confecravit. »
Les inventeurs des quatre encaufiiques dont
on vient de lire les procédés, en s’occupant des
recherches néceffaires à leur ob jet, ont trouvé
une manière de peindre à la cire fans l’intervention
du fe«. C’ eft ce que rappelle l’infcrîption
du monument confacré par M. Liébaux. Cette
forte de peinture ne doit pas être claffée entre
les encaufiiques, puifqu’on n’y fait point ufage
du feu. Nous allons rendre compte de cette
découverte.
P e i n t u r e a l a c i r e . Le comte de Caylus
& M. Majauît avoient bien fenti que la diffolu-
tion des cires dans les huiles effentielles étoit
étrangère à leur recherche de Vencaujîique des
anciens , puifqu’ il eft au moins douteux qu’ ils
aient connu ces effences : mais ils n’avoient
pas renoncé à en faire ufage pour parvenir à
trouver une manière de peindre q ui, (ans appartenir
aux anciens, pouvoir avoir des avantages
particuliers. Ils ne prétendoient pas que cette
manière dût faire rejetter ni la peinture a l’huile,
E N C ^43
nî celle à détrempe ; mais ils la regardoient
comme une richeffe nouvelle pour l ’arc, parce
que, dans fes effets, elle devoit différer de l’ une
& de .l’autre. Elle dévoie avoir un mat qui
manque à la peinture à l ’h u ile ; une vigueur,
une lblidité qui manque à la détrempe.
eft intéreffant de connoître les expériences
répétées par lefquelles ils parvinrent à la découverte
qu’ils cherchoient.
Première expérience. On mit une livre de cire
blanche, réduite en petits morceaux, dans un
poids égal d’effence de thérebentine, & on la
laiffa infufer a froid pendant fix jours. Au bout
de ce temps, l’effence n’a voit encore diffout
qu une moitié de la cire. On doubla le temps
& la quantité de l ’effence, fans parvenir encore
a une entière diflolution , qu’on ne put enfin
opérer que par une addition de fix onces
d effence. On broya des couleurs avec cette cire
liquéfiée, on s’ en fervit à peindre un tableau,
& l’on ne trouva pas de difficulté dans l’exécu-
tioi3 | mais on s’apperçut bientôt qu’ un lavage
répété avec de l ’eau commune enlevoit une
portion de la couleur. Or ce qu’on cherchoit
étoit une peinture capable de réfifter, même
mieux que la peinture à l’huile, à la plus forte
humidité, & par conféquent on n’avoit pas
trouvé ce qu’on cherchoit.
Mais on reconnut que les couleurs qui avoient
le mieux réfifté au lavage étoient celles qui
avoient le plus de cire : c’étoitune lumière qu’on
acquéroit pour l’expérience fuivante.
Seconde expérience. On prit des cires colorées
telles qu’on les avoir employées pour la première
manière de peindre à l’ encaujîique, & donc
nous avons donné les proportions : on les fie
diffoudre au bain-marie dans une quantité d’effence
de thérébentine double de celle de la
cire * & la diffolurion s’opéra facilement. Seulement
les couleurs étoient un peu trop liquides
& l’on reconnut que fix ou fept parties d’effence
fur quatre de cire auroient été fuffifantes. On
peignit avec ces couleurs, elles réfifterent à
l ’eau, la decouverte paroiffoit confommée. On
avoit d’ailleurs acquis une connoiffance nouv
e lle ; c’eft que l’on pouvoir diminuer la trop
grande Quantité d’ effence employée dans la
première expérience, en faifant la diffolution à
chaud, & que cette excëffive quantité d’effence
avoit été la çaufe du défaut de folidité
de la peinture. Mais quand on eut examiné le
fécond tableau de plus près, on vit que les
blancs étoient caffans & qu’ ils fe gerçoient.
On s’affura mieux encore de ce défaut, en
appliquant des couleurs fur du papier.
Troifième expérience. On crut que le remèd«
étoit d’ajouter à la cire quelque corps gras*,