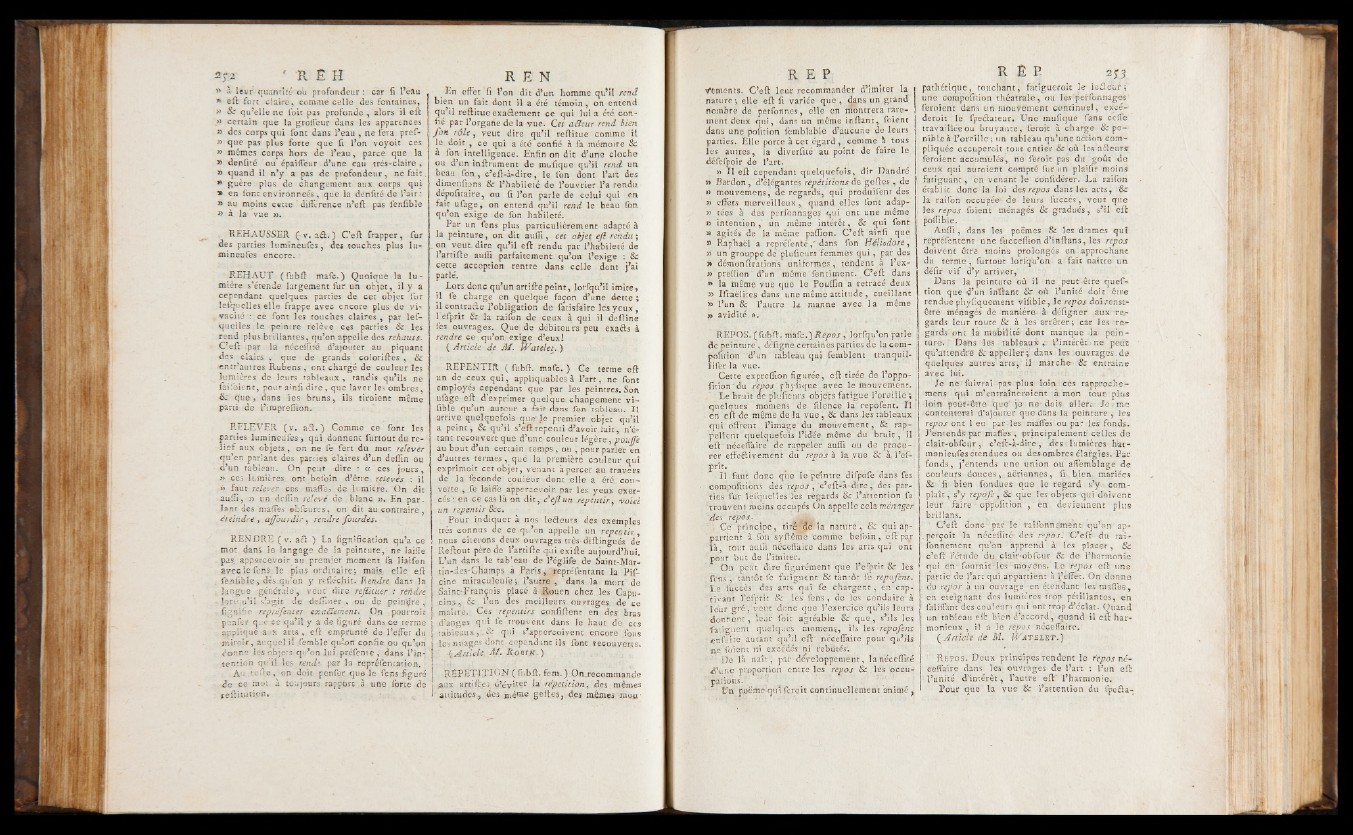
2 p " R E H
» u-leur quantité ou profondeur: car fi l’eau
* eft fort claire, comme celle des fontaines,
» & qu’elle ne l'oit pas profonde , alors il eft
» certain que la grotfeur dans les apparences
» des corps qui font dans l’eau , ne fera, pref-
» que pas plus forte que fi l’on voyoit ces
» mêmes corps hors de l’ eau, parce que la
» denfité ou épaifleur d’une eau très-claire ,
» quand il n’y a pas de profondeur, ne fa itN
* guère plus de changement aux corps qui
» en l'ont environnées, que la denfité de l’air.*
» au mbins cette différence n’eft pas fenfible
» à. la vue ».
REHAUSSER ( v. a d .) C’eft frapper, fur
des parties lumineufes, des touches plus lu-,
mineufes encore.
REHAUT ( fubft. mafc.) Quoique la lu mière
s’étende largement fur un objet, il y a
cependant quelques parties de cet objet fur
lefquelles elle frappe avec encore plus de v ivacité
: ce font les touches c la ires , par lef-
q u elles .le peintre relève ces parties & les
rend plus brillantes, qu’ on appelle des rehauts.
C ’eft par la néceflité d’ajouter au piquant
des clairs , que de grands coloriftes , &
entr’autres Rubens , ont chargé de couleur les
lumières de leurs tableaux , tandis qu’ ils ne
fàifoient, pour ainfi d ire, que laver les ombres,
&: q u e , dans les bruns, ils tiroient même
parti de l’ iropreflion.
RELEVER ( v . acl. ) Comme ce font les
parties lumineufes, qui.donnent furtout du r e - ;
l i e f aux objets., on ne fe fert du mot relever
qu’en parlant des parties claires d’ un deflin ou
d’un tableau. On peut dire : « ces jours,
» ces lumières, ont befoin d’être, relevés : il
» faut relever ces maffes de lumière. On dit
aufli, » un deflin relevé de blanc ». En parlant
des maffes ebfcures, on dit au .contraire,
éteindre, ajjourdir, rendre fourdes.
RENDRE ( v. aét. ) La lignification qu’a ce
mot dans le langage de la peinture,' rie laiffe
. pas. appercejvoir au premier moment fa liaifon
avec le fens. ]:e plu s ordinaire ; mais. elle eft
fenfible, dès qu’on y réfléchit Rendre dans la
langue généraie, veut dire rejîituer : rendre
lonqu’ il slag;it de deflinèr , ou de peindre ,
fignifie repufenter exactement. On pourroit
p=nrer que ci3 qu’ il y a de fi gu re dans ce terme
appliqué aux arts , eft emprunté dé l ’èffet du
miroir, auquel il femble quion confie ou qu’on
donne les objets qu’ on lui préfeme , dans l’ intention
qu'il, les remit par la repréfentation.
A u .re fte , on doit penfer. que le fens figuré
de ce mot à toujours rapport à une force dp
ïeüitutipn,
R E N
< Ln effet fi l’ on dit d’ un homme qu’ il rend
bien un fait dont il a été témoin, on entend
qu il reftitue exaélement ce qui lui a été confié
par l’organe de la vue. Cet aéteur rend lien
fon rôle, veut dire qu’ il reftitue comme il
le doit , ce qui a été confié à fa mémoire &
a fon intelligence. Enfin on dit d’ une cloche
ou d’un înftrument de mufique qu’ il rend un
beau fon, c’ eft-à-dire, le fon dont l’art des
dimenfions & l’habileté de l’ouvrier l’a rendu
dépofitaire, ou fi l’on parle de celui qui en
fait ufage, on entend qu’ il rend le beau fon
qu’on exige de fon habileté.
Par un fens plus particulièrement adapté à
la peinture, on dit aufli, cet objet eft rendu ;
_ on v eut dire qu’il eft rendu par l’nahileté de 1 artifte aufli parfaitement qu’on l’exige : &
cette acception rentre dans celle dont j’ai
parlé.
Lors donc qu’ un artifte peint, lorfqu’ il imite ,
il le charge en quelque façon d’ une dette ;
il contrarie l’obligation de fatisfaire les yeux ,
lefprit & la raifon de ceux à qui il deftine
les ouvrages. Que de débiteurs peu exaéts à
rendre ce qu’on exige d’eux!
( Article de M . Watelet. )
REPENTIR ( fubfl. mafc. ) Ce terme eft
un de ceux qui, appliquables à l’art, ne font
employés cependant que par les peintres. Son
ufage eft d’exprimer quelque changement vi~
fible qu’ un auteur a fait dans fon tableau. II
arrive quelquefois que'le premier objet qu’il
a peint, & qu’ il s’ eft repenti d’avoir tait, -n’étant
recouvert que d’une-couleur légère, pouffe
au bout d’ un certain temps , ou , pour parier en
d’autres fermes, que la première couleur qui
exprimoit cet objet, venant apercer ^u travers
de la fécondé couièur dont elle a été couverte
, fe laiffe appercevoir par les. yeux exercés
: en ce cas là on dit, c’ejlim repentir y voici
un repentir &c.
Pour indiquer à nos leéteurs des exemples
très connus de ce qu’on appelle un répeotit; ,
nous citerons deux ouvrages très-diftingués de
Reftout père de l’arcifte qui exifte aujourd’hui.
L’ un dans le tab’ eau de l-’églife. de Saint-hlar-
tin-des-Champs à Paris, ^epréfentant la Pif-
cine miraculeufe ; l’autre , dans la mort- de
Saint-François placé à Rouen chez les ' Capucins
, ■ & l’un des meilleurs ouvrages; de ,ce
maître, Ces repentirs c.onfi fient en des bras
] d’anges qui fe trouvent dans Je haut de çes
tab le aux ,.& qui s’appercoivent encore fous
les nuages dont cependant ils font recouverts.
fAm g le , A f R.qbiït.) ,
RÉPÉTITION ( fubft. fera. ) On.recommande
.aux ar.tiftes d’évii?1, !-a répétition, des. mêmes
attitudes., des mè^ie geftes, des mêmes :mt>ü•
R E P
dements. C ’eft leur recommander d’îmiter la !
nature1, elle eft fi variée que ? dans un grand I
nombre de perfonnes, elle en montrera rare- }
ment deux qui, dans un même inftant, foient
dans une pomion fembtable d’aucune de leurs
parties. Elle porte à cet égard, comme à tous
les autres, J a diverfité au point de faire le
dêfefpoir de l’art.
» U eft cependant quelquefois, dir Dandré
» Pardon, d’élégante? répétitions de geftes , de
» mouvemens, de regards, qui produifenr des
» effets merveilleux, quand elles font adap-
» tées à des perfonnages qui ont une même
» intention, un même intérêt, & qui font :
» agités de la même paflion. C’ eft ainfi que
» Raphaël a repré fente,' dans fon Héliodore,
» un grouppe de plufieurs femmes q u i, par des
» démon ft rat ions uniformes , tendent à l’ex-
» preflion d’ un même fer.timent. C9éû dans
» la même vue que le Pouflin a retracé deux
» Ifraëlites dans une même attitude, cueillant
» l’un & l’ autre la mapne avec la même
» avidité ».
REPOS, (fubft. mafc.) Repos , lorfqu’ on parle
de peinture , défigne certaines parties de lacom-
jpofition d’un tableau qui femblent tranquil-
lifer la vue.
Cette ex preffion figurée, eft tirée de l’oppo-
fition'du repos phyfique avec le mouvement.
Le bruit de plufieurs objets fatigue l’oreille ; :
quelques momeris de filence la repofent. RJ
en eu de même de la vue , & dans les tableaux
qui offrent l’image du moüvement, & rappellent
quelquefois l’ idée même du bruit , il
eft' néceffaire de rappeler aufli ou de procurer
effeftivement du reposa la .vue & à, l ’éf-
prit.
I l faut donc que le peintre difpofe dans fes
comportions des repos , ; c’ eft-à-dire, des parties
fur léfqiiclîes les regards & l’ attention fe
‘trouvent moins occupés On appelle cela ménager
des repos.
: Ce principe, tirè*4ef la nature, & qui appartient
à fon syftême comme beloin , cft par
î à . tôut aufli nécefl’aire dans les arts qui ont
pour but de filnirer.
On peut dire figu rém en t q u e l’èfprit & les
; fens , tan tôt l’c fa tig u en t & tan tôt fe repofent.
L e T ùccès des arts q ui fe c h a r g e n t, en cap tiv
a n t l’efprit & les le n s , de les . con d u ire à
leu r g r é v e u t d on c q u e l’ex ercice qu’ils leurs-
d o n n e n t, leu r fo it agréab le & q u e , s’ils les
fa tig u en t q u elq u es m om ent;, ils les repofent
en fû ite autant qu ’il e ft ncceflaire pour q u ’ils
' n e foien t ni excédés ni rebütés'.
' De là naît, par développement, la néceflité
d’ une proportion entre les repos &. les occupations.^
Un pnëme qui feroit continuellement animé ,
R E P 2 J 3
pathétique, touchant, fàtîgueroit le le fteuf;
une compofition théâtrale, ou les'perfonnagés
feroient dans un mouvement continuel, excé-
deroit le fpeâateur. Une mufique fans ce fie
travailléeou bruyante, feroit à charge & pénible
à l’oreille; un tableau qu’ une aélion Oom-
pliquée occuperoit tour entier & où les aéleurs
feroient accumulés, rie feroit pas du goût de
ceuk qui auroient compté furrin plaifir moins
fatiguant, en venant le confidérer. La raifon
établit donc la loi des dans les arts, &
la raifon occupée-' de leurs fuccès, veut que
les repos foient ménagés & gradués, s’ il eft
pofiibie.
Aufli, dans les poëmes & les drames qui
répréfentent une fuccefliori d’ inftans, les repos
doivent être moins prolongés en approchant
du terme, furtout lorfqu’on a fait naître un
dçfir v if d’ y arriver,
Dans la peinture où il ne peut être quef-
tion que d’ un inftatït & où l’ unité doit: être
rendue phyf.quement Vifible, le repos doi/enst-
être ménagés de manière- à défigner .aux rer
gards leur route & à les arrêter; car les re^
gards-ont la mobilité dont manque la peinture.
‘ Dans les tableaux f l’ intérêt : ne peut
qu’attendre & appeller ; dans les ouvrages, de
quelques autres" arts^' il marche . & entraine
avec lui.
Je n è !fiiivrai pas plus' loin: ces rapproche-
mens qui m’entraînèroient. à mon tour, plus
loin peüt’-et're 'que' je ne- dois allérr Je -• ma
contentê'rai d’ajouter que dans la peinture , les
repos ont l eu par les maffes ou par les fonds.
J’entend&par maffes ; principalement' celles de
clair-obfcilr ,■ c’eft^à-dire, des lumières hiar-
monieufes étendues ou des ombres élargies.-Par
fonds, j’eritends une union ou affemblage de
couleurs douces aériennes, f i bien mariées
& fi bien fondues que le regard s’y complaît
, s’y repofe, & que les objets1'qui doivent
leur fa ire j oppùfition , èn deviennent plus
brillans.
■ C’eft donc ’ par lé -t'aïfonnémènt qu’ on ao-
. perçoit la néceflité' dès:’ r ep o s i [:C’eft du rai-
fonnemenc qu’on apprend à les placer, &
c’eft l’étude du clair-obfcur & de l’ harmonie
qui en- fournit-lès moyens. Le repos eft uns
partie de l’ art qui appartient à l’ effet. On donne
du repos à un ouvrage -en étendant les maflés,
en éteignant des lumières trop pétillantes, en
faliffimc des couleurs qui ont trop d’éclat. Quand
un tableau eft bien d’accord, quand il eft harmonieux
, il a le repos néceffairc.
( Article de M. W'a t e l e t .)
R e p o s . Deux principes rendent le éepos né-
ceffaire dans les ouvrages de l’ art : l’ un eft
- l ’unité d’intérêt, l’autre eft’ l’ harmonie.
Pour que la vue &: l’ attention du fpeâa