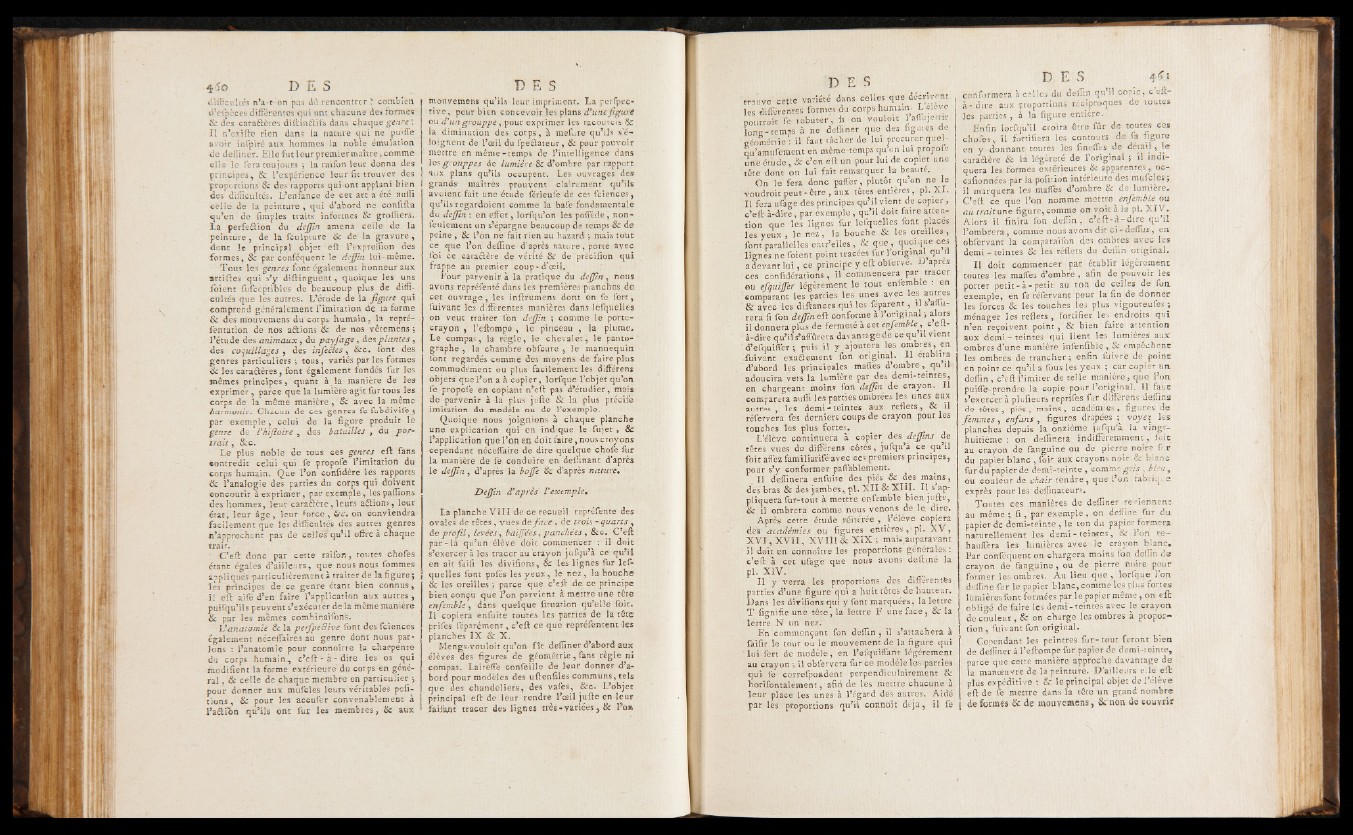
difficultés n’a-t-on pas dû rencontrer ? combien
d’efpèces différentes qui ont chacune des tormes
& des cara&ères diftinélifs dans chaque genre 1
I l n’exifte rien dans la nature qui ne pu'ffe
avoir infpiré aux hommes la noble émulation
de defliner. Elle fut leur premier maître, comme
elle le fera toujours -, la raifort leur donna des
principes, & l’ expérience leur fit trouver des
proportions & des rapports qui ont applani bien
des difficultés. L’enfance de cet art a été aufTi
celle de la peinture , qui d’abord ne confifta
qu’en de Amples traits informes & groffiers.
La perfeâion du dejfin amena celle de la
peinture, de la fculpture & de la gravure,
dont le principal objet eft l’exprefiion des
formes, 8c par conféquent le deffin lui-même.
Tous les genres font également honneur aux
artiftes qui s’y diftinguent, quoique les uns
foient fufceptibles de beaucoup plus de difficultés
que les autres. L’étude de la figure qui
comprend généralement Limitation de la forme 8c des mouvemens du corps humain » la repré-
fentation de nos aérions & de nos vêtemens ;
l ’étude des animaux, du payfage , des plantes,
des coquillages , des infectes, & c . iont des
genres particuliers -, tous, variés par les formes
8c les caractères, font également fondés fur les
mêmes principes, quant à la manière de les
exprimer , parce que la lumière agit fur tous les
corps de la même manière, & avec la même
harmonie. Chacun de ces genres fe fubdivife ;
par exemple, celui de la figure produit le
genre de l ’hifioire , des batailles , du portrait
, & c .
Le plus noble de tous ces genres eft fans
contredit celui qui le propofe l’imitation du
corps humain. Que l’on confidère les rapports
& l’analogie des parties du corps qui doivent
concourir à exprimer , par exemple, les pallions
des hommes, leur caraétère, leurs aérions, leur
état, leur â g e , leur force , on conviendra-
facilement que les difficultés des autres genres
n’approchent pas de celles' qu’ il offre à chaque
trair.
• C ’eft donc par cette raifon, toutes chofes
étant égales d’ ailleurs, que nous nous fommes
appliqués particulièrement à traiter de la figure ;
lés principes de ce genre étant bien connus,
i l eft aifé d’en faire l’application aux autres ,
puifqu’ ils peuvent s’exécuter delà même manière
& par les mêmes combinaifons.
L’anatomie & la perfpective font des fciences
également néceflaires au genre dont nous parlons
: l’anatomie pour cormoîrre la charpente
du corps humain, c’eft - à - dire les es qui
modifient la forme extérieure du corps en général
, & celle de chaque membre en particulier ;
pour donner aux mufcles leurs véritables polirions
, 8c pour les accufer convenablement à
l ’adion qu’ ils ont fur les membres, & aux
mouvemens qu’ils leur impriment. La petTpec-
r iv e , pour bien concevoir les plans d'une figuré
ou d’ ungrouppe, pour exprimer les racouveis &
la diminution des corps, à mefure qu’ ils s’éloignent
de l’oeil du fpeélateur, & pour pouvoir
mettre en même-temps de l’ intelligence dans
lesgrouppes de lumière & d’ombre par rapport
aux plans qu’ ils occupent. Les ouvrages des
grands maîtres prouvent clairement qu’ ils
avoient fait une étude férieufe de ces fciences ,
qu’ ils regardoient comme la bafe fondamentale
du dejfin : en effet, lorfqu’on les poflede, non-
feulement on s’épargne beaucoup de temps & de
peine ; & l’on ne fait rien au hazard ; mais tout
ce que l’on defline d’après nature, porte avec
loi ce caraélère de vérité & de'précifion qui
frappe au premier coup-d’oeil.
Pour parvenir à la pratique du dejfin, nous
avons repréfenté dans les premières planches de
cet ouvrage, les inftrumens dont on fe fert,
fuivant les differentes manières dans lefquelles
on veut traiter l'on dejfin ; comme le porte-
crayon , l ’eftompe , le pinceau , la plume.
Le compas, la règle, le chevalet, le pantographe
, la chambre obfcure , le mannequin
l’ont regardés comme des moyens de faire plus
commodément ou plus facilement les différens
objets que l’on a à copier, lorfque l’objet qu’on
fe propofe en copiant n’eft pas d’étudier , mais
de parvenir à la plus jufte & la plus précife
imitation du modèle ou de l’exemple.
Quoique nous joignions à chaque planche
une explication qui en indique le fiijet , &
l’application que l’on e s doit faire, nous croyons
cependant néceffaire de dire quelque chofe fur
la manière de fe conduire en deiîinant d’après
le dejfin, d’après la bojfe & d’après nature•
Dejfin d’après l ’exemple.
La planche Y I I I de ce recueil repréfente des
ovales de têtes, vues àeface , de trois - quarts ,
de profil, levées, baiflëes, panchées, 8cc. C’eft
p ar-là qu’ un élève doit commencer : il doit
s’exercer à les tracer au crayon jufqu’à ce qu’ il
en ait faifi les divifions, & les lignes fur lefquelles
font pofés les y eu x , le nez , la bouche
& les oreilles -, parce que c’ eft de ce principe
bien, conçu que l’on parvient à mettre une tête
enfemble, dans quelque fituation qu’elle {bit.
I l copiera enfuite toutes les parties de la tête
prifes féparément, c’eft ce que repréfentent les
planches IX & X.
Mengs.vouloit qu’on fît defliner d’abord aux
élèves des figures de géométrie, fans règle ni
compas. Lairefle confeille de leur donner d’abord
pour modèles des uftenfiles communs, tels
que des chandeliers, des vafes, & c . L’objet
principal eft de leur rendre l’oeil jufte en leur
faifiyit tracer des lignes très - variées, & Pq»
trouve cette variété dans celles que décrivent
les différentes formes du corps humain. L eievc
pourroit fe rebuter, Il on vouloir l’affujeitir
long-temps à ne defliner que des figures de
géométrie: il faut tâcher de lui procurer quel-
qu’amufement en même-temps qu on lui propofe
une étude, & c’ en eft un pour lui de copier une
tête dont on lui fait remarquer la beauté. ^
On le fera donc paffer, plutôt qu’on ne le
voudroic peut-ê tre, aux têtes entières, pl. XI.
Il fera ufage des principes qu’ il vient de copier,
c’ eft-à-dire, par exemple, qu’ il doit faire attention
que les lignes fur leiquelles font placés
les yeux , le nez la bouche & les oreilles ,
font paraîlelles entr’ elles, & que , quoique ces
lignes ne foient point tracées (url original qu n
ad e van tlu i, ce principe y eft oblervé. O apres
ces conftdérations, il commencera par tracer
ou efquiffer légèrement le tout enlemble 8 en
«omparant les parties les unes avec les autres
& avec les diftances qui les flparent , il s apurera
fi fon dejjineft conforme à l’original ; alors
il donnera plus de fermeté à cet enfemble, c ett-
à-dire qu’ il s’ affûrera davantage de ce qu il vient
d’efquilfer ; puis il y ajoutera les ombres , en
Suivant exaôement fon original. I l établira
d’abord les principales mafles d’ombre, qu il-
adoucira vers la lumière par des demi-teintes,
en chargeant moins fon deffin de crayon. Il
comparera aufli les parties ombrées les unes aux
autres, les demi-teintes aux reflets, & il
réfervera fes derniers coups de crayon pour les
touches les plus fortes. ^
L’élève continuera à copier des dejfins de
têtes vues de différens côtés, jufqu’ à ce qu’ il,
foit aflez familiarifé avec ces premiers principes,
pour s’y conformer paflablement.
I l deflinera enfuite des piés & des mains,
des bras 8c des jambes, pl. X II & X I IL II s appliquera
fur-tout à mettre enfemble bien jufte,
8c il ombrera comme nous venons de le dire.
Après cette étude réitérée , l’élève copiera
des académies ou figures entières , pl. X V ,
X V I , X V I I , X V I I I & X IX -, mais auparavant
il doit en connoître les proportions générales :
c’eft à cet ufage que nous avons deftine la
pl. X IV .
I l y verra - les proportions des différentes
parties d’une figure qui a huit têtes de hauteur.
Dans les divifions qui y font marquées, la lettre
T fignîfie une tête, la lettre F une face, 8c la
lettre N un nez.
En commençant fon deflin , il s’ attachera à
faifir le tour ou le mouvement de la figure qui
lui fert de modelé, en l’efqtiiffant légèrement
au crayon -, il obfervera fur ce modèle les parties
qui le correfpondent perpendiculairement 8c
horifontalement, afin de les mettre chacune à
leur place les unes à l’égard des autres. Aidé
par les proportions qu’ il connoît déjà, il fe
conformera à celles du deffm qu’ il copie, c eft-
à - dire aux proportions réciproques de toutes
les parties, à î.a figure entière.
Enfin Îorfqu’ il croira être ttr de toutes ces
chofes, il fortifiera les contours de fa figure
en y donnant toutes les fineffes de detail, le
caraélère & l i légèreté de l’original ; il indiquera
les formes extérieures & apparentes, oc-
çafionnées par la pofirion intérieure des mufcles ;
il marquera les mafles d’ombre & de lumière.
C’ slt te que l ’on nomme meme enfemble ou
au trait une figure, comme on voit à la pl. X IV .
Alors il finira fon deflin, c’e ft-a -d ire qu il
l’ombrera, comme nous avons dit ci-deflus, en
obfervant la comparaifon des ombres avec les
demi - teintes 8c les reflets du deflin original.
I l doit commencer par établir légèrement
toutes les mafles d’ombre , afin de pouvoir les
porter p e tit-à -p e tit au ton de celles de fon
exemple, en fe réfervant pour la fin de donner
les forces & les touches les plus vigoureufes ;
ménager les reflets, fortifier les endroits qui
n’en reçoivent point, & bien faire attention
aux demi - teintes qui lient les lumières aux
ombres d’une manière infenfibie , Sc empechenc
les ombres de trancher; enfin luivre de point
en point ce qu’ il a fous lés yeux ; car copier un
deflin , c’eft l’ imiter de telle manière, que l’on
puifle-prendre la copie pour l’original. 11 faut
s’exercer à plufieurs reprifes fur différens deflïns
de têtes, piés, mains, académies figures de
femmes, enfans , figures drapées ;. voye^ les
planches depuis la onzième jufqu’a la vingt-
huitième : on deflinera indifféremment, foit
au crayon de fanguine ou de pierre noire G r
du papier blanc , foit aux crayons noir & blanc
fur du papier de demi-teinte , comme gus , bleu,
ou couleur de chair tendre, que l’ on fabriqué
exprès pour les dellinateurs.
Toutes ces manières de defliner reviennent
au même ; fi , par exemple, on defline fur du
papier de demi-teinte , le ton du papier formera
naturellement les demi - teintes, 8c l’on re-
hauffera les lumières avec le crayon blanc.
Par conféquent on chargera moins fon deflin de
crayon de fanguine, ou de pierre noire pour
former les ombres. Au lieu que , lorfque I on
defline fur le papier blanc, comme les plus fortes
lumières font formées par le papier même, on eft
obligé de faire les demi-teintes avec le crayon
de couleur , & on charge les ombres a proportion
, fuivant fon original.
Cependant les peintres fur-tout feront bien
de defliner à,l’eftompe fur papier de demi-teinte,
parce que cette manière approche davantage de
la manoeuvre de la peinture. D ’ailleurs elle eft
pLis expéditive : & le principal objet de l’élève
eft de fe mettre dans la tête un grand nombre
de formes & de mouyeniens, & non de couvrir