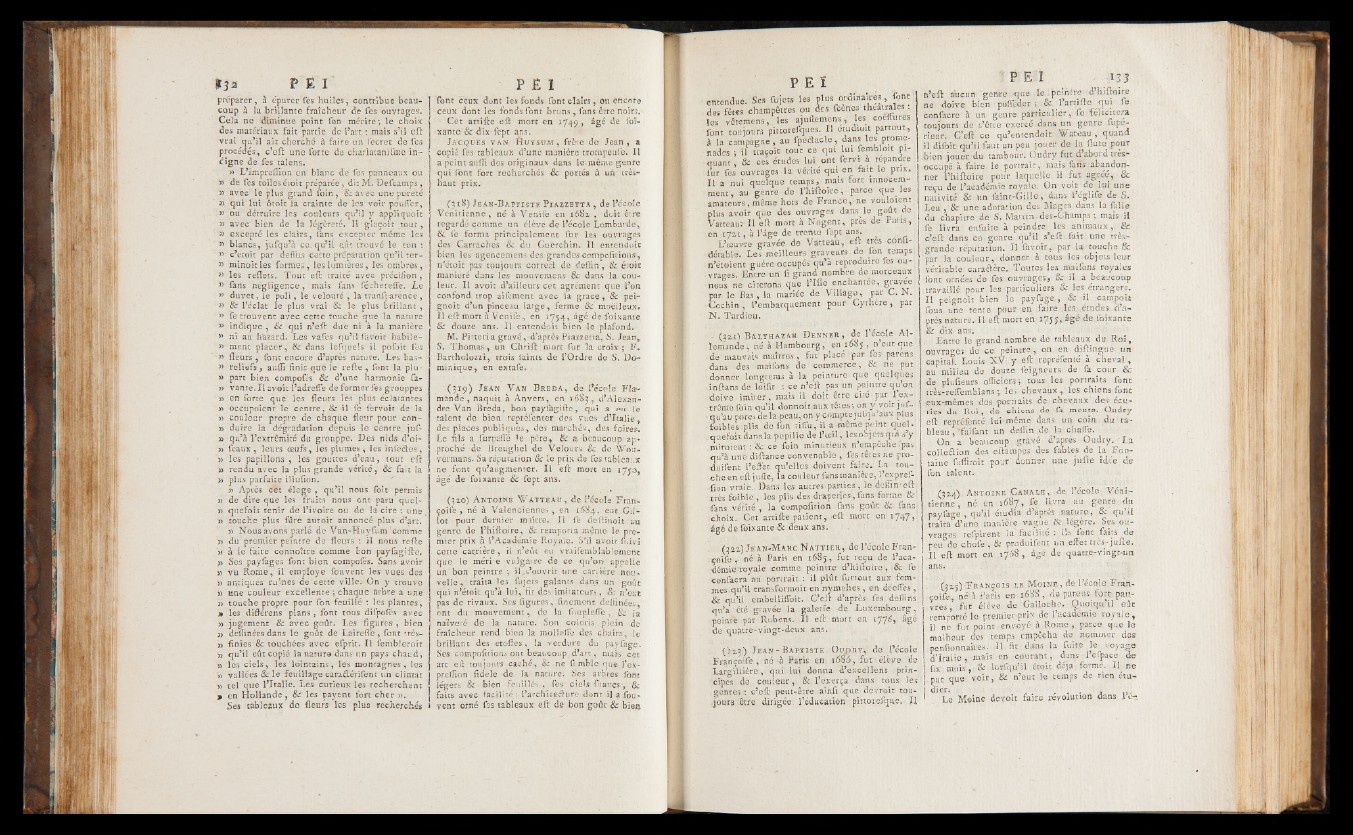
préparer, à épurer'tes huiles, contribue beaucoup
à la brillante fraîcheur de fes ouvrages.
Cela ne diminue point fon mérite’, le choix
des matériaux fait partie de l’ art : mais s’ il eft
vrai qu’ il ait cherché à faire un fecret de fes
procédés, c’eft une forte de charlatanifme indigne
de fes talens.
» L’impreflion en blanc de fes panneaux ou
» de fes toiles étoit préparée, dit M. Defcamps,
» avec le plus grand foin, & avec une pureté
» qui lui ôtoit la crainte de les voir pouffer-,
33 ou dérruire les couleurs qu’ il y appliquoit
» avec bien de la légèreté. Il glaçoit tou t,
» excepté les clairs, fans excepter même lès
» blancs, jufqu’à ce, qu’ il eût trouvé, le ton :
33 c’ ëtoit par deffus cette préparation qu’ il ter-
35 minoitles formes, les lumières, les ombres,
33 les reflets. Tout eft traité avec précifïon ,
33 farts négligence, mais fans féçhereffe. Le
33 duvet, le p o li, le velouté , la tranfparence ,
» & l ’éclat le plus vrai & le plus brillant ,
» fe trouvent avec cette touche que la nature
33 indique , & qui n’ eft due ni à la manière
» ni au hasard. Les vafes qu’ il fa voit habile-
» ment placer, & dans lefqueîs il pofoit fes
» fleurs , font encore d’après nature. Les bas-
33 reliefs , aufîi finis que le refte , font la plu-
» part bien compofss 8c d’une harmonie fa-
» vante. Il avoit l’adreffe de former fes grouppes
» en forte que les fleurs Tes plus éclatantes
» occupoient le centre, & il fe fervoit de là
» couleur propre de chaque fleur pour con-
» duire la dégradation depuis le centre,, juf-
» qu’ à l’extrémité du grouppe. Des nids d’oi-
» féaux, leurs oeufs, les plumes , les infeéles,
» les papillons , les gouttes d’ eau, tout eft
» rendu avec la plus grande vérité, 8c fait la
» plus parfaite illufion.
» Après cët éloge , qu’ il nous {bit permis
» de dire que les fruits nous ont paru quel- >5 quefois tenir de l’ ivoire ou de la cire : une
» touche plus fûre auroit annoncé plus d’art.
» Nous avons parlé de Van-Huyfum comme
» du premier peintre de fleurs : il nous refte
» à le faire connoxtre comme bon payfagifte,
» Ses payfages font bien compofés. Sans avoir
» vu Rome, il employé fouvent les vues des
>> antiques ruines de cette viîle>On y trouve
» une couleur excellente •, chaque arbre a une
» touche propre pour fon feuille : les plantes,
» les diftérens plans, font tous difpofés avec
» jugement & avec goût. Les figures, bien
» deüinées dans le goût de Laireffe , font très-
» finies & touchées avec efprit. Il fembleroit
» qu’ il eût copié là nature dans un pays chaud-,
» les c iels, les lointains, les montagnes, les
'» vallées & le feuillage cara&érifent un climat
» tel que l’Italie. Les curieux les recherchent
9 en Hollande, & les payent fort cher ».
Ses tableaux de fleurs les plus recherchés
I font ceux dont les fonds font clairs, ou encore
I ceux dont les fonds font bruns, fans être noirs.
Cet artifte eft mort en 1749, âgé de foi-
Xante & dix-fept ans.
Jacques van Huys-u m , frère de Jean, a
copié fes tableaux d’une manière trompeufe. Il
a peint aufîi des originaux dans le.même genre
qui font fort recherchés & portés à un très-
haut prix.
(318) Jean-Baptiste Piazzetta , de l’école
Vénitienne, né à Venue en 1682 , doit être
regardé comme un élève de l’école Lombarde,
& 1e forma principalement fur les ouvrages
des Carraches &: du Guerchin. Il entendoic
bien les agencemens des grandes compofitions,
n'étoit pas toujours correct de ciefiin , 8c étoit
maniéré dans les mouvemens & dans la couleur.
Il avoit d’ailleurs cet agrément que l ’on
confond trop aifement avec la grâce, & peignait
d’ un pinceau large, ferme 8c moelleux.
Il eft mort à Venife, en 17541 âgé de foixante
8c douze ans. Il entendoit bien le plafond.
M. Pitteria gravé, d’après Piazzetta, 8. Jean,
S. Thomas, un Ch ri ft mort fur la croix; F.
Bartholozzi, trois faints de l’Ordre de S. Dominique,
en extafe.
(3 19) Jean Van Breda, de l’école Flamande
, naquit à Anvers, en 1683 , d’Alexandre
Van Breda, bon payîàgifte, qui a eu- le
talent de bien repréfenter des vues d’Italie ,
des places publiques, des marchés, des foires.
Le fils a furpaffé de père, 8c a beaucoup ap*
proche de Breughel de Velours 8c de Wou-
vermans. Sa réputation 8c le prix de fes tableaux
ne font qu’augmenter. I l eft. mort en 1750,
âgé de foixante 8c fept ans. .
(320) Antoine Watteau, de l’école Franco!
fe , né à Valenciennes , en 1684, eut Gillot
pour dernier maître. I l fe deftinoit au
genre de l’hiftoire, & remporta même le premier
prix à l’Académie Royale. S’il avoit fuivi
cette caçrière, il n’eût eu vraifèmblabiement
que le méri e vulgaire de ce qu’orv appelle
un bon peintre ; iCs’ouvrit une carrière nouv
e lle , traita les, fujets galants dans un goût
qui n’ëtoit qu’à lui, fit des imitateurs, 8c n’eut
pas de rivaux. Ses figures, finement deffinées,
ont du mouvement, de la foupleffe, 8c ia
naïveté de la nature. Son coloris plein de
fraîcheur rend bien la molleffe des chairs, le
brillant des étoffes, la verdure du payfage.
Ses compofitions ont beaucoup d’a r t , mais cet
arc ell tou jours caché , & ne f< mble que l’ex-
preflion fidele de la nature. Ses arbres font
légers & bien feuilles , fes ciels fuaves-, 8c
faits avec facilité: l’archlteélure dont il a foui
yent orné fes tableaux eft de bon goût 8c bien
entendue. Ses fujets les plus ordinaires, font!
des fêtes champêtres ou des fcènes théâtrales:
les vêtemens, les ajuüemens, les coeftures
font toujours pittorefques. I l étudioit partout,
à la campagne , au fpeflacle, dans les promenades
-, il traçoit tout ce qui lui fembloit piquant,
& ces études lui ont fervi a répandre:
fur fes ouvrages la vérité qui en fait le prix.
Il a nui quelque temps, mais fort innocemment,
au genre de l’hiftoire j parce que les
amateurs, même hors de France, ne vouloient
plus avoir que des ouvrages dans le goût de
Vatteaur II eft mort à Nogent, près de Paris,
en I 7 a r , à l’âge de trente fept ans.
L’oeuvre gravée de Vatteau, eft très conli-
• défable. Les meilleurs-graveurs de fon temps;
n’étoient guère occupés qu’à reproduire fes ouvrages.
Entre un fi grand nombre, de morceaux
nous ne citerons que Pille enchantée, gravee
par le Bas, la mariée de V illa g e , par C. N.
-Cochin , l’embarquement pour Cythère , par
N. Tardieu.
• (32(i) Baithazar Denner , de 1 école A llemande,
né à Hambourg, en 1685 , n’eut que
de mauvais maîtres, fut1 placé par fes parens
dans des mai fous de commerce, & ne put
donner longtems à la peinture que quelques
inftans de loifir : ce n’eft pas un peintre qu’ on
doive imiter, mais il doit être cité par l extrême
foin qu’il donnoit aux têtes; on y voit juf-
• qu’au pores de la peau, on y compte jüfqu’aux plus
foibles plis de fon tiffu, il a même peint quel-
quefois dans la pupille de l’oeil, lés objets qui s’y
miroient : 8c ce foin minutieux n’empcche «pas
qu’à une diftance convenable , fes têtes ne pro-
duifent l’effet qu’ elles doivent fairs. La touche
en eft jufte, la couleur fans manière, 1 expref-
Tion vraie. Dans les autres parties, le deffin'eft.
très foible , les plis-des draperies , fans forme &
fans vérité , la compofition fans goût 8c fans-
choix. Cet artifte patient,-eft mort en. 1747-,
âgé de foixante & deux ans.
(322) Jean-Marc Nattier, de l'école Fran-
çoife ,• né'à Paris en 1685, fut reçu de l’académie
royale comme peintre' d’hiftoirc , .& fe
eonfacra au portrait : il plût furtout aux femmes
qu’ il transformoit en nymphes , en déeffes
& qu’il embelliffoit. C’ elr d’après fes deffins
qu’a été gravée la galerie de Luxembourg,
peinte par Rubens. Il eft mort en 1776, âgé
de quatre-vingt-deux ans.
('523) Jean - Baptiste Ou dry, de l’école
Françoife , né ‘à Paris en 1686, fut : élève de
Largiliière, qui lui donna d’excelleris p r in cipes
de couleur, & l’ exerça dans tous les
genres : c’eft: peut-être ainfi que devroit toujours
être dirigée, l’éducation pittoresque. Il
n’eft aucun genre que le .peintre d’hiftoire
ne doive, bien pôfféder ; l’artifte qui fe
confacre à un genre particulier, fe félicitera
toujours de s’être exercé.dans un genre fupe-
rieur. C ’eft ce qu’entendoit Wateau , quand
il difoit qu’ il faut un peu jouer de la flûte pour
.bien jouer du tambour. Oudry fut d’abord tres-
occapé à faire le portrait, mais faris abandonner
l’hiftoire pour laquelle il fut agréé, 8c
reçu de l’académie royale. On voit de lui une
I nativité & un faint-Gille, dans I’cglife de S.
Leu une adoration des Mages dans la fa lie
du chapitre de S. Martin-des-Champs ; mais il
fe livra enfuite à peindre les animaux, 8c
c’eft dans ce.genre qu’ il s’eft fait une tres.-
grande réputation. I l favoit.. par la touche &
'par la couleur, donner à tous- les objets leur
véritable cara&ère. Toutes les maifons royales
font ornées de fes ouvrages, 8c il à beaucoup
travaillé pour les particuliers de les étrangers.
Il peignoit bien le payfage., 8c il campoit
fous une tenté pour en faire .les^,études d’après
nature. I l eft mort en-1755; âgé de foixante
8c dix ans. ...
Entre le grand nombre de tableaux du Roi,
ouvrages de ce peintre, on en diflingue un
capital. Louis X V y eft repréfenté à chenal ,
au milieu de douze feigneurs de fa cour &
de plufieurs officiers; tous les portraits font
très-reffemblans ; les chevaux , les chiens font
eux-mêmes des portraits de chev.aux des écuries
du Roi, de chiens de fa meute. Oudry
eft repréfenté lui-même dans un coin du tableau
, ‘faifant un deftin de la chaffe.
On a beaucoup gravé d’après Oudry. 'La
colleélion des eftampe.s des fables de la Fontaine
fuffiroit pour donner une jufte idée de
fon talent.
(324) Ant.oine G an a le , de l’école Vénitienne,
né en 1687, fe livra au genre du
payfage , qu’il étudia d’à près nature, 8c qu’ il
traita d’ une manière vague 8c légère. Ses ouvrages
refpirent la facilite : ils font faits de
peu de chofe, & produifent un effet très-jufte. ,
Il eft mort en 1768 , âgé de quatre-vingt-un
ans.- .
(22.5) F rançois le Moine, de l’école Fran-
çoife, né'à Paris en 168S , de parens fort: pauvres,
fut élève de Galloche. Quoiqu’ il eût
remporté le premier prix de l’académie roy ale ,
il ne fut point envoyé à Rome, parce que le
malheur des temps empêcha de nommer des
penfionnaïres., Il fit dans la fuite le voyage
d’I ta lie , mais: en courant, dans l’èfpace de
fix mois, & lorfqu’ il étoit déjà formé. Il ne
put que v oir , & n’eut le temps de rien étu-
dier, ; ' : _ . . . , ,
Le Moine devoit faire révolution dans 1 e-;