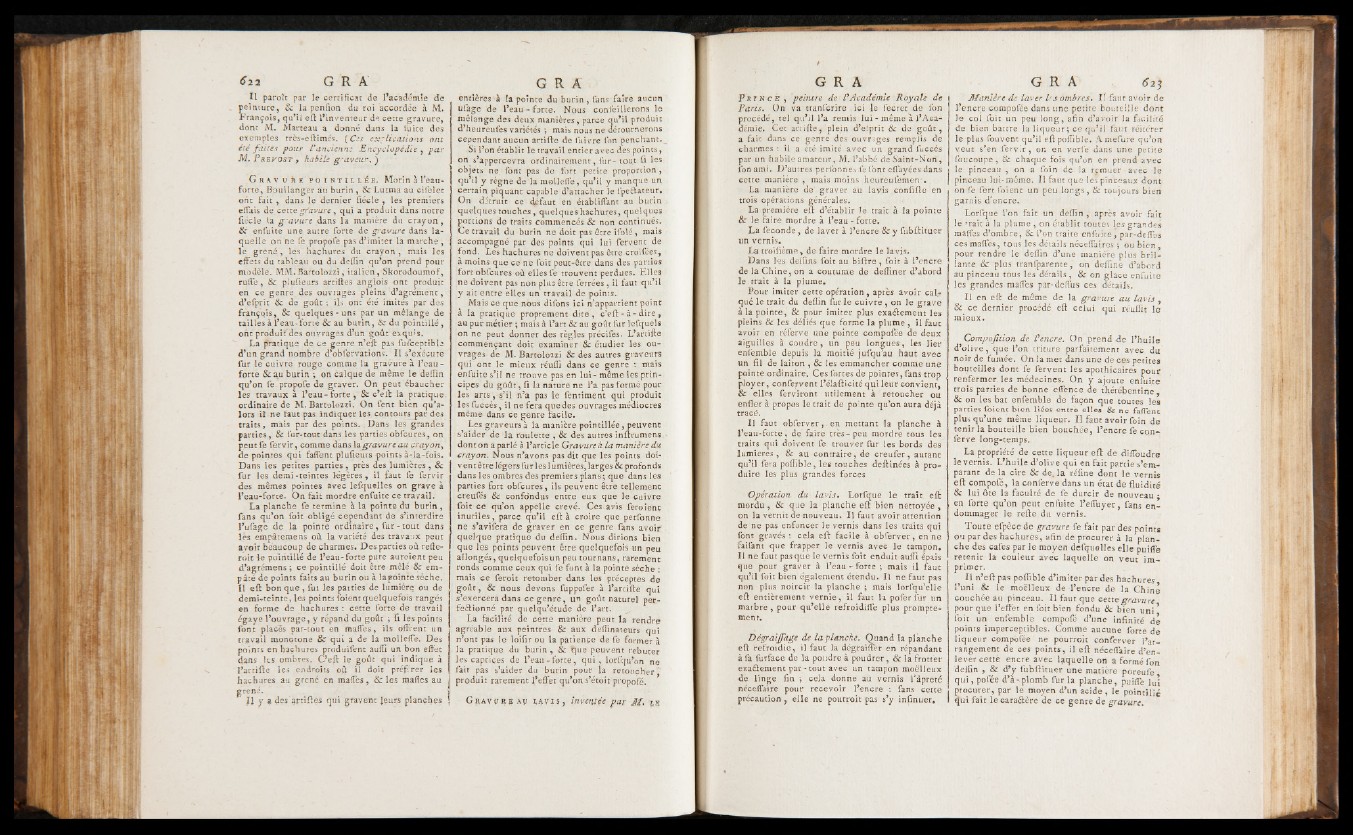
I l paroît par le certifica t d e l’acad ém ie d e
p e in tu r e , & la penfion du roi accord ée à M.
F ra n ço is, qu’il e ft l’in v en teu r de c ette gravu re,
donc M . M arteau a donn é dans la fu ite des
exem p les très-eftim és. (Ces explications ont
été faites pour Vancienne Encyclopédie , par
M. P r é v o s t , habile graveur. )
G r a v u r e p o i n t i l l é e. M orin à l’eau -
fo r te , B o u lla n g er au burin , & L utm a au c ile le t
o n t f a i t , dans le d ernier fiée le , les premiers
efiais d e c ette gravure, q u i a produit dans n otre
fié c le la gravure dans la m anière du c r a y o n ,
&■ enfui te u ne autre forte d e gravure dans laq
u e lle o n ne fe propofe pas d’im iter la m a rch e,
le g r e n é , les h ach ures du c r a y o n , m ais les
effets du tab lea ü ou du deflin qu’on prend pour
m o d èle. M M . B a rto lo zzi, ita lie n , Sk o rod o um o f,
r u fie , & plufieurs artiftes a n g lo is o n t produit
en c e g en re des o u vra ges p lein s d’a g r em é n t,
d’efprit & de g o û t : ils o n t été im ités par des
fra n ço is, & q u e lq u e s-u n s par un m éla n g e de
ta ille s à l’ea u -fo rte & au b u r in , &. du p o in tillé ,
o n t produit' des o u vra ges d’un g o û t ex q u is.
La pratique d e ce g en re n’eft pas fu icep tib le
d’un grand nom bre d’o b lerva tio n s. I l s’exécu te
fur le cu iv re rou ge com m e la gravu re à l’e a u -
fp rte & au b urin ; o n ca lq u e d e m êm e le deflin
q u ’on fe propofe d e g raver. O n peu t éb au ch er
le s travau x à l’e a u -fo r te , & c’e ft la pratique,
ord inaire de M . B artolozzi. O n fe n t b ien q u ’a-
lors il n e faut pas in d iq u er les con tou rs par des
tr a its, m ais par des p o in ts. D a n s le s grandes
p a rties, & fu r-tout dans les parties o b fcu res, on
p eu t fe fe r v ir , com m e dans la gravure au crayon,
d e p o in tes q u i fafient plufieurs jo in ts à -la -fo is.
D a n s le s p etites p a r tie s, près des lum ières , &
fur les d em i-te in te s lé g è r e s , il faut fe fervir
des m êm es p o in tes a v ec lefq u e lles on g ra v e à
l’ea u -fo rte. O n fait m ordre en fu ite c e trav ail.
La p lan ch e fe term in e à la po in te du b u r in ,
fan s qu’on fo it o b lig é cep en d a n t de s’interd ire
l’u fage de la po in te o rd in a ire, fur - to u t dans
lè s em p âtem en s où la variété des travaux peut
avo ir beaucoup d e charm es. D e s parties où reffe-
roit l e p o in tillé d e l’ea u -fo rte pure a u roien t peu
d ’agrém ens ; c e p o in tillé doit être m êlé & em p
â té d e points faits au b urin ou à la p o in te sèch e.
Il e ft b on q u e , fui le s pairies de lum ièrç ou de
d em irtein te, les poin ts l’o ien t q u elq u efo is rangés
en form e de h ach ures : Cette forte d e travail
é g a y e l’o u v r a g e , y répand du goû t ; fi le s points
fo n t places par-tout en m a fie s, ils offren t un
trav ail m o n o ton e & q u i a d e la m o llefle. D es
p o in ts en hachu res produifent aufii un bon effet
dans le s om bres. C’e ft le g o û t q u i in d iq u e à
l ’artifte le s endroits o ù il d o it préférer les
h ach ures au g ren é en m a fies, & le s m afies au
g ren é. / |
I l y a des a rtiftes q u i g raven t leu rs p lan ch es !
en tières à la p oin te du burin , fans faire aucun
u fage d e l’e a u -fo r te . N o u s con l’e ilîero n s le
m éla n g e des d eux m a n ières, parce qu’il produit
d’h eu reu fes variétés ; mais nous ne détournerons
cep en d an t au cu n a rtifte d e Cuivre l'on pen ch an t.
S i l’on étab lit le travail en tier a v ec des p o in ts,
on s’appercevra o rd in a irem en t, fu r - t o u t fi les
o b jets n e fon t pas d e fort p etite proportion ,
qu’il y règn e d e la m o lle fle , qu’il y m anque un
certain piquant cap able d’attach er le fpeélateur.
O n détruit ce défaut en établifian t au burin
q u elq u es to u c h e s, q u elq u es hach u res, q u elq u es
portion s d e traits com m en cés & non con tin u és.
C e trav ail du burin n e d o it pas être ifo lé , m ais
accom pagn é par d es p oints q u i lu i ferven t de
fon d . L es hach u res n e d o iv en t pas être croïfées,
a m oin s q u e ce n e fo it peut-être dans des parties
fort ob fcu res où e lle s fe trou ven t perdues. E lle s
n e d o iv en t pas non plus être ferrées , il faut q u ’il
y a it en tre e lle s un trav ail de points.
M ais ce q u e nous d ifons ic i n ’appartient point
a la pratique proprement d it e , c ’e f t - à - d i r e ,
au pur m étier ; mais à l’art & au g o û t fur lefq u els
on n e p eut donner des règles précifes. L’artifte
com m en çan t d o it exam in er & étu d ier les ou vrages
d e M . B artolozzi & d es autres graveu rs
q u i o n t le m ieu x réufll dans c e g en re : m ais
en fu ite s’il n e trou v e pas en lu i - m êm e les princip
es du g o û t, fi la nature n e l’a pas form é pour
le s arts , -s’il n ’a pas le fen tim en t q u i produit
le s fu c c è s, il n e fera q u e des o u vra ges m éd iocres
m êm e dans c e g en re fa c ile .
Les graveu rs à la m anière p o in tillé é , p eu v en t
s’aid er d e la rou lette , & des autres in ftrum en s
d o n t on a parlé à l’article Gravureh la manière du
crayon. N ou s n’avon s pas dit q u e les poin ts doi-
v en têtre lég ers fu ries lum ières, larges & profonds
dans le s om bres d es prem iers plans; q u e dans les
parties fort o b fcu r es, ils p eu ven t être tellem en t
creufés & con fon d u s en tre eux q u e le cu iv re
fo it c e qu’on ap p èlle crevé. C es.a v is feroien t
in u tile s , parce qu’il e ft à croire q u e p erfon ne
n e s’avifera de graver en ce g en re fans avoir
q u elq u e pratique du d eflin . N o u s d irions b ien
q u e les p oin ts p eu v en t être q u elq u efois un peu
a llo n g é s, q u elq u efo is un peu tou rn an s, rarem ent
ronds com m e ceu x q u i fe fon t à la pointe sèch e :
m ais c e feroit retom ber dans les préceptes d e
g o û t , & n ou s d ev on s fuppofer à l’a rtifte q ui
s’exercera dans ce g e n r e , un g o û t natu rel p erfectio
n n é par q u elq u ’étu d e de l ’art.
La fa cilité de c ette m anière p eut la ren d re
a gréab le aux p ein tres & aux deflinateurs q u i
n’o n t pas le loifir ou la p a tien ce de fe form er à
la pratique du burin , & fjue p eu ven t rebuter
les cap rices d e l’eau - fo r te , q u i , lorfq u ’on no
fait pas s’aid er du burin pour la retoucher"'
p rod u it rarem ent l’effet qu’o n s’étoit propofe.
G ray ü r e ap l a v i s , inventée par M- %n
P r 7 N c É , peintre de P Académie Royale de
Paris. O n v a tranferire ici le fecret d e fon
procédé , tel q u ’il l’a rem is lu i - m êm e à l’A ca dém
ie. C et a rtifte , p lein d’elp rit & d e g o û t,
a fait dans ce g en re d es o u vra ges rem plis de
charm es : il a été im ité a v e c un gran d fuccès
par un h a b ile am ateu r, M. l’abbé de S a in t-N o n ,
l'on am i. D ’autres perfon nes fe fon t eflayées dans
c e tte m anière , m ais m oin s h eu reu lem en :.
La m an ière d e graver au la v is con fifte en
trois opérations gén érales.
La prem ière eft d’établir Je trait à la p o in te
& le faire m ordre à l’e a u -fo r te .
L a fé c o n d é , d e laver à l’en cre & y fû b ftitu er
un v ern is.
La troifièm e, de faire m ordre le la v is.
D a n s les deflins foit au b iftr e , foie à l’en cre
d e la C h in e , on a cou tum e d e d eflin er d’abord
le trait à la p lum e.
P ou r im iter c e tte opération , après a vo ir cal?
q u é le trait du deflin fu r ie c u iv re , on le g ra v e
à la p o in te , & pour im iter plus exa ctem en t les
pleins & les d éliés q u e form e la p lum e , il faut
avoir en réferve une p oin te com p ofée d e d eux
a ig u illes à c o u d r e , u n peu lo n g u e s , les lier
en lem b le depuis la m o itié ju fq u ’au h au t a vec
un fil d e laiton , & les em m an ch er com m e u n e
p o in te o rd in aire. C es fortes d e p ô in res, fans trop
p lo y e r , con ferv en t l’éia fticité q ui leu r c o n v ien t,
& e lle s ferviron t u tilem en t à retou ch er ou
enfler à propos le trait d e p o in te qu’on aura déjà
tracé.
I l fau t o b fer v e r , en m etta n t la p lan ch e à
l ’e a u -fo r te , d e faire tr è s -p e u m ordre tous les
traits q u i d o iv en t fe trou ver fur les bords des
lu m iè r e s , & au co n tra ire, de c r e u fe r , autant
q u ’il fera p o ffib le, les tou ch es d eftin ées à produire
les plus gran d es forces
Opération du lavis. L orfq ue le trait e ft
m o r d u , & q u e la p lan ch e e ft b ien n etto y ée ,
o n la v ern it de n o u v ea u . I l fau t a vo ir a tten tion
d e n e pas en fon cer le v ern is dans les traits q ui
fon t gravés : c e la e ft fa c ile à o b fer v e r , en n e
faifanc q u e frapper le v ern is a v ec le tam pon.
Il n é fau t pas q u e le v ern is fo it en d u it aufii épais
q u e pour graver à l’eau - force ; m ais il fau t
q u ’il fo it b ien ég a lem en t éten d u . I l n e faut pas
non plus n o ircir la p lan ch e ; m ais lorfqu’e lle
eft en tièrem en t v e r n ie , il faut la pofer fur un
m a rb re, pour qu’e llé refroid ifle plus prom ptem
en t.
Dégraiffage de la planche. Q uand la p lan ch e
eft r e fr o id ie , il fau t la dégraifler en répandant
à fa furface de la poudre à p o u d rer, & la frotter
exactem en t p a r-to u t a vec un tampon m o elleu x
d e lin g e fin ; cela d on n e au v ern is l’âpreté
néceffaire pour recev o ir l’en cre : fans cette
p récau tion , e lle ne pourroit pas s’y in fin u er.
Manière de laver les ombres. Il fau t a vo ir d e
l ’e n cre com pofée dans u n e p etite b o u te ille d o n t
le c o l fo it un peu lo n g , afin d’a vo ir Ja fa cilité
d e b ien battre la liq u e u r ; ce q u ’il fau t réitérer
le plus fou ven t qu’il e ftp o flib le. A m efu re qu ’on
v eu t s’en fervir , on en v erl’e dans u n e p etite
fo u co u p e , & ch a q u e fois qu ’on en prend a v e c
le pinceau , on a foin d e la rem uer a v ec le
pinceau lu i-m êm e. Il faut q u e les pin ceau x dont-
on fe fert (o ie n t un peu lo n g s , & tou jou rs b ien
g arn is d’encre..
L orfque l’on fait un deflin , après avoir fait
le 'raie à la plum e , on éta b lit to u tes le s g ra n d es
mafies d’om b re, & l’on traite e n fu ite p a r -d e flu s
ces m a fies, tou s les d étails néceflai,res ; ou b ie n ,
pour ren d re le deflin d ’une m anière p lu s b r illa
n te & plus tran fp aren te, on d eflin e d’abord
au p in ceau tous les d é ta ils, & on g la c e en fu ite
le s grandes mafies par-deflus ces d étails.
I l en e ft de m êm e d e la gravure au la v is ,
& ce d ern ier procédé eft c e lu i q u i réu n it le
m ie u x .
Compofition de Véncre. O n p ren d d e l’h u ile
d ’o liv e , q u e l’on triture parfaitem ent a v ec du
n o ir d e fum ée. O n la m et dans u n e de ces p etites
b o u teilles donc fe ferv en t le s ap oth icaires pour
renferm er, les m éd ecin es. O n y ajo u te en fu ite
trois parties d e b o n n e e.flence d e th éréb en tin e
& on les bat en fem b le d e façon q u e tou tes les
parties fo ien t b ien liées en tre e lle s & n e fafien t
plus qu ’u n e m êm e liq u eu r. I l fau t avo ir foin de
ten ir la b o u te ille b ien b o u c h é e , l’en cre fe c o n -
ferve lon g -tem p s.
La propriété d e c e tte liq u eu r e ft d e d iflou d re
le v ern is. L’h u ile d’o liv e q u i en fait parcie s’em parant
d e la cire & d e* la réfine d o n t le v ern is
e ft com p o fé, la con ferv e dans un état d e flu id ité
& lu i ô te la facu lté d e fe d urcir d e n o u vea u *
en forte qu ’o n p eut en fu ite l’e flu y e r , fans e n dom
m ager le refte d u v ern is.
T o u te efp èce d e gravure fe fait par d es p o in ts
ou par des h a c h u r e s, afin d e procurer à la p lan c
h e d es cafés par le m o y en d efq u o lles e lle p uifle
reten ir la co u leu r a v ec la q u e lle on v eu t im prim
er.
I l n’e ft pas p offib le d’im iter par d es h a ch u res
l’u n i & le m o elleu x d e l’en cre d e la C h in e
co u ch ée au p in ceau . I l fau t q u e c e tte gravure
pour q u e l’effet en foit b ien fon du & b ien u n i
fo it un en fem b le com pofé d’u n e in fin ité d e
poin ts im p ercep tib les. C om m e a u cu n e forte d e
liq u eu r com pofée n e pourroit con ferv er l’arran
gem en t de ces p o in ts, il e ft néceffaire d’en lev
er c e tté en cre a v e c la q u e lle on a form é fou
deflin , & d’y fu b ftitu er u n e m atière poreu fe
qui , pofée d’à -p lo m b fur la p la n c h e , puifle lu i
procu rer, par le m oyen d’un a c id e , le p o in tillé
q u i fait le caractère d e c e g en re de gravure.