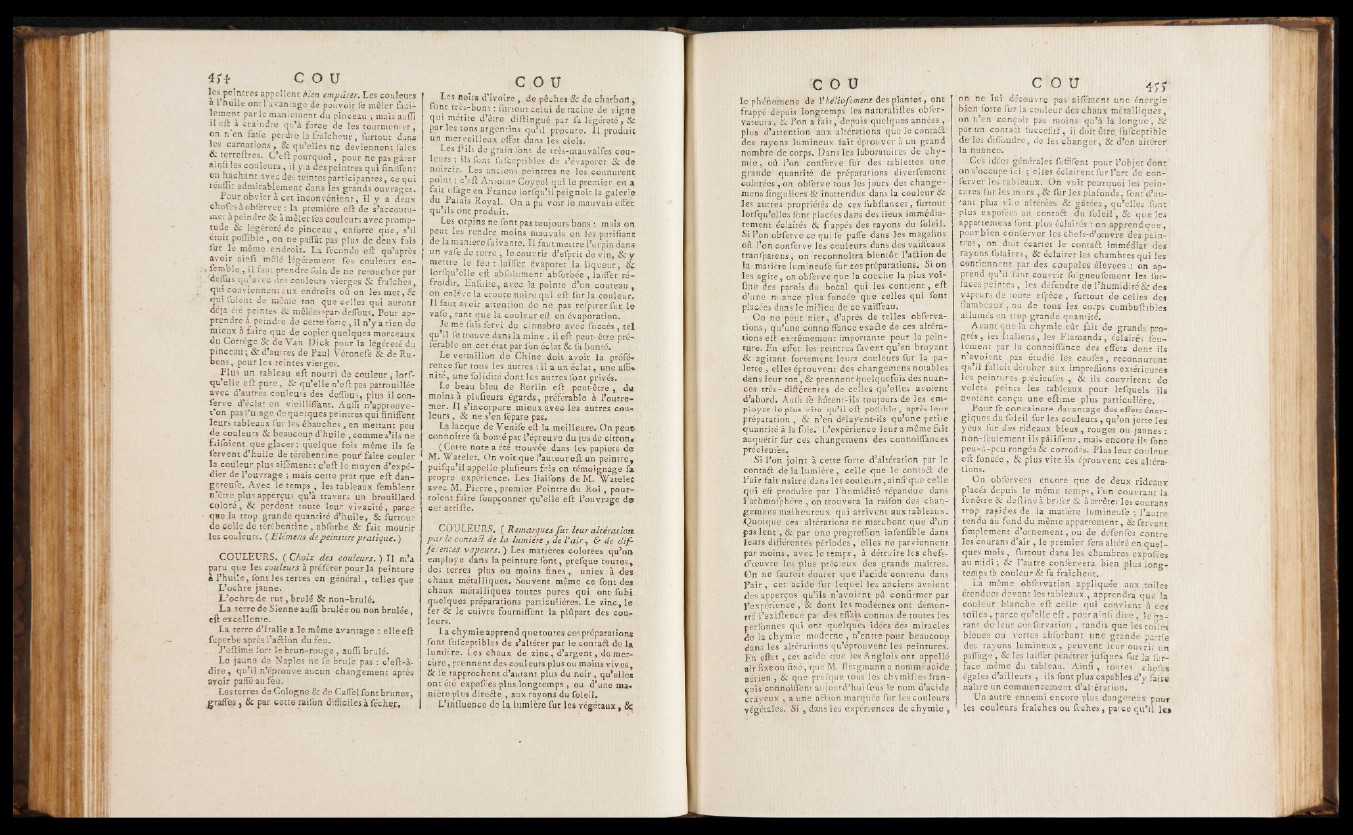
4 ? * C O U
les^ peintres appellent bien empâter. Les couleurs
a 1 huile ont 1 avantage de pouvoir fe mêler facilement
par le maniement du pinceau ; mais aufli
il eft a craindre qu’ à force de les tourmenter,
on n en faite perdre la fraîcheur, furtout dans
les carnations, & qu’elles ne deviennent falcs
& terreftres. C’eft pourquoi, pour ne pas gâter
ainfiles couleurs , il y, a des peintres qui finiiTent
avec des teintes participantes, ce qui
leuflic admirablement dans les grands ouvrages.
Pour obvier a cet inconvénient, il y a deux
chofesà obferver : la première eft de s’accoutu-
mer à peindre & a mêler les couleurs avec promp-
tude & légèreté de pinceau , enlorte que, s’ il
étoit pofîible , on ne pafTât pas plus de deux fois
lur le meme endroit. La fécondé eft qu’après î
avoir ainfî mêlé legerement fes couleurs en- .
f femble , il faut prendre foin de ne retoucher par
"deflus qu’avec des couleurs vierges & fraîches*
qui conviennent aux endroits où on les met, &
qui loi en t de même ton que celles qui auront
déjà été peintes & mêlées *par-delfous. Pour apprendre
a peindre de cette forte, il n’y a rien de
mieux a faire que de copier quelques morceaux
du Côrrége & de Van Dick pour la légéreté du
pinceau; & d’autres de Paul Véronefe & de Rubens,
pour les teintes vierges.
Plus un tableau eft nourri de couleur, lof f-
qu’ elle eft pure, & qu’elle n’eftpas patrouillée
avec d’autres couleurs des delfous, plus il con-
ferve d’éclat en vieillifl'ant. Audi n’approuve- t on pas l’u :age de quelques peintres qui finiffent
leurs tableaux fur les ébauches, en mettant peu
de couleurs & beaucoup d’huile , comme s’ils ne r
faifoient. que glacer : quelque fois même ils fe
fervent d’huile de térébentine pouf faire couler !
la couleur plus aifément: c’eft le moyen d’expédier
de l ’ouvrage *, mais -cette prat que eft dan-
gereufe. Avec le temps , les tableaux femblent
n’être plus apperçus qu’à travers un brouillard
colore, & perdent toute leur vivacité, parce
que la trop grande quantité d’huile, & furtout
de celle de térébentine L abforbe & faic mourir
les couleurs. ( Elémens de peinture pratique.)
COULEURS, ( Choix des couleurs. ) U m’a
paru que les couleurs à préférer pour la peinture
a l ’huite, font les terres en général , telles que
L’ochre janne.
L ’ochre de ru t , brûlé & non-brulé.
L a terre de Sienne aufli brûlée ou non brûlée,
eft excellente.
La terre d’Iralie a le même avantage : elle eft
fuperbe après Faction du feu.
J’eftime fort le brun-rouge , aufli brûlé.
Le jaune de Naples ne fe brûle pas : c’ eft-à-
d ire , qu’ il n’éprouve aucun changement après
avoir paffé au feu.
Les terres de Cologne & de Caffel font brimes,
graffes , & par cette raifon difficiles à féchej.
c o u
Les noirs d’ ivoire , de pêches & de charboft y
font très-bons : furtout celui déraciné de vigne
qui mérite d’être diftingué par fa légéreté, &
par les tons argentins qu’ il procure. Il produit
un merveilleux effet dans les ciels.
Les ftils de grain font de très-mauvaifes couleu
rs -, ils font fufceptibles de s’évaporer & de
noircir. Les anciens peintres ne les connurent
point ; c eft Antoine Coypel qui le premier en a
fait ufàge en France lorlqu’ il peignoit la galerie
du Palais Royal. On a pu voir le mauvais eft'èt
qu ils ont produit.
Les orpins ne font pas toujours bons *. mais on
peut les rendre moins mauvais en les purifiant
de la maniere fuivante. Il faut mettre Foi-pin dans
un vafe de terre , le couvrir d’efpric de vin, & y
mettre le feu : laifler évaporer la liqueur, Sç
lorfqu’è lle eft abfolument' abforbée , laifler refroidir^
Lnfuite, avec la pointe d’un couteau ,
on enlève la croûte noire qui eft lur la couleur.
Il faut avoir attention de ne pas relpirer fur le
vafe, tant que la couleur eft en évaporation.
Je me fuis fervi du cinnabre avec fuccès , tel
qu’ il fe trouve dans la mine : il eft peut-être préférable
en cet état par fon éclat & fa bonté.'
Le vermillon de Chine doit avoir la préfet
rence'fur tous les autres : il a un éclat, une affi»
nité, une folidité dont les autres font privés.
. Le beau bleu de Berlin eft peut-être , du
moins à plufieurs égards, préférable à l’outremer.
Il s’incorpore mieux avec les autres couleurs
, & ne s’en fépare pas.
La lacque de Venifeeft la meilleure.'On peu©
connoître fa bonté par l’épreuve du jus de citron*
( Cet-te note a été trouvée dans les papiers de
M. Watelet. On voit que Fauteureft un peintre,
puifqu’il appelle plufieurs fois en témoignage f*
propre expérience. Les liaifons de M. watelet
avec M. Pierre, premier Peintre du R o i, pour-
roient fairé foupconner qu’ elle eft i’ouvra'ge de
cet artifte.
COULEURS, ( Remarques fur leur altération
par le contact de la lumière , de Vair, & de d ifferentes
vapeurs. ) Les matières colorées qu’on
employé dans la peinture font, prefque toutes*
des terres plus ou moins fines, unies à des
chaux métalliques.;Souvent même ce font des
chaux métalliques toutes pures qui ont fubi
quelques préparations particulières. Le zinc, le
1er & le cuivre fourniflent la plûpart des couleurs.
La chymie apprend que toutes ces préparations
font fufceptibles de s’altérer par le contaél de la
lumitre. Les chaux de zinc, d’argent, de mercure
, prennent des couleurs plus ou moins vives.,
& fe. rapprochent d’autant plus du noir , qu’elles
ont été expofées plus longtemps , ou d’ une manière
plus directe , aux rayons du foleil.
L’ influence de la lumière fur les végétaux, Sç
c o u
le phénomène de Vhéliofement des plantes, ont
frappé depuis longtemps les naturaliftes observateurs.,
& Fon a fa it, depuis quelques années,
plus d’attention aux altérations que le contaét
des rayons lumineux fait éprouver à un grand
nombre de corps. Dans lés laboratoires de ehy-
mie, où Fon conferve fur des tablettes une
grande quantité de préparations diverfement
colorées , on obferve tous les jours des changerions
finguliers & inattendus dans la couleur &
les autres propriétés de ces fubftances, furtout 1
lorfqu’elles font placées dans des lieux immédiatement
éclairés Si frappés des rayons du foleil.
Si l’ on obferve ce qui fe pafle dans les magafins
où Fon conferve les couleurs dans des vaifleaux
tranfparens; on reconnoîtra bientôt l’aéiion de
la matière lumineufe fur ces préparations. Si on
les agite, on obferve que la couche la plus voi-
fine des parois du bocal qui les contient, eft
d’une nuance pliis foncée que celles qui font
placées dans le milieu de ce vaifleau.
On ne peut nier, d’après de telles obferva-
tions j qu’une connoiflance exaéle de ces altérations
eft extrêmement importante pour la peinture.
En effet les peintres faver.t qu’en broyant
&: agitant fortement leurs couleurs fur la pale
t te , elles éprouvent des changemens notables
dans leur ton, & prennent Quelquefois desnuances
très- différentes de celles qu’elles avoient
d’abord. Aufli fè hâtent-ils toujours de les employer
le plus vîte qu’il eft pôlhble, après leur
préparation , & n’ en délayent-ils qu’ une petite
quantité à la fois. ' L’expérience leur a même fait
acquérir fur ces changemens des connoiffances
précieuiès.
Si Fon joint à cette forte d*altération par le
conta61 de la lumière , celle que le contact de
l ’air fait naître dans les couleurs ,ainfi que celle
qui eft produite par l’humidité répandue dans
Fathmolphère , on trouvera la raifon des changemens
malheureux qui arrivent aux tableaux.
Quoique ces altérations ne marchent que d’un
pas lent , & par une progrefiion infenfible dans
leurs différentes périodes, elles ne parviennent
pas moins, avec le temps, à détruire les chefs-
d’oeuvre tes plus précieux des grands maîtres,
©n ne fauroit douter que l’acide contenu dans
l ’air , cet acide fur lequel les anciens avoient
des apperçus qu’ils n'avoient pû confirmer par
l ’expérience , & dont les modernes ont démontré
Fexîftence par des eflais connus de toutes les
perfonnes qui ont quelques idées de.« miracles
de la chymie moderne , n’ entre pour beaucoup
dans les altérations qu’ éprouvent les peintures.
En e ffet, cet acide que les Anglois ont appellé
air fixe ou fixé, que M. Bergmann a nommé acide
aerien , & que prefque tous les chvraillés fran-
çois connoiflènt aujourd’hui fous le nom d’acide
crayeux , a une aétion marquée fur les couleurs
végétales. Si , dans les expériences de chymie ,
C O U
on ne lui découvre pas aifément une énergie
bien forte fur la couleur des chaux métalliques,
on n’ en conçoit pas moins qu’ à la longue, &
par un contaél fuccefiif, il doit être, fufceptible
dé lès difloudre, de les changer, & d’en altérer
la nuance.
Ces idées générales fuffifent pour l’objet donc
on s’occupe ici ; elles éclairent fur l’art de con-
lèrver les tableaux. On voit pourquoi les peintures
fur les murs , & fur les plafonds, font d’autant
plus vue altérées & gâtées, qu’ elles font
plus expofées au contact du foleil , & que les
appartemens l’ont plus éejairés : on apprend q ue ,
pour bien conferver les chefs-d’oeuvre des peintres
, on doit écartei le contact immédiat des
rayons iofaires, & éclairer les chambres qui les
contiennent par des coupoles élevées.: on apprend
qu’il faut couvrir forgneufement les fur-
faces peintes , les défendre de l’humidité 8c des
vapeurs de route elpèce, furtout de celles des
flambeaux , ou de tous les corps combuftibles
allumes en trop grande quantité.
Avant que là chymie eût fait de grands progrès,
les Italiens, les Flamands, éclairés feulement
par la connoiffànce des effets dont ils
n’avoient pas étudié les caufes, reconnurent
qu’ il falloit dérober aux impreflions extérieures
les peintures- précieufes , & ils couvrirent de
volets peints les tableaux pour lefquels ils
avoient conçu une eftime plus particulière.
Pour fe convaincre davantage des effets énergiques
du foleil fur les couleurs , qu’on jette les
yeux fur des rideaux bleus, rouges ou jaunes :
non-feulement ils pâli fient, mais encore ils font
peu-à-peu rongés & corrodés. Plus leur couleur
eft foncée , Si plus v îte ils éprouvent ces altérations.
On obfervera encore que de deux rideaux
placés depuis le même temps, i’un couvrant la
fenêtre &: deftiné à brifer & à arrête.* les courans
trop rapides de la matière lumineufe -, l ’autre
' tendu au fond du même appartement, & fervar.c
Amplement d’ornement, ou de défenfes contre
les courans d’air , le premier fera altéré en quelques
mois , furtout dans les chambres expofées
au midi -, & l ’autre confervera bien plus longtemps
fa couleur & fa fraîcheur.
La même obfervation appliquée aux toiles
étendues devant les tableaux , apprendra que la
couleur blanche eft celle qui convient à ces
toiles , parce qu’elle e f t , pour a mi fi d ire , le garant
de leur confervation , tandis que les toiles
bleues ou vertes abforbant une grande partie
des rayons lumineux , peuvent leur ouvrir un
pa{fage , & les laifler pénétrer jufques fur la fur-
face même du tableau. Aïnfi , toutes choies
égales d’ailleurs , ils font plus capables d’y faire
naître un commencement d’alrération.
Un autre ennemi encore plus dangereux pour
les couleurs fraîches ou fiches , parce qu'il le»