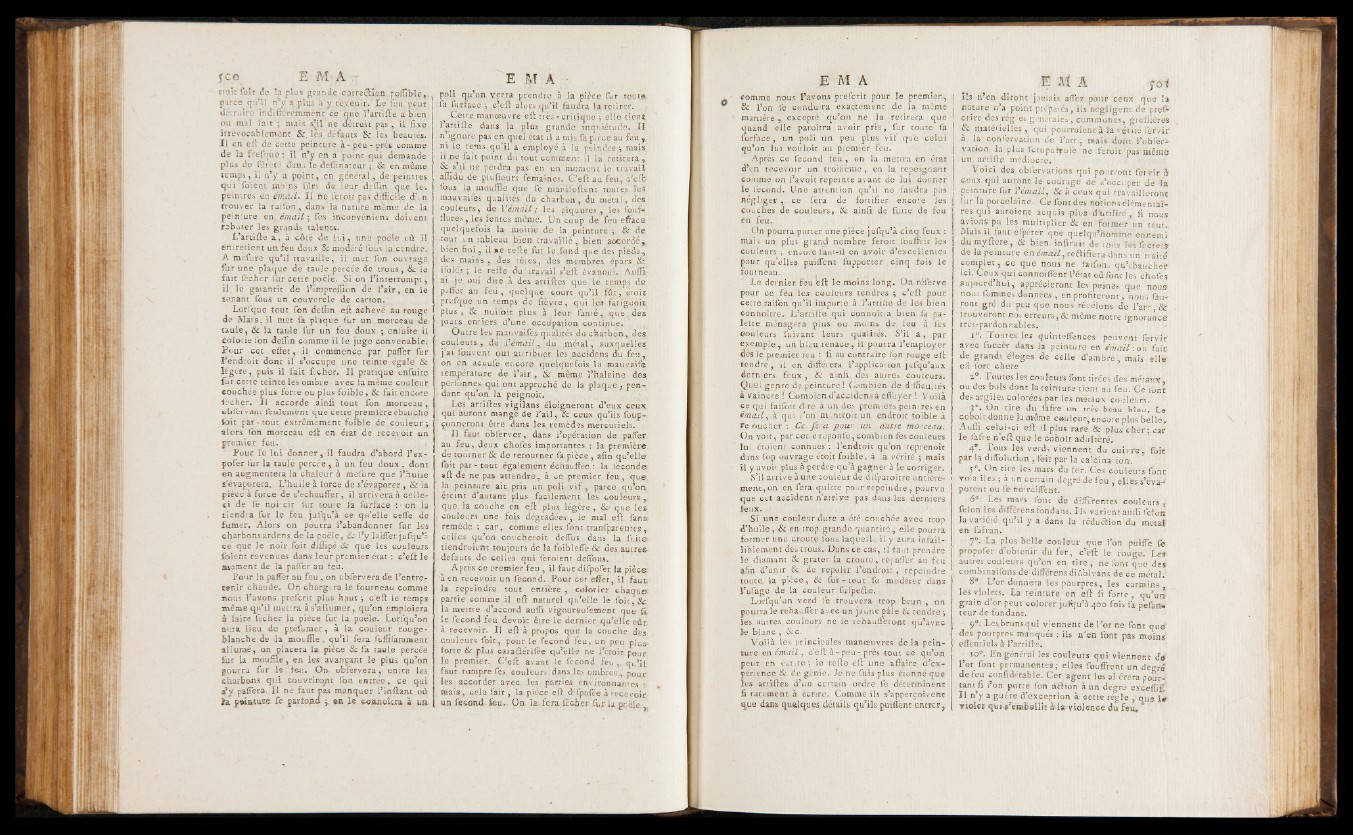
trait foit de la plus grande cpjredLqntpoflibl,e,,
parce qu’ il n’ y a plus à y retenir,. L e fe u . peut
détruire indifféremment ce que. l ’artifte a bien
ou mal fait ; mais s^il ne détruit pas , il fixe-
irrévocablement &, les défauts & les beautés.
I l en eff de cette peinture à-peu-près comme
de la frefque : il n’ y en a point qui demande
plus ,de lûretc dans le deffinateur ; & en même
temps, ii n’y a point, en général , de peintres
qui foient moins lurs de leur deiTui que les
peintres en émail. I l ne fer oit pas difficile d\ n
trouver la raiïon, dans la nature même de la
peinture en. émail ; les inconvéniens doivent
rebuter les grands talents.
L’artifte a , à côté de lu i, une poêle où il
entretient un feu doux & modéré fous la cendre.
A mefure qu’ il travaille, il met fon ouvrage,
lur une plaque de taule.percée de trous, & le
fait féch er fur cette poêle. Si on l’interrompt, (
i l le garantit de l’impreflion de l’a ir , en le
tenant fous un couvercle de carton.
Lorfque tout fon defïin eff achevé au rouge
de Mais, il met fa plaque fur un morceau de
taule, & la taule fur un feu doux enfuite il
colorie fon deflin comme il le juge convenable.
Pour cet effet, il commence par paffer fur
l ’endroit dont il s’occupe une teinte égale &
légère, puis il fait lécher. I l pratique enfuite
lut cette teinte les ombre avec la même couleur
couchée plus forte ou plus foible, & fait encore
lécher. I l accorde ainft tout fon morceau,
©bfervant feulemënt que cette première ébauche
foit par-tout extrêmement foible de,couleur;
alors fon morceau eff: en état dé recevoir un
premier feu.
Pour le lui donner, il faudra d’abord l’ ex-
pofer fur la taule percée , à un feu doux, dont
©n augmentera la chaleur à mefure que l’huiie
s’évaporera. L’huile à force de s’évaporer , & la
pièce à force de s’échauffer, il arrivera à celle-
ci de le noircir fur toute fà furface on la
tiendra fur le feu jufiqu’à ce qu’elle cefle de
fumer. Alors on pourra ^abandonner fur les
charbonsardens de la poêle, 8c l’y laiffer jufqu*?
ce que le noir foit difli-pé 8c que les couleurs
foient revenues dans leur premier état : c’eft le
moment de la paffer au feu.
Pour la paffer au feu , on obfervera dé l’entretenir
chaude. On chargera le fourneau comme
nous l’ avons prelcrit plus haut ; c’eft ie temps
même qu’ il mettra à s’allumer, qu’on emploiera
à faire lécher la pièce fur la poêle. Lorfqu’on
aura lieu de préfumer, à 1& couleur rouge-
blanche de la mouffle, qu’ il fera, fuffifamment
allumé, on placera la pièce & fa taule percée
fur la mouffle, en les avançant le plus qu’on
pourra fur le feu. On- obfervera, entre les
charbons qui couvriront fon entrée, ce qui
s’y paffera. Il ne faut pas manquer i’ inftaiu où
la pointure fe par fond su le connotera à un.
poli qu’on verra prendre à la pièce fur tout*
fa furface ;, c’eft alors qu’il faudra la retirer.
Cette manoeuvre eft très - critique ; elle tient
l’ artifte, dans la plus grande inquiétude. I l
n’ ignore pas eh quel état il a mis fa pièce au feu ,
ni le, tems qu’ il a employé .à la peindre -, mais
ii ne fait point du tout comment il la retirera,
or s il ne perdra pas en un moment le travail
aïlidu de plu fie tirs femaînes. C’eft au feu, ç’eft-
fops la mouffle que te manifeftent toutes lès
mauvaifes qualités du charbon , du métal, des
couleurs, de Vémail ; les piquures., les fouf-
flures, les fentes même. Un coup de feu efface
quelquefois la moitié de la peinture ; & de
-tour un tableau bien travaillé, bien accordé,
bien fin i, il me reffe fur le fond que des pieds ,
des mains , des têtes, des membres épars 8c
Ie tefte du travail s’ eft, Jvanoui. Aufli
ai-je oui dire à des artiftes que le temps de
paffer au feu , quelque court qu’ il fût, écoifi
prefque un temps de fièvre, qui les fariguoit
plus, & nuiioit plus à .leu r fanté, , q u e „ des
jours,entiers d’ une occupation continue.
Outré les pi au vallé s qualités du charbon, des
couleurs , de Ÿémail, du tnétal, auxquelles
j’ai fouvent oui attribuer, les accidens du feu,,
on en accule encore quelquefois, la mauvaife-
température de l’a i r , & même l’ h.aleine des.
perlpnnes qui ont approché de la plaque, pen-.
dant qu’on la peignoir.
Les artiftes vigilans éloigneront d’eux ceux
qui auront mangé de l’a il, & ceux qu’ ils foup-
çonneront être dans les remèdes mercuriels..
Il faut obier ver, dans l’opération de paffer.
au feu, deux chofes importantes : la première
de tourner & de retourner fa pièce , afin qu’e lle
foit par - tout également échauffée r la fécond©
«ft de ne pas attendre, à ce premier fe u , que
la peinture ait pris un poli v if , parce qu’on
éteint d’autant plus facilement les couleurs ,,
que la couche eh eft plus l é g è r e &/ que les
couleurs une fois dégradées , le mal eft fans»
remède ; car, comme elles font tranfparentes,.
celles qu’on couchêroit- deffus. dans la fuite,'
tièndroient toujours de la foibleffe & des autres-
défauts de celles qui feroienc deffous. }
xôprès ce premier feu , il faut djfpofer la pièce,
à en recevoir un fécond. Pour cet effet, il faut
la repeindre tout entière , colorier chaque-
partie comme il eft naturel qu’elle le foie, &
la mettre d’accord aufli vigoureufement que ft,
le fecondfeu devoir être le dernier qu’elle eût
à recevoir. Il eft à propos que la couche dès
couleurs foie, pour le fécond feu, un peu pfos>
forte &r plus cara&érifée qu’elle ne l ’etoit pour
le premier. C’eft avant le fécond feu qu’il
faut rompre fes. couleurs dansées ombresr pour
les ■. accorder avec; les parties environnâmes :
mais, cela fa it , la pièce eft d fpofée à recevoir,
un fécond fou.. Qn la»- fera ft cher fur la gcëfo
comme nous l’avons preferit pour le premier,,
& l’on fe conduira exactement de la. même
manière, excepte qu’on ne la retirera que
quand elle paroîtra avoir pris, fur toute fa
furface, un poli un peu plus vit que celui
qu’on lui vouloit au premier feu.
Après ce fécond feu , on la mettra en état
d’ en recevoir un troifième , en la repeignant
comme on l’avoit repeinte avant de lui donner
le fécond. Une attention qu’ il ne faudra pas
n égliger, ce fera de fortifier encore les
couches de couleurs, 8c ainft de fuite de feu :
en feu.
On pourra porter une pièce jufqu’à cinq feux :
mais un plus grand nombre feroit fouftrir les
couleurs ; encore faut-il en avoir d’excellentes :
pour qu’elles puitfent fupporter cinq fois le
fourneau.
Le dernier feu eft le moins long. On réferye '
pour ce féu les couleurs tendres ; c’eft pour !
cette raifon qu’ il importe à l’artifte de les bien
eonnoître. L ’artifte qui conno.îti a bien fa pa- I
lette ménagera plus ou moins de leu à fes |
couleurs fuivant leurs qualités. S’ il a , par
exemple, un bleu tenace, il pourra l’employer
dès le premier feu : fi au contraire fon rouge eft
tendre, il en différera l’application jufqu’aux
derniers feux , & ainft des autres couleurs.
Quel genre de peinture! Combien de difficultés
à vaincre ! Combien d’accidens à effuyer ! Voilà
ce qui faifoit dire à un des premiers peintres en
émail, à qui i’on -môncroit un endroit foible à
*e.oucher : Ce fera pour un autre morceau.
On voit, par cetee reponfe, combien fes couleurs
lui étoient connues : l ’endroit qu’on reprenoit
dans fiop ouvrage étoit foible, à ia vérité ; mais
il y avoir plus à perdre qu’à gagner à le corriger.
S’il arrive à une couleur de difparoître entière- «
ment,on en fera quitte pour repeindre, pourvu
que cet accident n’arrive pas dans les derniers
feux.
Si une couleur dure a été couchée avec trop
d’huîl'e, & en trop grande quantité, elle pourra
former une croûte fous laquelle il y aura infailliblement
des trous.. Dans ce cas, il faut prendre
le diamant & gracèr la croûte, re paffer au feu
afin d’ unir & de repolir l’endroit, repeindre
toute, la pyèce, & fur-tout Te modérer dans
l ’ ufage de la couleur fufpe&e.
Lorfqu’ un veÿd ie trouvera trop brun , on
pourra le rehauffer avec un jaune pâle 8c tendre ;
les autres couleurs ne fe îehaufl’eront qu’avec
le blanc, &e.
Voilà les principales manoeuvres de.la peinture
en émail, e-eft à-peu-près tout ce qu’on
peut en écrire y ie refte eft une affaire d’ expérience
& de génie.- Je ne fuis plus étonné que
les artiftes d’ un certain ordre fe déterminent
fi rarement à écrire. Comme ils s’apperçoivent
que dans quelques détails qu’ ils puiffènt entrer,
j ils n’ en diront jamais affez pour ceux que là
nature n’a point préparés, ils negiigent.de pref*-
crire des règles générales , communes, -groflières
& matérielles qui pourroient à la vérité fer v if
a la confervation de l’arr, mais dofit l’obfet-i
vation- la plus fcrupuT^ufe ne feroit pas même
un artifte médiocre.
Voici des o b fer vation s qui pourront fétvir à
ceux qui auront le courage de s’occuper dé la
peinture fur Ÿemail^ 8c à ceux qui travailleront
lur la porcelaine. Ce font des notions élémentaires
qui auroient acquis plus d’utilité , fi nous
avions pu les multiplier & en fibrine r un tôur.-.
Mais il fout efpérer qne qudqu^homme ennemi
du myitère, & bien inftruk de cous les fecretS
de là peinture en^émail^e&iûerz-dans un traité
complet, ce que nous ne faifon* qu’ébauchef
ici. Ceux qui connoiflent l’état où font les chofes
aujourd’hui, apprécieront les peines que nous*
nous fommes données , en profiteront, nous fau^
ront gré du peu que nous révélons de l ’arr, &
trouveront nos erreurs, & même notre ignorance'
crès-pardon n abi es. 1
i°. Toutes les quinteffènees peuvent fervrE
avec fuccès^ dans la peinture en émail : on fait
de grands éloges de celle d’ambre, mais elle’
eft- fore chere
2. . Toutes les couleurs font tirées des métaux -
ou des bols dont la teinture tient au feu. Ce font
des argiles colorées par les métaux coulehrs,
3M. r’r® du fafre un très-beau bleu. Le
cobolt donne la meme ceuleiir, encore plus belles
Aufli celui-ci eft il plus rare 8c plus cher';.car
le fafre n eft que le cobolt adultère.-
4e. Tous les verds viennent,du cuivre,, foit
par la diffolution , foit par la calcination.
5'°» On- tire les mars du fer. Ces couleurs fonc
vola îles ; a un certain degré de feu , elle’s s’éva^
porent ou fe noirciffent.
6° Les mars lonc de différentes couleurs ,=
folon les difFerènsfondans. Us varient aufli ielaa
la variété qu’ il y a dans la réduélion du métal
en fafran.
7°- plus b elle couleur que l’on puifle fo
propofer d’obtenir du fe r , c’eft 1e rouge. Les*
autres couleurs qu’ on en tire , ne font que des
combinaifons de differënsdi/foivans de ce métal.1
8®. L’or donnera les pôurpres, les carmins,
les violets. La teinture en eft fi forte , qu’un-
grain d’or»peut colorer jufqu’à 400 fois fa pefart*»;
teur de fondant.
9®. Lesbruns.qui viennent dè l ’or ne font qu®‘
des pourpres manqués : ils n’en font pas moins
eflêntieis à l’artifte.
i-o°.. En général les couleurs qui viennent d®
l’ or font permanentes,- elles fouffrent un degré
de feu confidérable. Cet agent les al-érera pour--
tant fi i’on porte fon a&ion à un degré excefliC
Il n’y a guère d’exception à cette régie y que 1#
violet qui »’embellit à la yiolence dix feu.