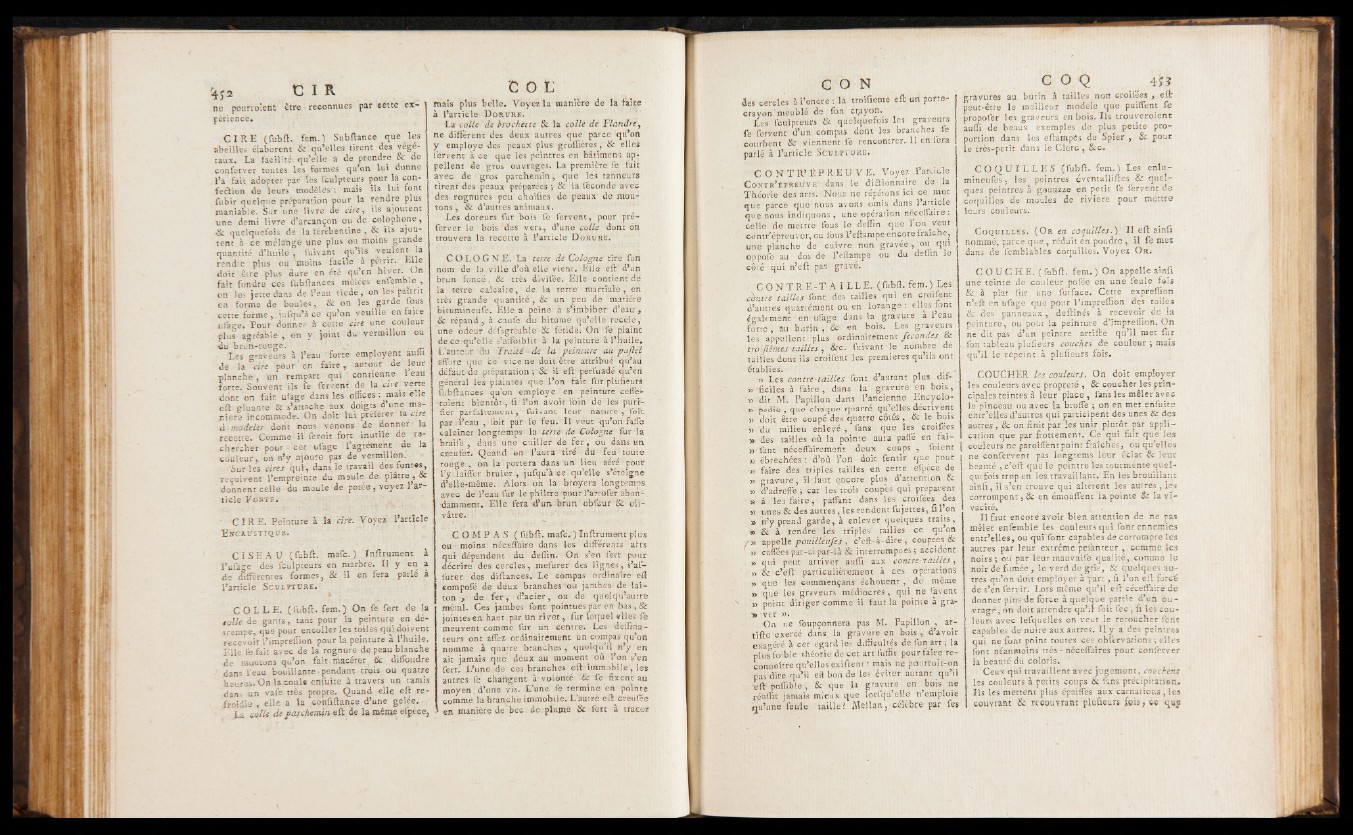
i^ .j2 C I R
ne pourraient être reconnues par cette expérience,
C I R E (fubft. fem.) Subftance que les
abeilles élaborent & qu’ elles tirent des végétaux.
La facilité, qu’elle a de prendre 8c de
conferver toutes les formes qu’on lui donne
l ’ a fait adopter par les lculptcurs pour la confection
de leurs modèles : mais ils lui font
fubir quelque préparation pour la rendre plus
maniable. Sur une livre de cire, ils ajoutent
une demi livre d’arcançon ou de colophqne,
& quelquefois de la térébentine, & ils ajoutent
à ce mélange une plus ou moins grande
quantité d’ huile , fuivant qu’ ils veulent la
rendre plus ou 'moins facile a pétrir. Elle
doit être plus dure en été qu’en hiver. On
fait fondre ces lub fiances mêlées enlemble ,
on les jette dans de l’eau tied e, on les paitrit
en forme de boules, & on les garde fous
cette forme, jufqu’à ce qu’on veuille en faire
ufage. Pour donner à cette cire une couleur
plus agréable , on y joint du -vermillon ou
du brun-rouge. v ^
Les graveurs à P eau' forte employent aulii
de la cire pour en fa ire , autour de leur
p lanche, un rempart qui contienne 1 eau
forte. Souvent ils fe fervent de la sire verte
dont on fait ufage dans lés offices : mais elle
eft gluante & s’attache aux doigts d’ une maniéré
incommodé. On doit lui preferer la cire
à modeler dont nous venons de donner la
recette. Gomme il féroit fort inutile de rechercher
pour cet ufage l’agrément de la
couleur,, on n’ y ajoute pas de vermillon.
Sur les cires q ui, dans le travail des fontes,
reçoivent l’ empreinte du monte- de- plâtre^, &
donnent celte du moule de potée, voyez 1 article
F o n t ê .
- C IR E . Peinture à la cirt. Voyez l’ article
E n c a u s t iq u e .
C I S E A U ( fubft. mafe.) Inftrumënt à
l ’ ufage des fculpteurs en marbre. I l y en a
de différentes formes, & il en fera parlé à
l’ article S c u l p t u r e .
C O L L E . ( fubft. fem. ) On fe fert de la
40IU de gants, tant pour la peinture en détrempe,
que pour encoller tes toiles qui doivent
recevoir l’ impreffion pour la peinture à l’huile.
Elle fe fait avec de la rognure de peau blanche
de moutons qu’on fait macérer. & diffoudre
dans Veau bouillante pendant trois ou quatre
heures. On la coule enfuice à travers un tamis
dan> un vafe très propre. Quand elle eft refroidie
,- elle a la confiftance d’ une gelée.
La colle de parchemin eft de la même efgèce,
mais plus belle. Voyez la manière de la faire
à l ’article D o r u r e .
La colle de brochette & la colle de Flandre,
ne différent des deux autres que parce qu’on
y employé des peaux plus groflières, & elles
fervent à ce que tes peintres en bâtimens appellent
de gros ouvrages. La première fe fait
avec de gros parchemin, que tes tanneurs
tirent des peaux préparées ; & la leconde avec
des rognures peu choifies de peaux de moutons
, & d’autres animaux.
Les doreurs fur bois fe fervent, pour pré-
ferver 1e bois des vers, d’ une colle dont on
trouvera la recette à l’article D o&ure.
C O L O G N E . La terre de Cologne tire fon
nom de la v ille d’où elle vient. Elle eft d’ un
brun foncé, & très divifée. Elle contient de
la terre calcaire, de la terre martiale, en
très grande quantité, 8c un peu de matière
bitumineufe. Elle a peine à s’ imbiber d’eau,
& répand à caufe du bitume qu’ elle recèle,
une odeur défogréable 8c fétide; On fé plaint
de ce qu’elle s’affoiblit à la peinturé à l’nuile.
L’auteur du Traité de la peinture au paflél
affure que ce vice ne doit être attribué qu’au
défaut de préparation ; & il eft perfuadé qu’êri
général tes plaintes que l’on fait fur plusieurs
fubftances qu’on employé en peinture cefleï-
•roient bientôt , fi l’on avoir foin de tes purifier
parfaitement, fuivant leur nature , fort
par:l’eau , Toit par 1e feu. I l veut qu’on faite
calciner longtemps la terre'de Cologne fur la
braife , dans une cuiller de fe r , ou dans un
cneufet.' Quand en l’aura tiré du feu toute
rouge , on la portera dans un lieu aéré pour
l ’y laiffer brûler , -jufqu’à ce quelle s’étêigne
d’elle-même. Alors on la bro'yera longtemps
avec de l’eau fur le philtre pour l’ arrofer abondamment.
Elle fera d’ un brun obfcur &: olivâtre.:;
C O M P A S ( fiibft. mafe. ) Inftrumënt plus
ou moins nëceffaire dans les différents atts
qui dépendent du deflin. On s’ en fert pour
décrire des cercles, mefurer des lignes, s’al-
lurer des diftances. Le compas ordinaire eft
compofé de dôux branches ou jambes- de laiton
y de f e r , d’acier, ou de qu el qu’au tre
métal. Ces jambes-font pointues par en bas', &
jointes en haut par un r iv e t, fur lequel «lies te
meuvent-comme fur un centre. Les- delTina-
teurs ont affez ordinairement un compas qu’on
nomme à qnajre branches, quoiqu’ il n’y en
ait jamais que deux au moment où l’on s’ en
fert. L’ une de ces branches eft immobile, les
autres fe changent à volonté & le fixent aü
moyen d’une vis. L’une, fe termine en pointe
comme la branche immobile. L’autre eft creuféè
1 en manière de* bec de plume & fert à tracez
âes cercles à l’e n c re : la troifiem e e ft un p o rtecrayon
meublé de fon cijayon.
Les fcu lp teu rs & q u e lq u e fo is les g rav eurs
le ferv en t d’un com pas d o n t tes b ran ches fe
c o u rb e n t & v ie n n e n t fe re n c o n tre r. 11 en fera
parlé à l’a rtic le Sc u l p t u r e .
C O N T R’ É P R E U V E . Voyez, Partiel e
C ontr’épreuve dans le dictionnaire de la
Théorie des arts. Nous ne répétons ici ce mot
que parce que nous avons omis dans l’article
que nous indiquons, une opération neee flaire :
celte de mettre fous le deflin que lon^vOut
contr’épreuver, ou fous l’ eftampe encore fraîche,
une planche de cuivre non gravée , ou qui
©ppofe au dos de 1? e Hampe ou du deflin 1e
côté qui n’ eft pas gravé.
C O N T R E - T A I L L E , (fubft. fem. ) Les
afytre tailles font dés tailles qui en croifent
d’autres quartément ou en lozange : elles font
également en ufage dans la gravure a 1 eau |
forte , au burin , 8c- en bois. Les graveurs
les appellent plus Ordinairement fécondés &
troijièmes ta ille s, & c . fuivant 1e nombre de
tailles dont ils; croifent les premières qu ils ont
établies.- „
» Les contre-tailles font, d’autant plus dif-
» ficil.es à faire , dans la gravure en bois,
» dit M. Papillon dans l’ancienne Encyclo-
» pédiè , que chaque quarré qu’elles décrivent
» doit être coupé des quatre côtes , 8c le bois
>> du milieu enlevé , fans que les croifées
» des tailles où la pointe aura paffé en fai-
» Tant néceffairement deux- coups , foient
».ébréchées: d’où l’on doit fentir que pour
-5) faire des triples tailles en cette efpèce de
» gravure, i l faut encore plus d’attention 8c
» d’adrefle ; car les trois coupes qui préparent
» à tes faire , paffant dans les croifées des
» unes & des autres, les rendent fujettes, fi l’on
» h’y prend garde, à enlever quelques traits,
» & à rendre lés triplés tailles ce qu’on
/'» appelle pouilleufes c’ eft'à-dire ,- coupées &
caflees par-ci par-là & interrompues j accident
» qui peut arriver auffi aux contre-tailles,
, » éc ' c’eft particulièrement à ces opérations
» que l'es commençans échouent , de même
» que les graveurs médiocres, qui ne lavent
» point diriger comme il faut la pointe a gra*
•» ver ».
On ne foupçonnera pas M. Papillon , ar-
tifte exercé dans la gravure en bois , d’avoir
exagéré à cet egard t e s difficultés de fon art ; la
plusfoible théorie de cet art fuffic pour faire re-
connoître qu’elles exiftent : mais ne pourroit-on
pas dire qu’ il eft bon de les éviter autant qu’ il
■ eft pofïïble, & que la gravure en bois ne
rétiflit jamais mieux que lo fi qu’ elle n’emploie
qu’une feule, taille? M e ! lan c é lèb re par fes
gravures au burin à tailles non croifées > eft
peut-être 1e meilleur modèle que puiflent fe
propofer les.graveurs en bois. Ils trouveraient
aufli de beaux exemples de plus petite proportion
dans les eftaiîipês de Spier , & pour
. le très-petit dans le Clerc , & c . ,•
C O Q U I L L E S (fubft. fem.) Les enlu-
mineufes . les peintres êventalliftes 8c quelques
peintres à gouazze en petit fe fervent de
coquilles de moules de rivière pour mettre
leurs couleurs.
C o q u il l e s . (O r en coquilles.) U eft ainfi
nommé, parce q u e , réduit en poudre , il te met
dans de fçmblabiés coquilles. Voyez Or.
Ç O U C H E. ( fubft. fem. ) On appelle ainfi
une teinte de couleur pofée en une feule fois
8c à plat fur une furface. Cette expreffion
n’eft en ufage que pour l ’ impreflîon des toiles
& des panneaux, deftinés à recevoir de la
peinture, ou pour la peinture d’impreffiori. On
ne dit pas d’ un peintre artifte qu’ il met fur
, fon tableau plufiears couches de couleur ; mais
qu’ il le repeint à plufieurs fois.
COUCHER les couleurs. On doit employer
les couleurs avec propreté , & coucher les principales
teintes à leur place , fans tes mêler avec
le pinceau ou avec la brofte ; on en met enfuite
emr’elles d’autres qui participent des unes & des
autres , & on finit par les unir plutôt, par application
que par frottement. Ce qui fait que tes
I couleurs ne paroiffencpoint fraîches, ou qu’elles
ne Confervent pas longtems leur éclat & leur
beauté , c’eft que le peintre tes tourmente quelquefois
trop en les travaillant. En les brouillant
ainfi, il s’ en trouve qui altèrent tes autres , les
corrompent, & en émouffent la pointe 8c la v ivacité.
Il faut encore avoir bien attention de ne pas
mêler enfembie les couleurs qui font ennemies
entr’elles, ou quEfonr capables de corrompre tes
autres par leur extrême pelanteur , comme tes
noirs; ou par leur mauvaife qualité,.comme le
noir de fumée, 1e verd de gris, & quelques autres
qu’on doit employer à part, fi l’on eft forcé
. de s’en fervir. Lors même qu’ il eft céceffaire de
donner plus de force à quelque partie d’ un ouvragé,
on doit attendre qn’ it foit fe c , fi tes couleurs
avec lelquelles on veut le retoucher font
capables de nuire aux autres. I l y a des peintres
qui ne font point toutes c es observations -, elles
font néanmoins très - néceffaires pour conferver
la beauté du coloris.
Ceux qui travaillent avec jugement, couchent
tes couleurs à petits coups & fans précipitation..
Ils les mettent plus épaiites aux carnations, les
couytanc 8c recouvrant plufieurs fois; ce que