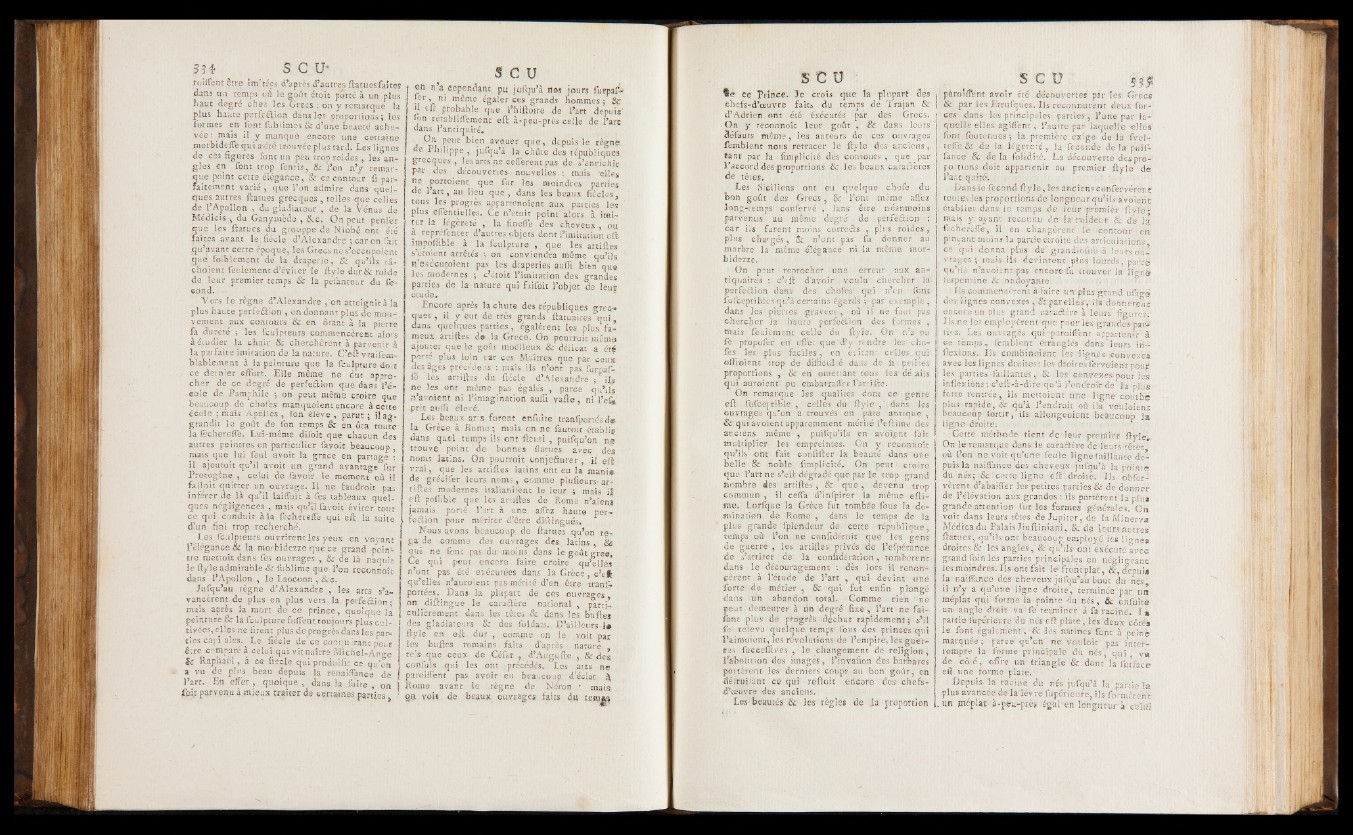
roiffent être învtées -d’après d’autres ftatuesfaîtes
dans un temps où le goût étoit porte à un plus
haut degré chez lès Grecs : on y remarque la
plus haute perfeélion dans les proportions; les
formes en l'ont lublimes & d’une beauté achevée
: mais il y manque encore une certaine
morbideffe qui a»été trouvée plus tard. Les lignes
de ces figures font un peu trop roides , les angles
en font trop fentis, & l’on n’y remarque
point cette élégance, & ce contour fi parfaitement
varie , que l’on admire dans quelques
autres ftatues grecques , telles que celles
de l’Apollon , du gladiateur , de la Vénus de
Médicis -, du Gany.mède , & c . On peut penler
que les ftatues du grouppe de N lobé ont été”
faites avant le fiécle d’Alexandre-, car on fait
qu’pvant cette époque, les Grecs nes’occupoient
que faiblement de la draperie, & qu’ ils râ-
choient feulement d’éviter le ftyle dur & raide
de leur premier temps & la pefianteur du fécond.
—
Vers le règne d’Alexandre ,'on atteignit à la
plus haute perfection , en donnant plus de mouvement
aux contours 8c en ôtant à la pierre
fa dureté ; les fculpteurs commencèrent alors
a étudier la chair & cherchèrent à parvenir à
la pat faite imitation de la nature. C’eft vraifem-
blablement à la peinture que la fculpture doit
ce dernier effort. Elle même ne dut approcher
de ce degre de perfeélion que dans l ’é cole
de Pamphile ; on peut même croire que
beaucoup de choies manquoient encore à cette - :
école ; mais Apelles , fon éléve , parut ; ilag-
grandit le goût de l'on temps & en ôta toute
la féchereffe. Lui-même diloit que chacun des
autres peintres en particulier favoit beaucoup
mais que lui feul avoir la grâce en partage :
il ajoutoit qu’ il avoit un grand avantage fur
Protogène , celui de lavoir le moment où il
falloir quitrer un ouvrage. I l ne faudroit pas
inférer de là qu’ il laiffok à fes tableaux quelques
négligences , mais qu’il favoit éviter tout
ce qui conduit à la féchereffe qui eft la fuite
d’un fini trop recherché.
Les fculpteurs ouvrirent les yeux en voyant
l’élégance & la morbidezze que ce grand peintre
mettoit dans fes ouvrages , & de là naquit
le ftyle admirable & l'ubîime que l’on reçonnoît
dans l’Apollon , le Laocoon , &e.
Jufqu’au règne d’Alexandre , les arts s’avancèrent
de plus en plus vers la perfeélion ;
mais après la mort de ce prince, quoique, la
peinture & la fculpture fuffent toujours plus cultivées,
elles ne firent plus de progrès dans les parties
capi ales.^ Le fiécle de'ce conquirant peut
être comparé à celui qui vit naître Michel-Ange
Raphaël, à co fiecle qui produifit ce qu’on
a vu de plus beau depuis la renaiffance de
l ’art. En e ffe t, quoique , dans la fuite on
fait parvenu à mieux traiter de cena-mes parles
! cependant pu jufqu’à nos jours furpaè
• fr n.nî même égaler ces grands hommes; &
il eft probable que l’ hiftoire de l’art depuis’
Ion rétabliffement eft à-peu-près celle de l’arc-
dans l’anriquiré.
Un peut bien avouer que, depuis le règne,
de Philippe , jufqu’à la chûte des républiques
grecques , les arts ne cefferent pas de s’enrichir
par des découvertes nouvelles.: mais 'elles
ne portaient que fur les moindres parties
de l’ar t, au lieu que , dans les beaux fiécles,
tous les progrès appartenoient aux parties les
plus éffentielles. Ce n’étoit point alors à imiter
la légèreté , la fineffe des cheveux, ou
à repréfenter d’autres objets dont l’ imitation eft
impqflibîe à la fculpture , que les artîftes
s’étoient arrêtés -, on conviendra même qu’ ils
n’exécutoient pas les draperies aufïi bien que
les modernes ; c’étoit l’imitation des grandes
parties de la nature qui fiifoit l ’objet de leur
étude.
Encore après la chute des républiques grecques
, il y eut de très grands ftatuaires 'qui,
dans quelques parties, égalèrent les plus fameux
artiftes de la Grece. On pourroit ni cm a
ajouter que le goût moelleux & délicat a éti
porté plus loin car ces Maîtres que par ceux
des âges précédé ns ‘ : mais ils n’ont pas furpaf-
fé les artiftes du fiécle d’Alexandre ; ifs
ne les ont même pas égalés , parce qu’ils
n’avoient ni l’ imagination auffi y a fte , ni l’efi*
prit auffi élevé/
Les beaux arts furent enfuite tranfporrés d®
la Grèce à Rome ; mais en ne fauroit établi*
dans quel temps ils ont fleuri , puifqu’on ne
trouve point de bonnes ftatues avec dès
noms latins. On pourroit conjefturer il eft
v rai, que les artiftes latins ont eu la manif
de grécifer leurs noms, comme plufieurs- artiftes
modernes italianisent le leur. ; mais if
eft poffible que les artiftes de. Rome n’aien,*
jamais porté l’art à une affez haut® perfeélion
pour mériter d’être distingués.
Nous avons beaucoup de ftatues qu’on ré-
ga de comme des ouvrages des latins , &
qui ne font pas du moins dans le goût greo.
Ce qui peut encore faire croire qu’ellès
n’ont pas été exécutées dans la Grèce, c’ e^
qu’elles n’auroient pas mérité d’en être tranf*
portées. Dans la plupart de çes ouvrages,
on diftingue le caraélère national , particulièrement
dans les têtes & dans les buftei
des gladiateurs & des foldats., D’ailleurs-! •
ftyle en eft dur , comme on le voit par
les buftes romains faits d’après nature
te.-s que ceux de Céfar , d’Augufte , & des
confuls qui les ont précédés. Les arts ne
| paroiffenc pas avoir eu beaucoup d’éclat ^
J Rome avant le règne de Néron * mais
1 on voit 4e beaux ouvrages faits du teiçyp
Aie ce Prince. Je crois que la plupart Ses i
Chefs-d’oeuvre faits du temps de Trajan 8t j
d’Adrien ont été éxécutés par des Grecs, i
On y reçonnoît leur goût , & dans leurs
défauts même, les auteurs de ces ouvrages
femblent nous retracer le ftyle des anciens,
tant par la fimplicité des contours , que par
l ’accord des proportions & les beaux caraélères
de têtes.
Les Siciliens ont eu quelque chofe du
bon goût des Grecs, & l’ ont môme affez
long-temps corifervé , fans être néanmoins
parvenus au même degré de përféélion :
car ils furent moins correcls , plus roides 3
plus chargés, 8c n’ont pas fu donner au
marbre la même élégance ni la même morbidezze.
On peut reprocher une erreur aux antiquaires
: c’ eft d'avoir voulu chercher la-
perfeélion dans des ch0fes qui n’ en font
lufceptibl-es qu’à certains égards-, par exemple,
dans les pierres gravées , où il ne faut pas
chercher la hante perfeélion des formes ,
mais feulement celle du ftyle. On n’a pu
fie propofer en effet que d’y rendre les' chofe
s les _plus faciles , en évitant celles, qui
offroient trop de difficulté dans de fi petites
proportions , & en omettant tous les dé ails
qui auroient' -pu embarraffer Panifie.
On remarque les qualités dont ce genre
eft fufceptible , celles du ftyle dans les
ouvrages qu’on a trouvés en pâte antique',
& qui avoient apparemment mérité l’eftime des
anciens même , puilqifiils en avoipnt fait
multiplier les empreintes* On y re.conhoît
qu’ils ont fait confifter la beauté dans une
belle & noble fimplicité. On petit croire
que l’ art ne s’eft dégradé que par le trop grand
nombre des artiftes, &- que , devenu trop
commun , il ceffa d’ infpirer la même efti-
fne. Lorfque la Grèce fut tombée fous la domination
de Rome , dans le temps de la
plus grande fplendeur de cette république,
temps où l’on n e . confidéroit que les gens
de guerre , les artiftes privés de l’efpérânce
de s’attifer de la conlidération, tombèrent
dans le découragement : dès lors il renoncèrent,
à l ’étude de l’art , qui devint une.
forte de métier , & qui fut enfin plongé
dans un abandon total. Comme rien ne
peut demeurer à Un degré fixe , l ’ art ne faï-
f’ant plus de progrès déchut rapidement; s’ il
fe releva quelque temps fous des princes qui
Faimoîent, les révolutions de l’empire, lés guerres
fucceffives , le changement de religion ,
l ’abolition des images, l ’ invafion des barbares
portèrent les derniers coups au bon goût, en
détruilant ce qui reftoit encore des chefs-
d’oeuvre des anciens.
Les beautés & les règles de la proportion
1 pàroiffent avoir été découvertes par les Grecs
I 8c par les Etrufques. Ils reconnurent deux forces
dans les principales parties, l’ une par laquelle
elles agiffent, l’aurre par laquelle elles
font fou tenu es ; la. première exige de la fvel-
teffe & de la légère ré , la fécondé d e là puif-
" fiance & d e là folidité. La découverte des proportions
doit appartenir au premier ftyle de
l’ant'quité.
Dans le fécond fty le , les anciens confiérvèrent
toutes les proportions de longueur qu’ils avoient
- établies dans .le temps de leur premier 'ftyle -
mais y ayant reconnu de la roideùr 8c de la
féchereffe, il en changèrent le contour en
pinçant moins la partie étroite des articulations
ce qui donna plus de grand loft té à leurs ou-
, vrages ; mais ils devinrent pins lourds, parce
qu’ ils n’a voientpas encore fu trouver la ligna
lerpentine & ondoyante.
Ils commencèrent à faire un-plus grand liftîge
des lignes convexes , & pareil e s ils 'd on n è rën t
encore un plus grand caraélère à leurs figuresV
Ils ne les employèrent que pour les grandes par-
tics. Les ouvragés qui -paioiffent appartenir à
j ce temps, femblent étranglés -dans leurs inflexions.
Ils combinaient les lignés-convexes
avec les lignes droites: les droicel- fiervoierit poup
les .parties Taillantes, 8c les coriyex es- pour l es
inflexions-, c’ eft-à-diretqu’à l’endroit dé la plus
forte rentréè , ils mettoient une ligne courbé
plus rapide, & qu’à l’ endroit où ils voûloient
beaucoup fortir, ils allongeaient beaucoup la
ligne droite. • • 1
Cette méthode tient de leur premier fty le .
On le remarque dans le caraélère de lèurs têtes '
où l’on ne voit qu’une feule ligné faillante depuis
la naiffance des cheveux jufqu’à la pointe
du nés; & cette ligne eft droite. Ils obfer-
vèrent d’ abaiffer les petites parties & de donner
de l’élévation aux grandes : ils portèrent la plu*
grande attention fur ies fermes générales. On
voit dans, leurs têtes de Jupiter, de la Minerva
Médica du Palais J ra ft in ia n i& de leurs autres
ftatues, qu’ ils ont beaucoup .employé lés lignes
droites & les a n g l e s & qu’ \!s- ont exécuté avec
grand foin les parties principales en négligeant
les moindres. Us ont fait le front plat, & , depuis
la r.aiffance des cheveux jufqü’âu bout du nés
il n’y a qu’une ligne droite, terminée par un
méplat qui forme la pointe du nés, & enfuite
un .angle droit Va fe tefjmirief à fa racine. I *
partie fupérieure dii nés eft plate , lés deux côtés
le font également; & les narines font a peiné
marquée ; parce qù’cn ne voulait pas interrompre
la forme principale du nés,' q u i, va
de côté, offre un triangle & dont la furface
eft une forme plate.
Depuis la racine du nés jufqu’â la partie la
plus avancée de là lèvre fuperieure, ils formèrent
un méplat a-péu-pfès égal1 en longueur à celui