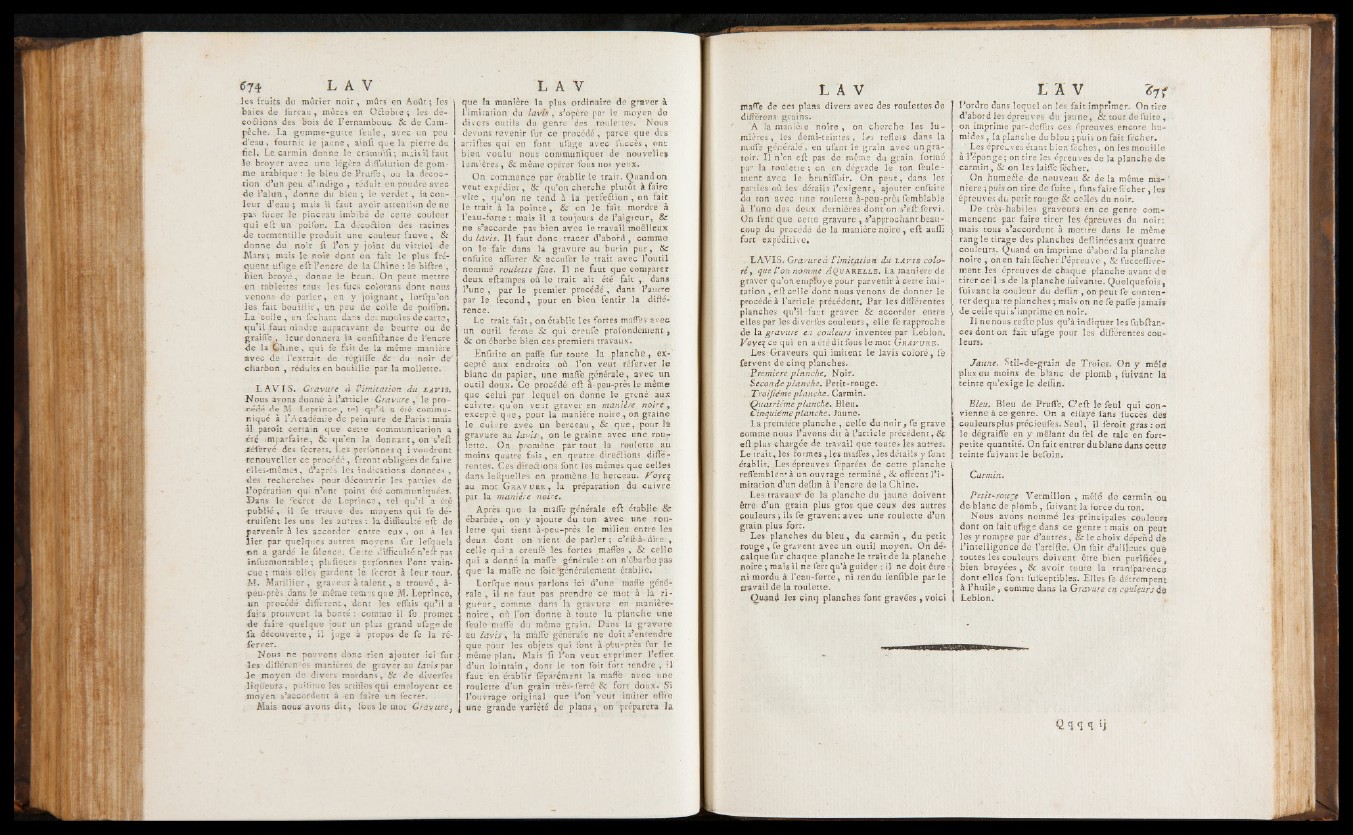
L A V
les fruits du mûrier noir , mûrs en Août; les
baies de furcau , mûres en Oélobie; les décodions
des bois de Fernambouc & de Cam-
pêche. La gomme-gutte leu le , avec un peu
d’eau, fournit ie jaune, ainfi que la pierre de.
fiel. Le carmin donne le cramoiîi ; mais il faut
le broyer avec une légère diffolution de gomme
arabique: le bleu de Pruffe, ou la décoction
d’un peu d’ indigo, réduit en poudre avec
de l’a lun , donne du bleu ; le verdet, la couleur
d’eau; mais il faut avoir attention de ne
pas fucer le pinceau imbibé de cette couleur
qui eft un poilbn. La décoélion des racines
•de tormentiile produit une couleur fauve , &
donne du noir fi l’on y joint du vitriol de
■ Mars ; mais le noir dont on fait le plus fréquent
ufage eft l’ encre de la Chine : le biftre ,
bien broyé, donne le brun. On peut mettre
en tablettes tous les fucs colorans dont nous
venons de parler, en y joignant, lorfqu’on
les fait bouillir, un peu de colle de poiflan.
La 'colle , en fëehant dans des moules de carte,
qu’ il faut oindre auparavant de beurre ou de
graille , leur donnera la confiftance de l ’encre
d e la C h in e , qui fe fait de la même manière
avec de l’extrait de 'réglifTe & du noir de'
charbon , réduits en bouillie par la mollette.
LAVIS. Gravure à Vimitation du lavis.
Nous avons donné à l’article Gravure , le procédé
de M. Leprince , tel qu’ il a été communiqué
à TAcadémie de peinture de Paris: mais
■ il paroît certain que cette communication a
érc imparfaite, & qu’en la donnant, on s’eft
xéfervé des fecrets.. Les perfonnes q i voudront
renouveller ce procédé, feront obligées de faire
elles-mêmes, d’après les indications données ,
des recherches pour découvrir les ^parties de
l ’opération qui n’ont point été communiquées.
Dans lé fecret de Leprince , tel qu’ il a été
•publié, il fe trouve des moyens qui fe dé-
•truifent les uns les autres : la difficulté eft de
parvenir à les accorder entre eux , ou à les
lier par quelques autres moyens fur lefquels
©n a gardé le fiience. Cette difficulté n’efi pas
înfurmontàbîe ; plu fieu rs perfonnes l’ont vaincue
; mais elles gardent le fecret à leur tour.
M. Marillier, graveur à talent, a trouvé, à-
peu-près dans le même temps que M. Leprince,
un procédé différent, dont les eflais qu’ il a
faits prouvent la bonté : comme il fe promet
de faire quelque jour un plus grand ufage de
fa découverte, il juge à propos de fe la réfer
ver.
Nous ne pouvons donc rien ajouter ici fur
les différences manières, de graver au lavis par
-le moyen de divers mordans, & de diverfes
liqueurs , puiCque les artiftes qui employent ce
moyen s’accordent à en faire un fecrer.
Mais nous avons dit-, fous le moi Gravure,
L A V
que la manière la plus ordinaire de graver à
Limitation du la v is , s’opère par le moyen de
divers outils du genre des roulettes. Nous
devons revenir fur ce procédé, parce que des-
artilles qui en font ufage avec fuccès, ont
bien voulu nous communiquer de nouvelle*
lumières , & même opérer fous nos yeux.
On commence par établir le trait. Quand on
veut expédier, & qu’on cherche plutôt à faire
-vite , qu’on ne tend à la perfe&ion , on fait
le trait à la pointe, & on le fait mordre à
l’eau-forte : mais il a toujours de l’aigreur, &
ne s’accorde pas bien avec le travail moelleux
du lavis. Il faut donc» tracer d’abord, comme
on le fait dans la gravure au burin pur , 8c
enfuite affurer & accufer le trait avec l’outil
nommé roulette fine. Il ne faut que comparer
deux eftampes où le trait ait été fait ,- dans
l’une , par le premier procédé , dans l’autre
par le fécond, pour en bien fentir la différence;
Le trait fa it , on établit les fortes maffes avec
un outil ferme & qui creufe profondément-,
& on ébarbe bien ces premiers travaux.
Enfuite on paff’e fur toute la planche , excepté
aux endroits où l’on veut réferver le
blanc du papier, une maffe générale, avec un
outil doux. Ce procédé eft à-peu-près le même
que celui par lequel on donne lé grené aux
cuivre» qu’on veut graver en manière noire,
excepté q ue, pour la manière noire, on graine
le cuivre avec un berceau, & que, pour la
gravure au lavis», on le graine avec une roulette.
On promène par tout la roulette au
moins quatre fois , en quatre directions différentes.
Ces direétions font les mêmes que celles
dans lefqueîles on promène le berceau. Voye^
au mot Gr a vu r e , la préparation du cuivre
par la manière noire.
Après que la maffe générale eft établie &
ébarhée, on y ajoute du ton avec une roulette
qui tient à-peu-près le milieu entre les
deux dont on vient de parler ; c’eft-à-dire ,
celle qui'a creufé les fortes maffes , & celle
qui a donné la maffe générale : on n’ébarbe pas
que" la maffe ne foit ’généralement établie.
Lorfque nous parlons' ici d’ une maffe générale
, il ne faut pas prendre ce mot à la r igueur,
comme dans la gravure en manière-
noire, où l’on donne à, toute la planche une
feule maffe du même grain. Dans la gravure
au la v is , la maffe générale ne doit s’entendre
que pour les objets qui font à-pfeu-près fur le
même plan. Mais fi l’on veut exprimer l’effet
d’un lointain , dont le ton foit fort tendre , il
faut en établir féparément la maffe avec une
roulette d’un grain très-ferré & fort doux. Si
l ’ouvrage original que l’on veut imiter ofti’e
une grande variété de plans, on ' préparera la
L A v
maffe de ces plans divers avec des roulettes de
difterens grains.
A la manière noire , on cherche les lu mières
, les demi-teintes, les reflets dans la
maffe générale", en ufant le grain, avec ungra- •
toir. Il n’en eft pas de même du grain formé
pa1* la roulette ; on en dégrade le ton feulement
avec le brunifloir. On peut, dans les
parties où les détails l’ exigent, ajouter enfuite
du ton avec une roulette à-peu-près femblable
à l’une des deux dernières dont on s’eft fervi.
On fent que cette gravure , s’approchant,beau- .
coup du procédé de la manière noire, eft auffï
fort expéditive.
LAVIS, Gravure à l'imitation du lavis coloré
, que l ’on nomme A quarelle. La maniéré de-
graver qu’on enif^roye pour parvenir à cette imitation
, eft celle dont nous venons de donner le
procédé à l’article précédent. Par les différentes
planches qu’ il faut graver 8c accorder entre
elles par les diverfes couleurs, elle fe rapproche
de la gravure en couleurs inventée par Léblon. Voyc\ ce qui en a été dit fous le mot Gravure.
Les Graveurs qui imitent le lavis coloré, fe
fervent de cinq planches.
Première planche. Noir.
Seconde planche. Petit-rouge.
. Troifiéme planche. Carmin.
Quatrième planche. Bleu.
Cinquième planche. Jaune.
La première planche , celle du noir , fe grave
comme nous l’ avons dit à l’article précédent, &
eft plus chargée de travail que-toutes les autres.
Le trait, les formes , lçs maffes, les détails y font
établis. Les épreuves réparées de cette planche 1
reffemblentà un ouvrage terminé , & offrent l’ i-
miratioh d’un defiin à l’encre de la Chine.
Les travaux' de la planche du jaune doivent
être d’un grain plus gros que ceux des autres
couleurs ; ils fe gravenc avec une roulette d’un
grain plus fort.
Les planches du b leu, du carmin , du petit
rouge , fe gravent avec un outil moyen. On décalque
fur chaque planche le trait de la planche
noire ; mais il ne fert qu’à guider : il ne doit être -
ni mordu à l’eau-forte, ni rendu fenfible parle
travail de la roulette.
Quand les cinq planches font gravées, voici
t À V
l ’ordre dans lequel on les fait imprimer. On tire
d’abord les épreuves du jaune, 8c tout de fuite ,
on imprime par-deffus ces épreuves encore humides
, la planche du bleu ; puis on fait Lécher.
/ Les épreuves étant bien féches, on les mouille
à l’épongé ; on tire les épreuves de la planche de
carmin, 8c on les laifle fécher.
On humeéle de nouveau & de la même ma- '
niere ; puis on tire de fuite , fans faire fécher, les
épreuves du petit rouge & celles du noir.
De très-habiles graveurs en ce genre commencent
par faire tirer les épreuves du noir:
mais tous s’accordent à mettre dans le même
rang le tirage des planches deftinéesaux quatre
couleurs. Quand on imprime d’abord la planche
noire , on en tait fécher l’épreuve , 8c fueceflive-
ment les épreuves de chaque planche avant de
tirer ce;I:s de la planche Cuvante. Quelquefois,
fuivant la couleur du deffin , ôn peut fe contenter
de quatre planches ; mais on ne fe pafle jamais
de celle qui s’imprime en noir.
Il ne nous refte plus qu’à indiquer les fubftan-
ces dont on fait ufage pour les différentes coupleurs.
-
Jaune. Stil-de-grain de Troies. On y mêle
plus ou moins de blanc de plomb , fuivant la
teinte qu’exige le deflln.
Pieu, Bleu de Pruffe. C’ eft le feul qui convienne
à ce genre. On a effayé fans Juccès des
couleurs plus précieufes. Seul, il feroit gras : oit
le dégraiffe en y mêlant du fel de talc en fort-
petite quantité. On fait entrer du blanc dans cette
teinte fuivant le befoin.
Carmin.
Petit-rouge Vermillon , mêlé de carmin ou
de-blanc de plomb , fuivant la force du ton.
Nous avons nommé les principales couleurs
dont on fait ufage dans ce genre : mais on peut
les ÿ rompre par d’autres, & le choix dépend dé
l’ intelligence de l’artifte. On fait d’ ailleurs que
toutes les couleurs doivent être bien purifiées,
bien broyées , & avoir toute la tranfparence
dont elles font fulceptibles. Elles fe détrempent
à l ’huile, comme dans la Gravure en couleurs de
Leblon.