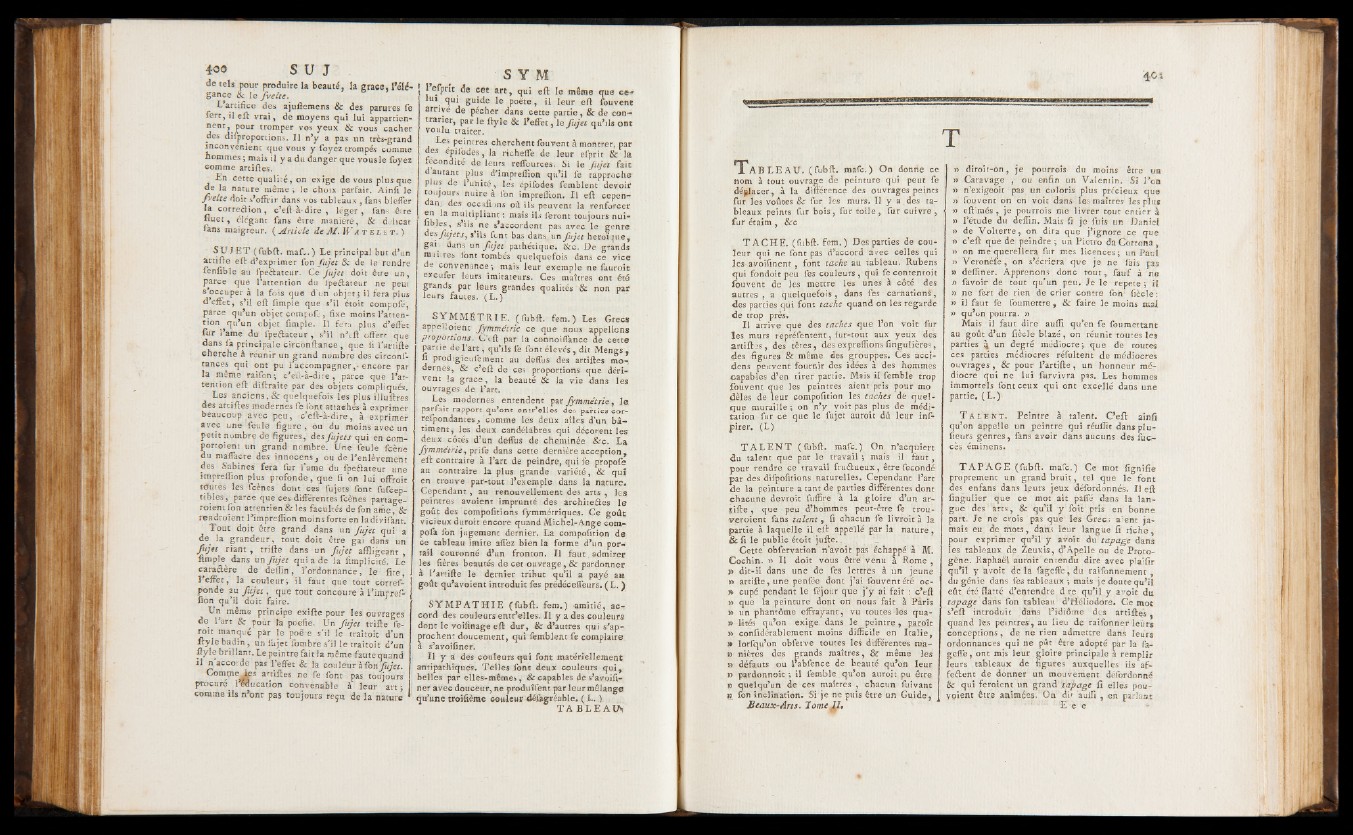
*oo s U J
gance de tels pour le produire la beauté, la grâce, l’élé&
Jvelte.
L’artifice des ajuüemens & des parures fe
fert, il eft v ra i, de moyens qui lui appartiennent,
pour tromper vos yeux & vous cacher
des disproportions. I l n’y a pas un très-grand
inconvénient que vous y foyez trompés comme
hommes ; mais il y a du danger que vous le foyez
comme artifles.
En cette qualité, on exige de vous plus que
de la nature même ; le choix parfait. Ainfi le
Jvelte doit s’offrir dans vos tableaux , fans bleffer
la correélion, c’eft à-dire , lé g e r , fans êire
flu e t, élégant fans être maniéré, 8c délicat
fans maigreur. ( Article de M . WA t e l e t . )
S U J E T (fubft. maft. ) Le principal but d’ un
artifte eft d’exprimer fon fujet & de le rendre
fenfible au fpeélateur. Ce Jujet doit être un
parce que l’attention du ipeêlateur ne peui
s'occuper à la fois que d'un objet ; il fera plus
d’effet, s’ il eft fimple que s’ il étoit compofé,
parce qu’un objet compofj, fixe moins l’attention
qu’un objet fimple. Il fera plus d’effet
fur l’ame du fpeélateur , s’ il n’ «_ft offert que
dans fa principale circonfiance , que li l’artifte
cherche â réunir un grand nombre des circonf-
tances qui ont pu l’accompagner ,* encore par
la même raifon; c’ eit-à-dire , parce que Fat-
tendon eft diftraite par des objets compliqués.
Les anciens, & quelquefois les plus illuftres
des artiftes modernes fe font attachés à exprimer
beaucoup avec peu, c’ eft-à-dire, à exprimer
avec une feule figure , ou du moins avec un
petit nombre de figures, des fuje ts qui en com-
portoient un grand nombre. Une feule fcène
du maflacre des innocens ou de l ’enlèvement
des Sabines fera fur l’ame du fpeélateur une
impreflion plus profonde, que fi on lui offroit
tçrutès les fcènes dont ces fujets font fufcep-
tib les, parce que ces differentes fcènes partage-
roientfon attentien & les facultés de fon ame &
rendroîent Fimpreflion moins forte en ladivifant.
Tout doit être grand dans un fujet qui a
de la grandeur, tout doit être gai dans un
f i j e t r ia n t, trille dans un fujet affligeant ,
fimple dans un fu je t qui a de la fimplické. Le
cara&ère de deffin, l’ordonnance , le fite, .
l'e ffe t , la couleur; il faut que tout corref-
ponde au fu je t , que tour concoure à Fimeref-
fion qu’ il doit faire.
Un même principe exifte pour les ouvrages
de Fart & poùr fa poëfie. Un fujet trille fe-
*?‘lt manqué par le poé:e s’ il le traitoit d’ un
fryle badin, un fujet fombre s’il le traitoit d’ un
ftyle brillant. Le peintre fait la même faute quand
il n accorde pas l’effet & la couleur à Ion fujet.
Comme des artiftes ne fe font pas toujours
procuré l'éducation convenable à leur ar t; i
comme ils n’ont pas toujours reçu de la nature
S Y M 1 efprit de cet a r t, qui eft le même que ce*
lui qui guide le poète, il leur eft fouvene
arrivé de pécher dans cette partie, & de contrarier,
par le ftyle & l'effet, le fujet qu’ ils ont
voulu traiter.
Les peintres cherchent fouvent à montrer, par
des épilodes, la richeffe de leur efprit & la
fécondité de leurs reffources. Si le fujet fait
d autant plus d’impreflion qu’ il fe rapproche
plus de l ’unité, les épifodes femblent devoir
toujours nuire à fon impreflion. Il eft cependant
des occafi >ns où ils peuvent la renforcer
en la multipliant : mais ils feront toujours nuisibles,
s’ ils ne s’accordent pas avec le genre
ues fujets, s’ ils font bas dans un fujet héroïque,
gai . dans un fujet pathétique. tkc. De grands
mai.res lont tombés quelquefois dans ce vice
de convenance ; mais leur exemple ne fauroic
excufer leurs imitateurs. Ces maîtres ont été
grands par leurs grandes qualités & non par
leurs fautes. (L .)
S Y M M Ë T R I E. (fubft. fem. ) Les Grecs
appelaient fymmétrie ce que nous appelions
proportions. C ’eft par la connoiffance de cette
partie de Fart, qu’ils fe font élevés, dit Mengs ,
fi prodîgieufement au deffus des artiftes modernes,
& c’eft de ces proportions que dérivent
la grâce, la beauté & la vie dans les
ouvrages de Fart.
Les modernes entendent par fymmétrie, le
parfait rapport qu’ont entr’elles des parties cor-
refpondantes, comme les deux ailes d’un bâtiment,
les deux candélabres qui décorent les
deux côtés d’un deffus de cheminée fkc. La
fymmétrie, prile dans cette dernière acception ,
eft contraire à l ’art de peindre, qui fe propofe
au contraire la plus grande variété, & qui
en trouve par-tout l’ exemple dans la nature.
Cependant, au renouvellement des arts , les
peintres avoient imprumé des architeéles le
goût des compofitions fymmétriques. Ce goûc
vicieux duroit encore quand Michel-Ange com-
pofa fon jugement dernier. La compofition de
ce tableau imite affez bien la forme d’ un portail
couronné d’ un fronton. I l faut, admirer
les fières beautés de cet ouvrage, & pardonner
à Fartifte le dernier tribut qu’il a payé au
goût qu’avoient introduit fes prédéceffeurs. ( L. )
S Y M P A T H I E (fubft. fem.) amitié, accord
des couleurs entr’elles. I l y a des couleurs
dont le voifinage eft dur, & d’autres qui s’approchent
doucement, qui femblenc fe complaire
à s’ avoifiner.
I l y a des couleurs qui font matériellement
antipathiques. Telles font deux couleurs q ui,
belles par elles-mêmes, & capables de s’avoifi-
ner avec douceur, ne produîfent par leur mélange
qu’une troifième couleur défagréable. ( L. ) ;
T A B L E A U V
'401
T
T A B L E A U , (fubft. mafe.) On donne ce
nom à tout ouvrage de peinture qui peut fe
déplacer à la différence des ouvrages peints
fur les voû&es 8c fur les murs. Il y a des tableaux
peints fur bois, fur to ile , fur cuivre ,
fur étaim , 8cc
T A C H E , (fubft. fem.) Des parties de couleur
qui ne font pas d’accord avec celles qui
les avoifinent , font tache au tableau. Rubens
qui fondoit peu fes couleurs , qui fe contentoit
louvent de les mettre les unes à côté des
autres , a quelquefois, dans fes carnations,
des parties qui font tache quand on les regarde
de trop près.
I l arrive que des tacfies que l’on voit fur
les murs repréfentent, fur-tout aux yeux dés
artiftes, des têres, des expreflions fingulières,
des figures & même des grouppes. Ces acci-
dens peuvent fournir des idées à des hommes
capables d’ en tirer partie. Mais il femble trop
fouvent que les peintres aient pris pour mo
dèles de leur compofition les taches de quelque
muraille ; on n’y voit pas plus de méditation
fur ce que le fujet auroit dû leur infé
r e r . (L)
T A L E N T (fubft. mafe.) On n’acquiert
du talent que par le travail ; mais il fa u t,
pour rendre ce travail fru&ueux, être fécondé
par des difpofitions naturelles. Cependant Fart
de la peinture a tant de parties différentes dont
chacune devroit fuffire à la gloire d’un ar- i
tifte , que peu d’hommes peut-être fe rrou- .
veroient fans talent, fi chacun fe livroit à la
partie à laquelle il eft appellé par la nature,
& fi le public étoit jufte..
Cette obfervation n’avoit pas échappé à M.
Cochin. » I l doit vous être venu à Rome ,
» dit-ii dans une de fes lettres à un jeune
» artifle,une penfée dont j’ai fouvent été oc-
» cupé pendant le féjour que j’y ai fait : c’ eft
» que la peinture dont on nous fait à Paris
» un phantôme effrayant, vu toutes les qua-
» lités qu’on exige dans le peintre, paroît
» confidérablement moins difficile en Italie,
» lorfqu’on obferve toutes les différentes nia-
» nières des grands maîtres, & même les
» défauts ou l’abfence de beauté qu’on leur
» pardonnoit ; il femble qu’on auroit pu être
» quelqu’ un de ces maîtres , chacun fuivant
» fon inclination. Si je ne puis être un Guide,
Meaux-Arts. Tome I I ,
» diroit-on, je pourrois du moins être un
» Caravage , ou enfin un Valentin. Si Fon
» n’exigeoit pas un coloris plus précieux que
» fouvent on en voit dans les maîtres les plu*
» eftimés , je pourrois me livrer tout entier à
» l’étude du deflin. Mais fi je fuis un Daniel
» de Volterre , on dira que j’ ignore ce que
» c’eft que de peindre ; un Pietro da Cortona
» on me querellera fur mes licences ; un Paul
» Veronèfe, on s’écriera que je ne fais pas
» defliner. Apprenons donc tou t, fauf à ne
» favoir de tout qu’ un peu. Je le répété ; il
» ne fert de rien de crier contre fon fiècle:
» il faut fe foumettre, 8c faire le moins mal
» qu’on pourra. »
Mais il faut dire auffi qu’en fe foumettanc
au goût d’ un fiècle blazé, on réunit toutes les
parties ^ un degré médiocre; que de toutes
ces parties médiocres réfultent de médiocres
ouvrages , & pour l’artifte, un honneur médiocre
qui ne lui furvivra pas. Les hommes
immortels font ceux qui ont excellé dans une
partie. (L .)
T a l e n t . Peintre à talent. C’eft ainfi
qu’on appelle un peintre qui réulfit dansplu-
fieurs genres, fans avoir dans aucuns des fuc-
cès éminens.
T A P A G E (fubft. mafe.) Ce mot lignifie
proprement un grand b ruit, tel que le font
des_ enfans dans leurs jeux défordonnés. Il eft
fingulier que ce mot ait paffé dans la langue
des arts, & qu’il y foit pris en bonne
part. Je ne crois pas que les Grecs aient jamais
eu de mots, dans leur langue fi r ich e ,
pour exprimer qu’ il y a voit du tapage dans
les tableaux de Zeuxis, d’ Apelle ou de Protogène.
Raphaël auroit entendu dire avec pïalfir
qu’ il y âvoit de la fageffe, du raifonnement,
du génie dans fes tableaux -, mais je doute qu’il
eût été flatté d’entendre d re qu’ il y a voit du
tapage dans fon tableau d’Héliodore. Ce mot
s’eft introduic dans l’ idiôme des ar tifte s,
quand les peintres, au lieu de raifonner leurs
conceptions, de ne rien admettre dans leurs
ordonnances qui ne pût être adopté par la fageffe,
ont mis leur gloire principale a remplir
leurs tableaux de figures auxquelles ils af-
feélent de donner un mouvement défordonné
8c qui feraient un grand tapage fi elles pou-
yoient être animées/ On dk ‘auffi, en parlant