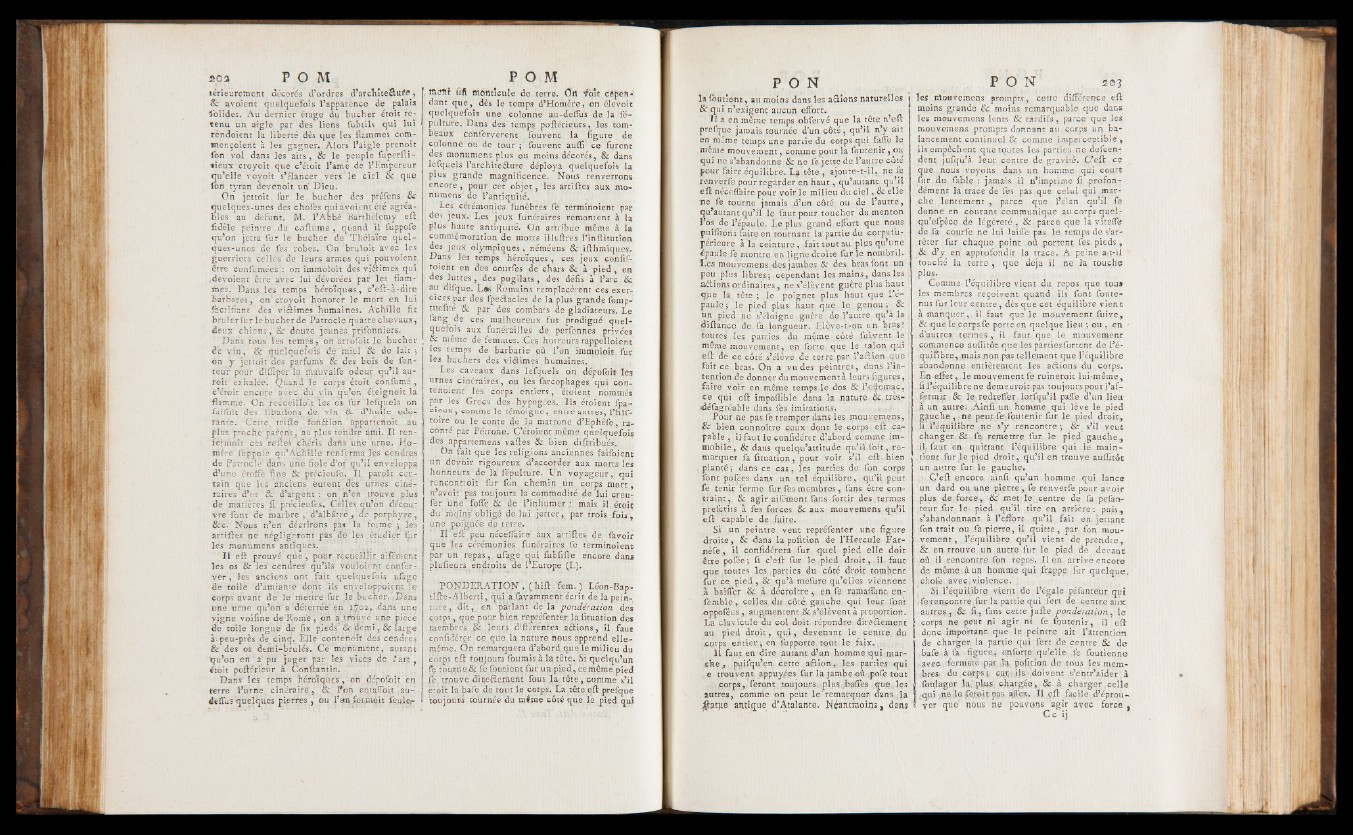
tcrieuretnent décorés d’ordres d’archite&ufë,
& ayoient quelquefois l’apparence de palais
îolides. Au dernier étage au bûcher étoit retenu
un aigle par des liens fubtils qui lui
rèndoient la liberté dès que les flammes com-
inençoient à les gagner. Alors l’aigle prenoit
l'on vol dans les airs, & le peuple fuperfti-
*ieux croyoit que c’étoit l’ame dè l’ Empereur
qu’elle voyoit s’ élancer vers; le ciel 8c que
fon tyran devenoit un Dieu.
On jettoit . fur le bûcher des préféns 8c
quelques-unes des choies qui àvoiënt été agréables
au défunt. M. l’Abbé Barthélemy eft
fidèle peintre du coftume , quand il fuppofe
qu’ on jetta fur le bûcher de Thélaïre quelques
unes de fes robes. On bruloit avec les
guerriers celles de leurs armes qui pouvoient
être confumées.: on immoloit des viélinies qui
^dévoient être avec lui dévorées par lès flammes.
Dans les temps héroïques , c’eft-à-dire
barbares, on croyoit honorer le mort, en lui
fàcrifiant des vi&imes humaines. Achille fit
brûler fur le bûcher de Patrocle quatre chevaux,
deux chiens, & douze jeunes prifonniers.
Dans .tous les temps , on arrofoit lé bûcher ,
de v in , & quelquefois dé miel & .d e lait ;
on y jettoit des parfum’s 8c des bo.is de lenteur
pour dilîiper la maiiyaife odeur qu’ il au-
roit exhalée. Quand ïe corps étoit confumé,
c’croit encore avec .dti vin qu’on, éteignoit la
flamme. On recueilïoit les os fur lëfqiiels on
failoit des'libations de. vin & d’huile, odorante.
Cette, trifte ' fonâion àppartenoït. au
plus proche fcafen't j au plus tëqdrp anii. Il ren-
fermoit ces r eft es chéris dans une urne. Homère
fuppofè q if Achille renferma Tes cendres
de Patrocle' dans une fiole d’or qu’ il enveloppa
d’une étoffé fine & précieufe. I l paroît certain
que les anciens eurent dès urriés cinéraires
d’or &' d’argent : on n’ en trouve plus
de matières fi précieufes. Celles; qu’on découvre
font de marbre , d’albatrë^ dé porphyre,
& c . Nous n’ en décrirons pas la forme y les
artfftes ne négligeront pas de les étudier fiir
lès mojitimens antiques, .
I l eft prouvé q tie, pour recueillir aifement
les os & les cendres qu’ils voüloient confier-:
v e r , les anciens ont fait quelquefois plage
de .toile d’amiante dont ils enveloppoient le
corps avant de le mettre fiir ,'le^bucher. Dans
une urne qu’on a déterrée en f^oz, dans une
vigne voifine de'R.om’é , on aj'rdùyé une pièce
de toile longue de fix pieds & demi i & large
à-peu-près de cinq. Elle contehôît des cendres
& des os demi-brulés. Ce monument, autant
q u’on en a pu juger par les vices de i a r t ,
étoit poftérleur à Conftantin.
Dans- 1 es temps hérôïqûes, on depofoit en
terre l’urne cinéraire , 8c Pon entaffoit ,au-
deflus quelques pierres , ou l’an formait feuler
iflsïft Ûfi monticule de terre. On fa it cêjtèh*
dant que, dès le temps d’Homère, on élevoit
quelquefois une colonne au-deflus de la fé-
pulture. Dans des temps poftérieurs, les tombeaux
conferverent fouyent la figure de
colonne ou de tour ; fouvent aufli ce furent
des monumens plus ou moins décorés, & dans
lefquels l’archite&ure déploya quelquefois la
plus grande magnificence. Nous renverrons
encore, pour cet ob je t, les artiftes aux monumens
de l’antiquité.
Les cérémonies funèbres fe terminoient paf
des jeux. Les jeux funéraires remontent à la
plus haute antiquité. On attribue même à la
commémoration de morts iiluftres Tinftitution
des jeux olympiques, néméens & ifthmiquès.
Dans les temps héroïques, ces jeux eonfiP-
toieht en des courfes de chars & à pied , en
des luttes, des pugilats, des défis à l’arc 8c
au difque. Lés Romains remplacèrent ces exercices
par des fpeélacles de la plus grande fomp-
tuofité 8c par des combats de gladiateurs. Le
fang de ces malheureux fut prodigué quelquefois
aux funérailles de perfonnes privées
8c même de femmes. Ces horreurs rappelloient
les temps de barbarie pu l’on immoloit fur
les bûchers des viâimes humaines.
Les caveaux dans lefquels on depofoit les
urnës cinéraires, ou les farcophages qui con-
tenoient les corps entiers, étoient nommés
par les Grecs des-hypogées. Ils étoient fpa-
cieu x , comme le témoigne, entre autres, l’hif-
toiré ou le conte de la matrone d’Ephèfe, raconté
par Pétrone. Ç’étoient même quelquefois
des appartemens vaftes & bien diftribués.:
On fait que les religions anciennes faifoient
un devoir rigoureux d’accorder aux morts les
honneurs de la fépulture. Un voyageur, qui
fencontioit fur fon chemin un corps mort,
n’avoit pas toujours la commodité de lui creu-
fer une'fofle tk de l’ inhumer.:, mais il étoit
du‘'moins obligé de lui jerter, par trois fois ,
une poignée de terre.
I l 1 eft'peu nécefiaire âu.x. arr.iftesj <Je. fa voir
quë les cérémonies funéraires le terminaienc
par un repas, üfage qui iuÜfifte encore dans
plufieûrs endroits de l’Europe (L).
PONDERATION , ( hift fem. _) Léon-Bap-
tifte- A 11?ei t i q u i ’a,Çavam,men j écrit de la peinturé,
d it, en parlant de fa pondération des
corps , que pour bien repréfenter lafituation des
membres leurs différentes a étions, il faut
conlidérer ce. que la nature nous apprend elle-
même. On remarquera d’abord, .que, le milieu du
corps eft toujours fournis à la tête. Si quelqu’ un
fe tourne & fe foutient fur un pied, ce même pied
ïe( trouvé di j;eétem.ent fous j a tête, comme s’ il
étoit. la bafe de tout le corps., La tête eft prefque
toujours tournée du même côté que le pied qui
la fbut’ent, au moins dans les aétions naturelles
& qui n’exigent aucun effort.
Il a en même temps obfervé que la tête n’eft
prefque jamais tournée d’un côté^ qu’ il n’y ait
en même temps une partie du corps qui faite le
meme mouvement, comme pour la foutenir, ou
qui ne s’abandonne 8c ne le,jette de l’autre côté
four faire équilibre. La tête , ajoute-t-il, ne fe
renyerfe pour regarder en haut, qu’autant qu’ il
eft nécefiaire pour voir le milieu au c ie l, & elle
ne fe tourne jamais d’un côté ou de l’autre,
qu’autant qu’il le faut pour toucher du menton 1 os de l’épaule. Le plus grand effort que nous
puiflidris raireen tournant la partie du corpsfu-
périeure à la ceinture, fait tout au plus qu’ une ;
épaulé fe montre en ligne droite fur le nombril. ;
Les mouvemens des jambes & des bras font un ;
peu plus libres; cependant les mains, dans les s
aélions ordinaires, ne s’élèvent guère plus haut
qpe la tête ; le poignet plus haut que l ’épaule;'
le pied plus haut que le genou; &
un pied; ne s’éloigne guère de l’ autre, qu’ a la ,
■ diftan.ee de fa longueur. Elève-t-on un bras?
toutes ;-les parties, du même coté fuivent le j
même mouvement, en forte-que le talon qui
eft de ce côté s’élève de terre par l’aéllon que '
fait ce bras. On a vu des peintres, dans l’intention
de donner du mouvement à leurs figures, :
faire voir en même temps le dos 8c l’;e$omac, j
ce qui eft impoffible dans la nature & , très-j
défagréable dans fes imitations.
Pour ne pas fe tromper dans les mouvemeçis, [
& bien connoître ceux dont le corps eft capable
, il faut le conlidérer d’abord comme immobile,
& dans quelqu’attitude qu’ il foit, remarquer
fa fituation, pour voir s’il eft. bien
planté -, dans ce cas , les parties de fon corps
font poleés dans un tel équilibre, qu’il peut
fe tenir ferme fur fes membres , fans être contraint
, & agir^aifément fans. fortir des termes
prel’erits à fes forces & aux mouvemeps qu’ il
eft capable de faire.
Si un peintre veut repréfenter une figure
droite, & dans la pofition de l’Hercule Far-
nèfe, il confidérera fur quel pied elle doit
être pofée; II c’eft fur le,pied droit, il faut
que toutes les,,parties du côté droit tombent
lur ce pied , 8c qu’à- mefure qu’ elles viennent
•à baiffer & à, décroître en fe ramaffant. en-
.fenible, celles> du côté, gauche qui leur font
oppofées , augmentent ,& s’élèvent à proportion.
La clavicule du col doit répondre <fireftenient
au pied droit, q u i, devenant le .pentrè, du
^orps entier,; en fupporte tout, le faix.
11 faut en dire autant d’un homme qui,marc
h e , puifqu’ çn. cette aélion, les. parties- qui
e trouvent,:appuyléps: fur la jambe;OÙ ,pofe tout
corps,,feront,joujou,rs plu^jhafies quelles
autres, comme on peut le'remarquer; dans, la
jÇatjie antique d’Atalante. Néantmoins, dans
les mouvemens prompts, cette différence eft
moins grande 8c moins remarquable que dans
les mouvemens lents-& tardifs, pa"ce que les
mouvemens prompts donnant au ccrps un balancement
continuel & comme imperceptible,
ils empêchent que toutes les partie? ne defeen-
dent jufqu’à leur centre de gravi:ê. C’eft ce
que nous voyons dans un homme qui court
fur du fable : jamais il n’ imprime fi profondément
la trace de fes pas que celui qui marche
lentement , parce que l’élan qu’il fe
donne en côurant communique au corps quel-
qu’ efpèce de légèreté , & parce que la viteffe4
de fa courfe ne lui J ai fie pas le temps de s’arrêter
fur chaque point où portent fes pieds ,
& d’y en approfondir la trace. A peine a-t-il
touché la te r re , que déjà il ne la touche
plus.
Comme l’équilibre vient du repos que tous
les membres reçoivent quand ils font foute-
nus fur leur centre, dès que cet équilibre vient
à manquer ,, il faut que le mouvement fuive,
& que le. corpsfe porte en quelque lieu ; ou , en •
d’autres • termes , il faut que le mouvement
commence aulTitôt que les partiesfortent de l’é*
.quinbre, mais non pas tellement que l’équilibre
a.bandonne entièrement les aélions du corps.
En effet, le mouvement le ruineroit lui-même,
fi l ’équilibre ne demeuroit pas toujours poürl’af-
fermir & le,redi;efler_lorfqu’ il pafie a’ un lieu
ê un auttei^A-infi un homme qui lèye le pied
gauche , -ne peu;t,fe:foutenir fur le pied droit,
fi, l’équilibre ne s’y rencontre ; & s’ il veut
çhapger. & fq- remiettre fur le pied gauche,,
ilj faut ën quittant l’équilibre, qui le maintient
fur ie pied droit, qu’ il en trouve aulfitôt
un autre fur le gauche.
. C’eft encore ainfi qu’ un homme qui lance
un dard ou une pierre, fe renverfe pour avoir
.plus de force,; oc met le xentre de fa pefanr
■ teur fur , le ‘ pied qu’il tire en arrière^: puis^
s’abandonnant à l’ effort , qu?if fait en jettant
fon trait ou fa pierre, il quitte, par fon mou-
-vement, l’équilibre qu’ il vient de prendre,
& en trouve un autre fur le pied de devant
où il rencontre fon repos. l i en arrive encore
de même;à un homme qui frappe .fur quelque,
chofe avec^yiolenee. ;
Si l’équilibre vient de l’égale péfanteur qui
ife;rencontre fur la partie qui fert de centre aux
autres , 8c fi;, fans cette jufte pondération, le
corps ne peut ni agir ni fe foutenir, il eft
donc important que le peintre ait l’attention
de charger la. partie qui fert de centre & de
bafe à fa fig^re.ÿ enforte qu’e lle .;fe foutienne
.avec fermëté par pofition de tous les membres;
du corps;, çai^ils doivent s’entr’aider à
.foulager la. plus chargée». & à charger celle
^qp.i iPe(le. jferoit pas %ffez. I l ^eft facile d’éprou^
yer que nous ne pouvons agir avec force ,
C e ij