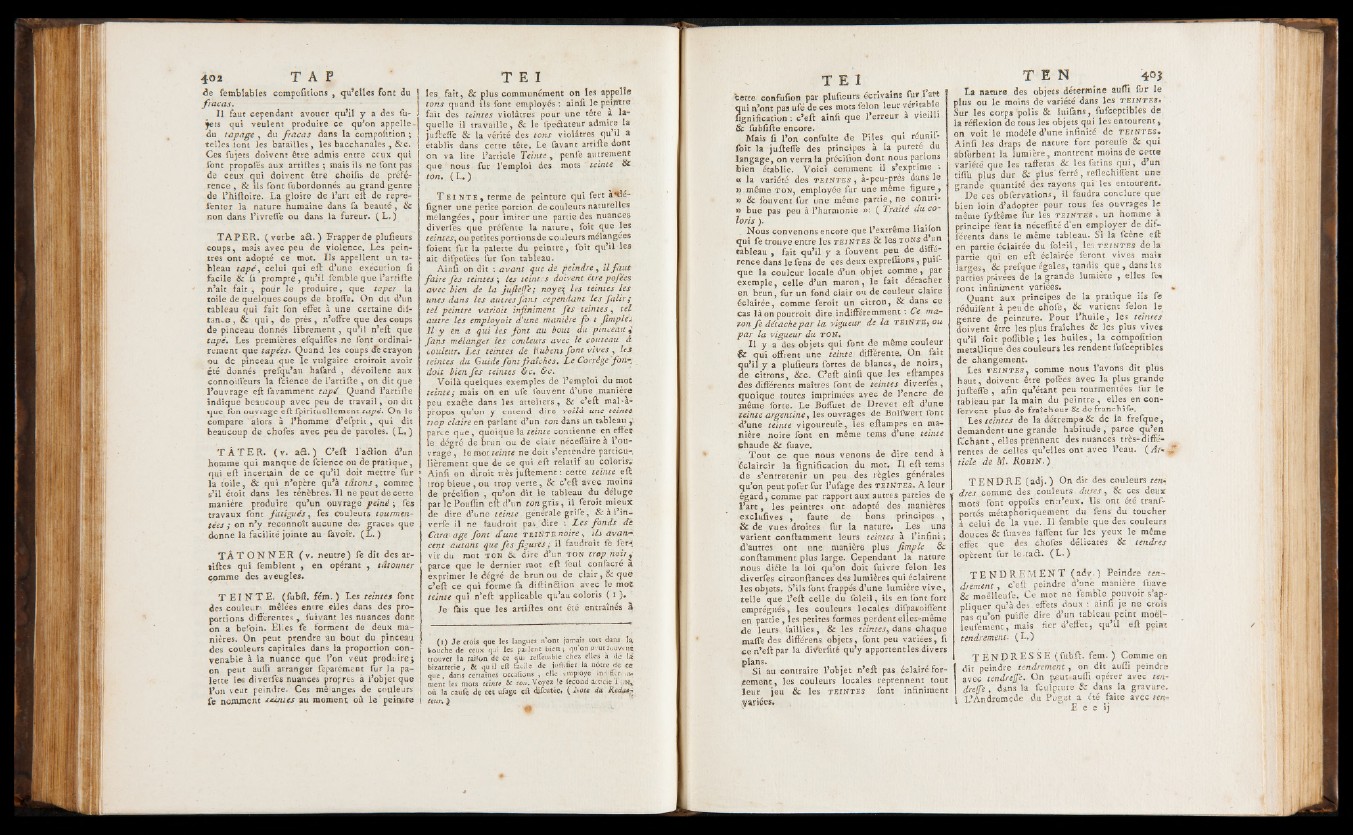
402 T A P
àe femblables compofitions , qu’ elles font du
fracas.
Il faut cependant avouer qu’il y a des fumets
qui veulent produire ce qu’on appelle-
du tapage , du fracas dans la Compolition ;
telles dont les batailles, les bacchanales , &c.
Ces fujets doivent être admis entre ceux qui
font prppôles aux artiftes ; mais ils ne font pas
de ceux qui doivent être choifts de préférence
, & ils font fubordonnés au grand genre
de l’hiftoîre. La gloire de l’art eft de rep»-ë-
l ’enter la nature humaine dans la beauté, &
non dans l’ ivrelfe ou dans la fureur. ( L, )
T A P E R , (verbe a&. ) Frapper de plufieurs
coups, mais avec peu de violence. Les peintres
ont adopté ce mot. Ils appellent un tableau
tapéy celui qui eft d’une exécution fi
facile & fi prompte, qu’ il femble que l’artifte
n’ait f a i t , pour le produire, que taper la
toile de quelques coups de brofle. On dit d’ un
tableau qui fait l’on effet à une certaine dil-
tan-e , & q u i, de près , n’olfre que des coups
de pinceau donnés librement, qu’ il n’eft que
tapé. Les premières efquiffes ne font ordinairement
que tapées. Quand les coups de crayon
ou de pinceau que le vulgaire croiroit avoir
cté donnés prefqu’ au hafard , dévoilent aux
connoilfeurs la fcience de l’artifte , on dit que
l ’ouvrage eft favamment tapé- Quand l’artifte
indique beaucoup avec peu de travail, on dit
que Ion ouvrage eft fpiricuellement tapé. On le
compare alors à l’homme d’efprit, qui dit
beaucoup de chofes avec peu de paroles. ( L . )
T Â T E R . ( v. ad . ) C’eft 1 a&ion d’ un
homme qui manque de fcience ou de pratique,
qui eft incer^in de ce qu’ il doit mettre fur >
la ^oile, & qui n’opère qu’à tâtons, comme
s’ il étoit dans les ténèbres. I l ne peut de cette
manière produire qu’ un ouvrage peiné , . fes
travaux font fatigués y fes couleurs tourmentées
i on n’y re.connoît aucune des grâces que
donne la facilité jointe au ravoir. (L. )
T Â T O N N E R ( v . neutre) fe dit des artiftes
qui femblent , en opérant , tâtonner
cjaxnme des aveugles.
T E I N T E , (fubft. fém. ) Les teintes font
des couleurs mêlées entre elles dans des proportions
differentes , fuivant les nuances dont
on a befoin. Eli es fe forment de deux manières.
On peut prendre au bout du pinceau
des couleurs capitales dans la proportion convenable
à la nuance que l’on veut produire3
on peut auifi arranger féparément fur la palette
les diverfes nuances propres à l’objet que
l ’on veut peindre. Ces mélanges de couleurs
fe nomment saintes au moment où le peintre |
T E I
les. fait, & plus communément on les appelle
tons quand ils font employés : ainfi le peintre
fait des teintes violâtres pour une tête a laquelle
il travaille, & le fpeélateur admire la
juftefle & la vérité des tons violâtres qu il a
établis dans cette tête. Le favant artifte dont
on va lire l’article Teinte, penfe autrement
que nous fur l ’emploi des mpts ' teinte &
ton• ( L. )
T e i n t e , term e de p ein tu re q u i fe rt a^ue-
fig n er une petite p o rtio n de couleurs n atu relles
m élan g ées, pour im ite r une partie des nuance?
diverfes q u e préfente la n a tu re , foit que les
teinteSy ou p etites portions de co u leu rs m élangées
fo ien t fur la p alette du p e in tre , fo it q u ’il les
a it difpofées fu r fon ta b le a u .
Ainfi on dit : avant que de peindre y il fa ut
faire fe s teintes ; les teintes doivent être pofées
avec bien de la jufiejfe; noye\ les teintes les
unes dans les autres fans cependant les fa lir ,*
tel peintre varioit infiniment fies teintes, tel
autre les employait d’une manière fa t fimplei
I l y en a qui les font au bout au pinceau
fans mélanger les couleurs avec le couteau a
couleur. Les teintes de Rubens font vives , les
teintes du Guide font fraîches. Le Corrige fon-
doit bien fe s teintes &c. &c.
Voilà quelques exemples de l’emploi du mot
teinte ; mais on en ufe fouvent d’une manière
peu exafte dans les atteliers, & c’eft mal-a-
propos qu’on y entend dire voilà une teinte
trop claire en parlant d’un ton dans un tableau
parce que, quoique la teinte contienne en effet
le dégré de brun ou de clair néceffaire a l’ouvrage
, le mot teinte ne doit s’entendre particu-
fièrement que de ce qui .eft relatif au coloris»
Ainfi on diroit très juftement : cette teinte eft
trop bleue, ou trop verte, & c’ eft avec moins
de précifion , qu’on dit le tableau du déluge
par le Pouflin elt d’ un ton g r is , il feroit mieux
de dire d’ une teinte générale grîfe, & a l’ in-
verfe il ne faudroit pas dire : Les fonds de
Caravâge font d'une t e in t e noire y ils avan
cei}t autant que fe s figures ; il faudroit fe fer*,
vir du mot t o n & dire d’ un t o n trop noir ÿ
parce que le dernier mot eft leul confacre a
exprimer le dégré de brun ou de c la ir , & que
c’eft ce qui forme fa diftinélion avec le mot
teinte qui n’eft applicable qu’au coloris ( 1 )•
Je &is que les artiftes ont été entraînés a
(1) Je crois que les langues n’ont jamais tort dans la
bouche (le ceux qui les pailenc bien; qu on peut louve ut.
trouver la rai fon de ce qui reffemble chez elles a de la
bizarrerie , & qu il eft facile de juflifier la nôtre de ce
que, dans certaines occafions , elle uup.oye mrbffcr. ,i>
ment les mors teinte & ton. Voyez le fécond ai cicle I
où la caufe de cet ufage eft difeutée» ( h o u du Rtdafr
teur, )
T E I
b e tte confufion p ar plufieurs écriv ain s fu r 1 a tt
q u i n ’o n t pas ufé de ces m ots félon le u r ver» table
lign ification : c’e ft ainfi q u e l’e rre u r a v ieilli
& fubfifte en core.
Mais fi l’on confulte de Piles qui réunif-
foit la juftefle des principes à la purete du
langage, on verra la précifion dont nous parlons
bien établie. Voici comment il s’exprime ••
« la v ariété des te in te s , à-peu-près dans le
» m êm e t o n , em ployée fur une m êm e fig u re y
» & fouvent fu r une m êm e p a rtie , n e co n tri-
» b u e pas peu à l’h arm o n ie »: ( Traité du coloris
).
. Nous convenons encore que l’extrême liaifon
qui fe trouve entre les t e in t e s & les t o n s d’ un
tableau , fait qu’il y a fouvent peu de différence
dans le fens de ces deux expreffions, puisque
la couleur locale d’un objet comme, par
exemple, celle d’un maron, le fait détacher
en brun, fur un fond clair o.u de couleur claire
éclairée, comme feroit un citron, & dans ce
Cas làonpourroit dire indifféremment : Ce maton
fe détache par la vigueur de la te iNte , ou
par la vigueur du ton.
I l y a des objets qui font de même couleur
& qui offrent une teinte différente. On fait
qu’ il y a plufieurs fortes de blancs, de noirs,
de citrons, & c. C’eft ainfi que les eftampes
des différents maîtres font de teintes diverfes,
quoique toutes imprimées avec de l’encre de
même forte. Le Bofluet de Drevet eft d’une
teinte argentine y les ouvrages de Bolfwert font
d’une teinte vigoureufe, les eftampes en manière
noire font en même tems d’ une teinte
phaude & fuave.
Tout ce que nous venons de dire tend a
éclaircir la lignification du mot. I l eft tems
de s’ entretenir un peu des règles générales
qu’on peut pofer fur l’ ufage des t e in te s . A leur
égard, comme par rapport aux autres parties de '
l ’a r t , les peintres ont adopté des manières
exclufives , faute de bons principes ,
& de vues droites fur la nature. Les uns
varient conftamment leurs teintes à l’ infini ;
d’autres ont une manière plus fimple &
conftamment plus large. Cependant la nature
nous diéke la loi qu’on doit fuivre félon les
diverfes circonftances des lumières qui éclairent
les objets. S’ ils font frappés d’une lumière v iv e ,
telle que l’eft celle du foleil, ils en font fort
emprégnés, les couleurs locales difpacoiflent
en partie, les petites formes perdent elles-même
de leurs\ faillies , & les teintes, dans chaque
maffe des différens objets, font peu variées, fi
ce n’eft par la dhferfité qu’y apportent les divers
plans. | , . r
Si au contraire l’objet n’eft pas éclairé fortement,
les couleurs locales reprennent tout
leur jeu & les t e in t e s font infiniment
yayiées.
T E N
La nature des objets détermine aufli fur le
plus ou le moins de variété dans les t e in t e s *
Sur les corps 'polis & luifans, fufceptibles de
la réflexion de tous les objets qui les entourent,
on voit le modèle d’une infinité de t e in t e s •
Ainfi les draps de nature fort poreufe & qui
abforbent la lumière, montrent moins de cette
variété que les taffetas.& les fatins q ui, d’un
tiflu plus dur & plus’ ferré, reflechiffent une
grande quantité des rayons qui les entourent.
De ces obfervations, il faudra conclure que
bien loin d’adopter pour tous fes ouvrages le
même fyftême fur les te in te s , un homme à principe fent la nécefïité d’ en employer de différents
dans le même tableau. Si la fcène eft:
en partie éclairée du fole il, les t e in te s de la
partie qui en eft éclairée feront vives mais
larges, & prefque égales, tandis que , dans les
parties privées de la grande lumière , elles fe*
ront infiniment variées. # *
Quant aux principes de la pratique ils fe
réduifent à peu de chofe, & varient félon le
genre de peinture. Pour l’huile , les teintes
doivent être les plus fraîches & les plus vives
qu’ il foit poflible; les huiles , la compofition
métallique des couleurs les rendent fufceptibles
de changement. .
Les t e in t e s , comme nous l’avons dit plus
haut, doivent être pofées avec la plus grande
juftefle , afin qu’étant peu tourmentées fur le
tableau par la main du peintre , elles en con-
fervent plus de fraîcheur & de franchife.
Les teintes de la détrempe & de la frefque,
demandent une grande habitude, parce qu’ en
C ch an t, elles prennent des nuances très-diffé-
rentes de celles qu’elles ont avec l’ eau. ( Al- S ticle de M- Robin-)
T E N D R E (a d j.) On dit des couleurs tendres
comme des .couleurs dures, & ces deux
mots font oppofc's entt’ eux. Ils ont été tranf-
portés métaphoriquement du fens du toucher
à celui de la vue. I l femble que des couleurs
douces & fuave s faffent fur les yeux le même
effet que des chofes délicates & tendres
opèrent fur le tact. (L . )
T E N D R E M E N T (adv, ) Peindre tendrement
, c’eft peindre d|uné manière fuave
& moëlleufe. Ce mot ne femble pouvoir s’appliquer
qu’ à des effets doux : ainfi je ne crois
pas qu’on puifle dire d’ un tableau peint moël-
leufement, mais fier d’effet, qu’ il eft peint tendrement- ( L .)
T E N D R E S S E (fubft. fem. ) Comme on
dit peindre tendrement, on dit aufli peindre
avec tendrejje. On peut.aufli drefe opérer avec ten- , dans la fculpture & dans la gravure. 1 L’Andromede du Puget a été faite avec ten