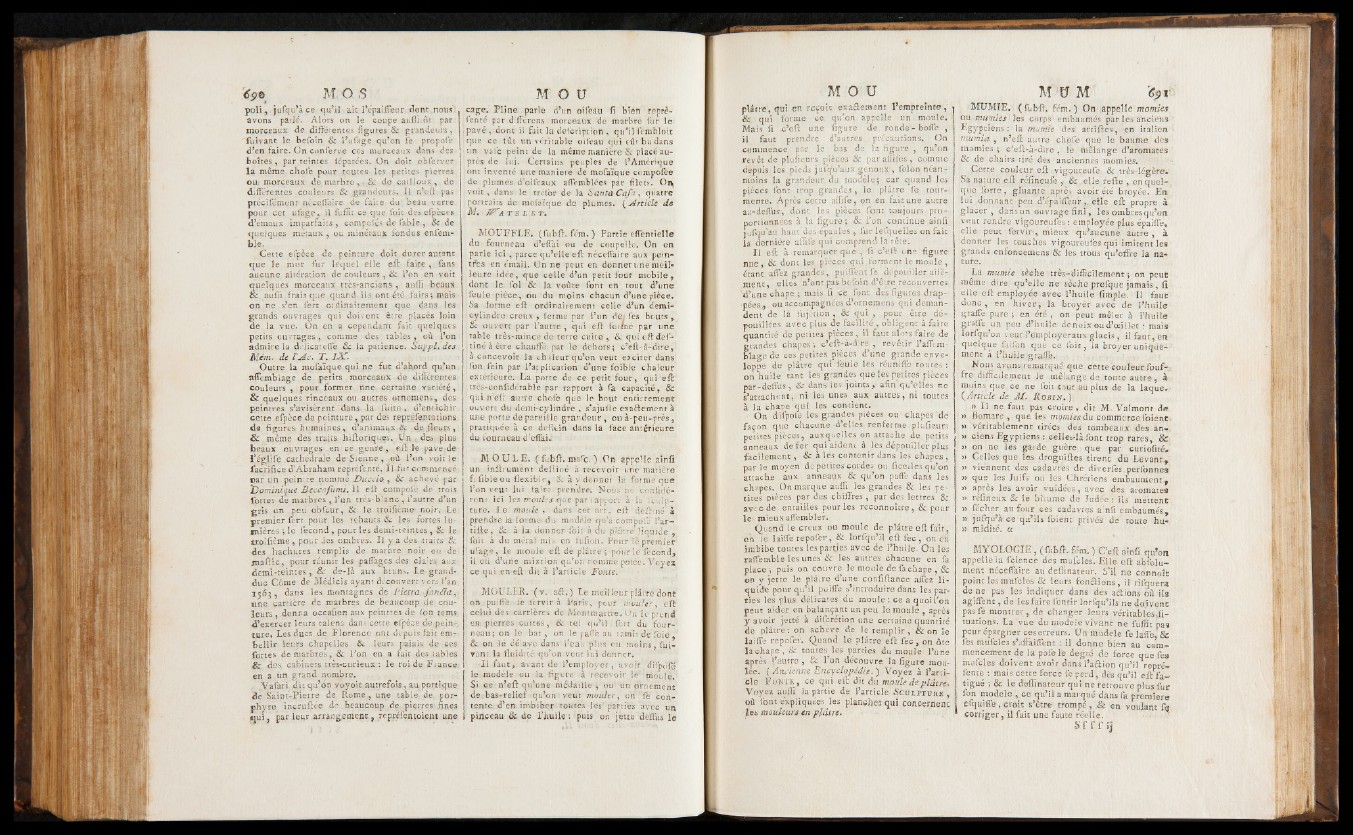
p o l i, jufqu’à ce qu’ il ait l’épaiffeur dont nous',
avons parlé. Alors on le coupe auflnfit par
morceaux de différentes figures & grandeurs,
fuivant le befoin & l’ ufage qu’on le propofe
d’en faire. On conferve ces morceaux dans des
boîtes, par teintes le parée s. On doit obferver
la même chofe pour ,toutes , les petites pierres
our morceaux de marbre , ; & de cailloux;, de
différentes .couleurs & grandeurs. Il n’e ft . pas
préçifément néceflaire de faire du: beau verre
pour cet ulàge, il fuffit ce,que foit des efpèces
d’émaux imparfaits, com pôles de fable , & de
quelques métaux , ou minéraux fondus enfem-
ble.C
ette efpèce de peinture doit durer autant
que le mur fur lequel elle eft. faite , fans
aucune altération de couleurs , & l?on en voit
quelques morceaux très-anciens , aulli beaux
& aufii frais que quand ils ont été. faits-, mais
on ne s’en fert ordinairement que dans les
grands ouvrages qui doivent être placés loin
de la vue. On en a cependant fait quelques j
petits ouvrages, comme des tables, où l’on
admire la délicateffe 8c la patience. Suppl, des 1
Mém. de VAc. T. /AT.
Outre la mofaïque qui ne fut d’abord qu’un
affembiage de petits morceaux de différentes,
couleurs , pour, former une certaine variété,
& quelques rincèaux ou autres ornemens, des
peintres s’avisèrent dans- la fuite , d’enrichir
cette efpèce de peinture, par des repréfen ration s.
da figures humaines, d’animaux.& de-fieu-rs,
& même des . traits, hiftoriquçs. Un , des plus
beaux ouv-rages en ce genre, ?,ft le,pave de
l’ églife .cathédrale de Sienne , où- l’on yçit le
lacfifice d’Abraham repréfejité, Il -fut commencé
car un peintre nommé Duccio , & achevé par
Dominique Beccafumi. Il eft compofé de trois
fortes de marbres , l’ un très-blanc-, i’autre d’ un
gris un peu obfcur, & le troîfième- noir. Le
premier féru pour les rehauts & les fortes lu mières
; le fécond , pour les demi-teintes , & le
troîfième , pour J es ombres. II. y a des,,traits 8c
des hachures remplis de marbre noir ou de
maftic, pour réunir les paffage-5 des clairs aux
demi-teintes , & de-là aux bains. Le grand-
duc Corne de Médicis ayant découvert vers l’an
156 3, dans les montagnes de Pietra <fancïa,:
une carrière de marbres de beaucoup de, couleurs,
donna ocçafion aux pein tres de Ion tems
d’exercer leurs talens dans cette efpèce de peinture.
Les ducs de Florence ont depuis fait embellir
leurs chapelles & leurs palais; de ces.
fortes de marbres, & l ’on en a fait des tables
& des cabinets très-curieux : le roi de France
en a un grand nombre.
Yafari. dit qu’on voyoit autrefois, au portique
de Saint-Pierre de Rome, une tablej de, porphyre
incruftée de beaucoup de pierres:,fin.^s
jspii, par leur arrangement, repréfentoient une
cage. Pline parle d’ un oifeau fi bien reprè-
fenté par d'fférens morceaux de marbre fur le
pavé , dont il fait la defcrîptibn , qu’ il fembloit
que ce fût un véritable oifeau qui eût bu dans
un va le peint de la même manière & placé auprès
de lui. Certains peuples de l’Amérique
ont inventé une maniéré de mofaïque compofee
de plumes d’oîfcaux affemblées par filets. Oi^
v o it, dans le trelbr de la SantaC a fa , quatre
portraits de mofaïque de plumes. ( Article de
M. Æ^a t e l e t .
MOUFFLE. (fubft. fém. ) Partie effemielle
du fourneau d’effai ou de coupelle. On en
parle ici , parce qu’elle eft néceflaire aux peint
e s en émail. On ne peut en donner une meilleure
idée, que celle d’ un petit four mobile,
donc le fol 8c la voûte font en tout d’une
j feule pièce., ou du moins chacun d’ une pièce.
: Sa forme eft ordinairement celle d’un demi-
cylindre'creux, fermé par l’un dei les bouts
& ouvert par l’autre, qui eft foilné par une
table très-mince de terre cuite , 8c qui eft def-
tinéàêtre chauffé par le dehors; c’ eft-à-dire,
a concevoir la ch Ueur qu’on veut exciter dans
fon fein par l ’application d’ une foible chaleur
! extérieure; La .porte de ce petit four , qui eft
très-ccnfidcrable par rapport à fa capacité, &
’ qui n’eft autre chofe que le bout entièrement
ouvert du demi-cylindre , s’ajufte exa&ement à
une porte dé pareille grandeur , ou à-peu-près,
pratiquée à ce defftin dans la face antérieure
du iourneau d’effai;
M O U L E . ( fubft. mafe. ) On appelle ainfi
un inftrument delliné à recevoir une matière
fi fibleou flexible, & à y donner là forme'que
l’on veut lui taire- prendre. Nous ne confidé-
rons ici les mouler que par rapport à laTcuip-
ture. Le moule , dans cet art, eft deft’.né à
prendre ia forme du. modèle qu’a compofé Pareille
, & à la donner- foit à du plâtré’ liquide ,
1 foit à du métal mis en fufion. Pour Tè premier
'u fa g e , l,e .moule eft de plâtre; -pourle fécond,
■ il eli d’une mixtion qu’on nomme potée. Voyez
ce qui .en eft dit à l ’article Fonte.
; MOULER, (v . aéh) Le meilleur plâtre dont
on puifieo fe l ’ervir à Paris, pour moult" ,, eft
, celui des. carrières de Montmartre. Un ie prend
" em pierres cuites, 8c tel qu’ il fort du fourneau;
on le b a t, on le paffe au tamis de foi é ,
& on Je délaye dans' Peau plus ou moins, fuivant,
la fluidité, qu’on veut lui donner.
-Il -faut, avant de l’employer, avoir difpbfe
le. modèle ou la figure à recevoir lè : moulé.
Si ce n’eft qu’une médaille ; Ou un ornement
de-bas-relief >qu’on vteùt moiiler, oh rfè Contente,.
d’ en, imbibe.r toutes les’ parties avec un
pinceau & de fhuile ; puis_ on jette dèffus le
M O U
plâtre, qui en reçoit exa&ement l’empreinte, j
8c qui forme ce qu’on appelle un moule.
Mais fi vc’eft une figure de ronde-boife ,
il faut prendre d’autres précautions. On
commence par le bas de la figure , qu’ on
revêt de plufieurs pièces & par aflifes , comme
depuis les pieds julqu’aux genoux, félon néanmoins
la grandeur du modèle; car quand les
pièces font trop grandes, le plâtre fe tourmente.
Après cette atfife, on en fait une autre
au-deffus, dont les pièces font toujours proportionnées
à la figure ; & l’on continue ainfi
jufqu’au haut des épaules , lur lefquelles on fait
la dernière afïifè qui comprend la tête. , J
Il eft à remarquer que , fl c’ëft une figure
nue, 8c dont les pièces qui forment le moule ,
étant affez grandes, puiffent fe dépouiller aifé-
ment, elles n’ont pas befoin d’ être recouvertes
'd’une chape ; mais fl ce font des figures drap-
pées., ou accompagnées d’ornemens qui demandent
de là lujétion , 8c qui , pour être dépouillées
avec plus de facilité, obligent à faire
quantité de petites pièces , il faut alofrs faire de
grandes chapes ; c’ eft-à-dire , revêtir l’affem-
blage de ces petites pièces d’une grande enveloppe
de plâtre qui feule les réunifie toutes :
on huile' tant les grandes que les petites pièces,
par-deffus, & dans les;-joints, afin qu’ elles ne
s’attachent, ni les unes aux autres, ni toutes
à la chape qui les contient.
On difpole les grandes pièces ou chapes 'de ;
façon que chacune-d’elles renferme plufieurs
petites pièces, auxquelles on attache de petits !
anneaux de fer qui aident à les dépouiller plus,
facilement -, 8c à les contenir dans les chapes,
par le moyen de petites cordes ou ficeiles-qu’on
attache aux anneaux & qu’on paffe dans les
chapes. On marque aufii les grandes & les petites
pièces par des chiffres , par des lettres &
avec de. entailles pour les reconnoître , & pour
le: mieux affembler. .
Quand le creux ou moule de plâtre eft fait,
on lé laiffe repofer, 8c îorfqu’il eft fec , on en
imbibe toutes les parties avec de l’huile. On les
raffemble les unes 8c les autres chacune en fa
place; puis on couvre le moule de fit chape , &
on y jette le plâtre d’une cônfiftance affez l i quidé
pour qu’ il puiffe s’ introduire dans les parties
les plus délicates, du moule: ce a quoi l’on
peut aider en balançant un peu Je. moule, après
y avoir jette à dilcrétion une certaine quantité
de plâtre: on achève de le remplir , & on le
laiffe repofer. Quand le plâtre eft f e c , on ôte
la chape , & toutes les parties du moule l’une
après, l’autre , & l’on découvre la figure moulée.
( Ancienne Encyclopédie. ) Voyez à l’arti-
.cle F onte , ce qui eft dit du moule de plâtre•
Voyez aufii la partie de l’article S cu l p tu r e
où font expliquées les planches qui concernent
les mouleurs en plâtre»
M U M
MUMÏE. (fubft. fém.) On appelle momies
ou munies les corps embaumés par les anciens
Egyptiens: la munïi'e des artiftes, en italien mumia , n’eft autre chofe que le baume des
momies ; c’eft-ù-dire , le mélange d’aromates
8c de chairs tiré dés anciennes momies.
Cette couleur eft . vigoureufe & très-légère*
Sa nature eft réfineufe ,• & elle refte , en quelque
forte , gluante après avoir été broyée. En
lui donnant peu d’ép a iffe u r e lle eft propre à
g la c e r , dans un ouvrage fin i, les ombres qu’on
veut rendre vigoureufes : employée plus épaiffe,
elle peut iervir-, mieux qu’aucune autre , à
donner les touches vigoureufes qui imitent les
grands enfoncemens & les trous qu’offre la nature.
^
La mumie sèche très-difficilement ; on peut
meme dire qu’elle ne1 sèche prefque jamais , fi
elle eft employée avec l ’huile fimple. Il faue
donc, en hiv e r , la broyèr avec de l’huile
graffe pure; en é té , on peut mêler à l’huile
grade un peu d’huile de noix ou d’oeillet : mais
lorfqu’on veut l’employeraux glacis , il faut, en
quelque faifon .que ce fo it, la broyer uniquement
à l ’huile graffe.
Nous avonsremarqué' que cette couleur fou f -
fre-difficilement le mélange de toute autre, à
moins que .ee ne foit tout au plus de la laque*
(■Article, de M. Robin.)]
» I l ne faut pas croire, dit M. Valmont de
» Bomare , que les momies du commerce foient
» véritablement cirées des tombeaux des an-
» ciens Egyptiens :• celles-là font trop rares, &
» on ne les garde guère que par curiofité-
». Celles que les droguiftes tirent du Levant,
» viennent des cadavres de diverfes perfonnes
» que les Juifs ou les Chrétiens embaument,
» après les avoir vuidées , avec des aromates
» réfineux 8c le b hume de Judée : iis mettent
» fécher au four ces cadavres ainfi embaumés ,
» jufqu’ à ce qu’ ils foient privés de" toute hu-
» mi dite. «
MYOLOGIE , ( fubft. fém. ) C’eft ainfi qu’on
appelle la fçience dés mufcles. Elle eft abfolu-
ment ncceffaire au defiinateur. S’ il ne connoît
point les mufcles & leurs fondions, il rifquera
de ne pas les indiquer dans des actions où ils
agiffent, de les faire fentir lorfqu’ils ne doivent
pas fe montrer, de changer leurs véritables Situations.
La vue du modèle vivant ne fuffit pas
peur épargner ces erreurs. Un modèle fe la ffe ,&
les mufcles s’ affaiffent : i l donne bien au commencement
de la pofeFe degré de force que fes
mufcles doivent avoir dans l’a&ion qu’ il repréfente
: mais cette forcé fe perd, dès qu’ il eft fatigué
; & le defiinateur qui ne retrouve plus fut
fon modèle , ce qu’ il a marqué dans fa première
efquiffe , croit s’être trompé, ,8c en voulant fe
corriger, il fait une faute réelle.
S f f f ij