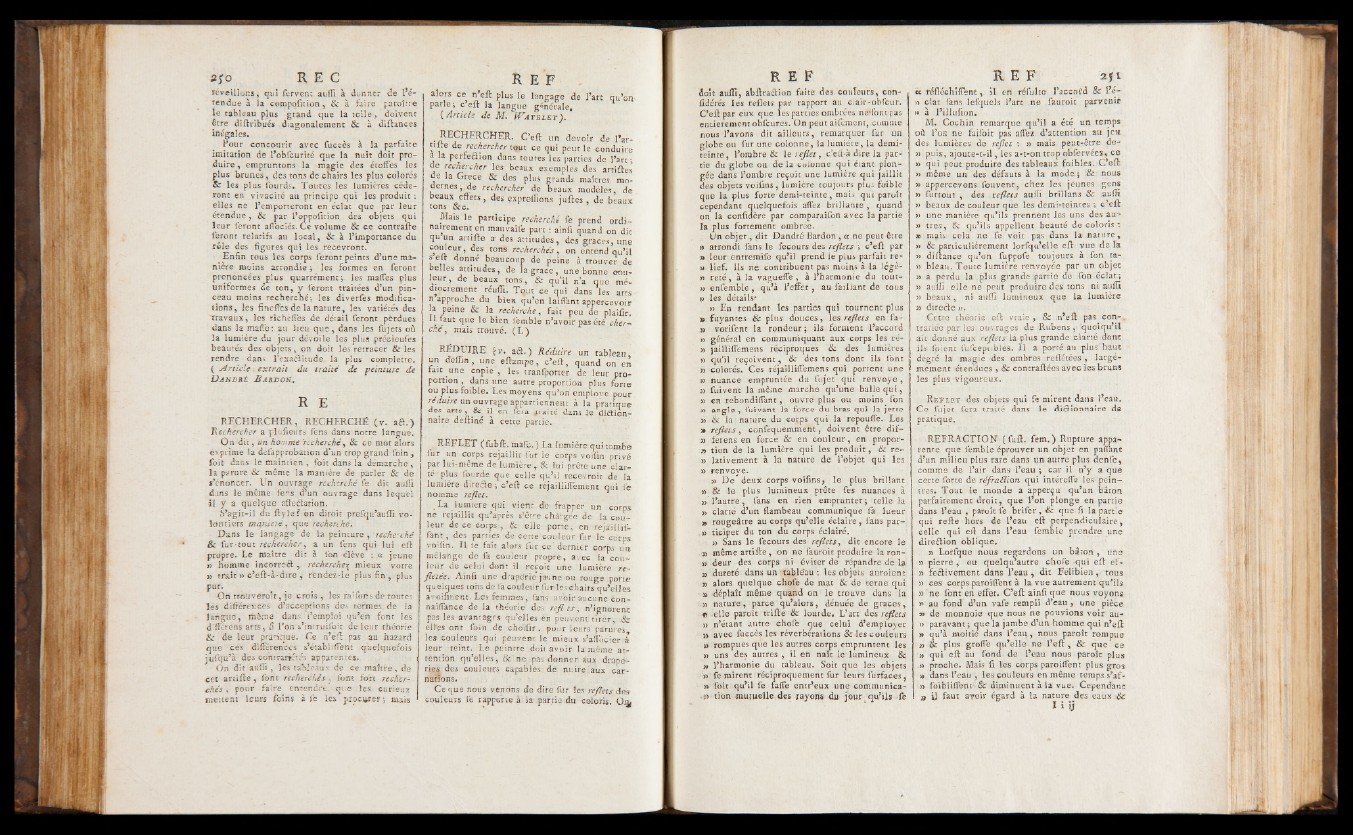
Sfo R E C
réveillons, qui fervent aufli à donner de l’ étendue
à la compolition, 8c à faire paraître
le tableau plus grand que la to ile , doivent
être diftribués diagonalement & à diftançes
inégales.
Pour concourir avec fuccès à la parfaite
imitation de l’oblcurité que la nuit doit produire
, empruntons la magie des étoffes les
plus brunes, des tons de chairs les plus colorés
8c les plus lourds. Toutes les lumières -céderont
en vivacité au principe qui les produit :
elles ne l ’emporteront en éclat que par leur
étendue, 8c par l’oppofition des objets qui
leur feront afl'ociés.Ce volume & ce contrafte
feront relatifs au lo cal, & à l’importance du
rôle des figures qui les recevront.
Enfin tous les corps feront peints d’une maniéré
moins arrondie -, les formes en feront
prononcées plus quarrément; les mafles plus
uniformes de ton, y feront traitées d’ un pinceau
moins recherché-, les diverfes modifications,
les finettes de la nature, les variétés des
travaux, les richcflès de détail feront perdues
dans la mafle : au lieu q u e , dans les fujets où
la lumière du jour dévoile les plus préeieufes
beautés des objets, on doit les retracer & les
rendre dans Texaéiitude la plus complette.
( A r tic le . extrait du traité de peinture de
DANDRÉ M A RD O N
R E
RECHERCHER, RECHERCHÉ ( y a fi.)
Rechercher a plufieurs fens dans notre langue.
On die, un homme recherché, & ce mot alors
exprime la delapprobation d’un trop grand foin ,
foit dans le maintien , foit dans la démarche ,
la parure & même la manière de parler 8c de
s’énoncer. Un ouvrage recherché le dit aufli
dans le meme Cens d’un ouvrage dans lequel
i l y a quelque affeétation.
S’agit-il du fl: y le'? on dirait prefqu’aufîi. v olontiers
manie]é, que recherché.
Dans le langage de la peinture, recherché
8c fur-tout rechercher, a un fens qui lui eft
propre. Le maître dit à l'on élève : ce jeune
» homme in C ô r r e é t recherchei mieux votre ,
» trait » c’ eft-à-dire , renflez-le plus fin , plus j
pur.
On trouvéroît, je crois , les raifonsde toutes
les différences d’acceptions des termes, de J a
langue, même dans i’ empîoi qu’en font les
d.fférens arts, fi Ton s’inrruifoit de leur théorie
8c de leur pratiqué. Ce n’ eft pas au hazard
que ces différences s’étabhflent quelquefois
jufqu’ à des contrariétés apparentes. i
On dit aufli, les tableaux de ce maître, de
cet artifte, font recherciJs, font fort recherchés
, pour faire entendre, que les. curieux
mettent leurs foins à le les procurer -, mais
R E F
alors ce n’eft plus le langage de l’art qu’on'
parle -, c eft la langue générale,
( Article de M. U^a te le t ).
RECHERCHER. C’eft un devoir de l’ ar-
ufle de rechercher tout ce qui peut le conduire
a la perfection dans toutes les parties de l’art-,
de rechercher les beaux exemples des artiftes
de la Grece & des plus grands maîtres modernes
j de rechercher de beaux modèles, de
beaux effets, des expreflïons juftes , de beaux
tons & c .
Mais le participe recherché Ce prend ordinairement
en mauvaile parc : ainfi quand on dit
qu un artifte a-des attitudes, des grâces, une
) des tons recherchés, on entend qu’il
s e lt donné beaucoup de peine à trouver de
belles attitudes, de la grâce, une bonne couleur,
de beaux tons, #: qu’il n’a que médiocrement
réufli. Tqut ce qui dans les arts
n approche du bien qu’en laiffant appercevoir
la peine & la recherche, fait peu de plaifir.
Il faut que le bien l’emble n’avoir pas été chcr~
■ ché, mais trouvé. (L )
**v ‘ Réduire un tableau,
un deffin, une eftampe, c’e ft, quand on en
fait une co p ie , les tranfporter de leur proportion,
dans une autre proportion plus forte
ou plus foible. Les moyens qu’on emplove pour
réduire un ouvrage appartiennent à la pratique
des arts, & il en fera traité dans le dictionnaire
deftiné à cette partie.
REFLET (fubft. male.) La lumière qui tombe
fur un corps rejaillit: fur le corps voiftn privé
par lui-même de lumière., 8c lui prête une clarté'plus
fpurde que celle qu’ il recevrait de la
lumière directe ; c’eft ce réjailliflement qui le
nomme reflet.
.La lumière qui vient de frapper un corps,
ne rejaillit qu’après s?erre chargée de la cou-
leur de ce corps , 8c elle porte, en re ja illit
Tant, des parties de cetté couleur fur le corps
voiftn. I l ie fait alors fur ce dernier corps un,
mélange de fa couleur propre, avec la couleur
de celui dont il reçoit une lumière reflétée.
Ainfi une drapflrie jaune ou rouge porte
quelques tons de iacou'letir furlesdhairs qu’ elles
avoiftnent. Les femmes^ fans avoir aucune con-
naiffance de là théorie des refl es, n’ignorent
pas les avantages qu’elles en peuvent tirer, &
elfes ont foin de choiftr, pour leurs parures
les couleurs qui peuvent le mieux s’aflocier à
leur teint. Le peintre doit avoir la.meme attention
qu’elles, & ne pas donner aux draperies
des couleurs capables de nuire aux carnations.
Ce que nous venons de dire fur les reflets des
couleurs fe rapporte à la partie du coloris. 0%
R e F
doit aufli, abftra&ion faite des couleurs, con-
fidérés les reflets par rapport au clair-obfcur.
C’eft par eux que les parties ombrées, ne'font pas
entièrement obfcures. On peut aiftimenr, comme
nous l’avons dit ailleurs, remarquer fur un
globe ou fur une colonne, la lumière, la demi-
teinte, l’ombre & le reflet, ceft-à dire la par- :
tie du globe ou de la colonne, qui étant plongée
dans l’ombre reçoit une lumière qui jaillit ;
des objets voifins, lumière toujours plus faible ■
que la plus forte demi-teinte, mais qui paroît j
cependant quelquefois aflez brillante , quand
on la confidère par comparaifon avec la partie ;
la plus fortement ombrée.
Un ob jet, dit Dandré Bardon , a ne peut être
» arrondi fans le fecours des reflets ; c’eft par
» leur entremife qu’ il prend le plus parfait re-
u lief. Ils ne contribuent pas moins à la légè-
» reté, à la vaguefle , à l’harmonie du tout-
» ênfemble, qu’à l’e ffet, au Taillant de tous
p les détails*
» En rendant les parties qui tournent plus
» fuyantes & plus douces, les reflets en fa-
» vorifent la rondeur; ils forment l’accord
» général en communiquant aux corps les ré-*
» jailliflemens réciproques 8c des lumières
» qu’il reçoivent, & des tons dont ils l'ont
» colorés. Ces réjailliffemens qui portent une
» nuance empruntée du lujet- qui renvôye,
fuivent la même marche qu’une balle q u i,
» en rebondiffant, ouvre plus ou moins fon
» angle, fuivant la force du bras qui la jette
» 8c la nature du eoçps qui la repoufle. Les
» reflets, confequemment, doivent être dif-
» ferens en force & en couleur, en propor-
» tion de la lumière qui les produit, 8c re-
» lativement à la nature de l’objet qui les
» renvove.
.» De deux corps voifins, le plus brillant.
» & le plus lumineux prête fes nuances à
» l’autre, fans en rien emprunter; telle la
» clarté d’un flambeau communique là lueur
» rougeâtre au corps qu’elle éclaire , fans par-
» ticiper du ton du corps éclairé.
» Sans le fecours des reflets, dit encore le
.» même artifte, on ne fauroit produire laron-
w deur des corps ni éviter de répandre de la
» dureté dans un tableau : les objets auraient
» alors quelque chofe de mat 8c de terne qui
» déplaît même quand on le trouve dans la
» nature, parce qu’alors, dénuée de grâces,
« elle paroît trifte & lourde. L’ art des reflets
» n’étant autre chofe que celui d’employer
» avec fuccès les réverbérations & les couleurs
» rompues que les autres corps empruntent les
» uns des autres , il en naît lô lumineux &
» l’harmonie du tableau. Soit que les objets
» fe mirent réciproquement fur leurs furfaces,
» foit qu’ il fe falfe entr’ eux une communica-
• *> tidn mutuelle, des rayons du jour qu’ils le
R E F
cc réfléchiflent, il en réfulte l’accofd & Té-
! » clat fans lefquels l’art ne fauroit parvenir
I » à l’ illufion.
M. Cochin remarque qu’ il a été un temps
où l’on ne faifoit pas aflez d’attention au jeu
des lumières1 de reflet : » mais peut-être de-
» puis, ajoute-t-il, les a-t-on trop obfervées, ce
» qui peut produire des tableaux foibles. C ’eft:
» même un des défauts à la mode'; 18c nous
» appercevons fouvent, chez les jeunes gens
» furtout , des reflets aufli brillans & aufli
» beaux de, couleur que les demi-ceintes ; c ’ eft:
» une manière qu’ ils prennent les uns des au-*
» très, 8c qu’ ils appellent beauté de coloris z
» mais cela ne fe voit pas dans la nature,
» & particulièrement lprfqu’elle eft vue de la
» diftance qu’on fuppofe toujours à.fon. ta.«
» bleau. Toute lumière renvoyée par un objet
» a perdu la plus grande .’partie de fon éclat;
» aufli elle ne peut produire des tons ni âüfli
» beaux, ni aufïi lumineux que la lumière
» direéle ».
Cette théorie eft vraie , & n’ eft pas con-.
trariéè par les ouvrages de Rubens , quoiqu’ il
ait donné aux reflets la plus grande clarté dont
ils fpient fufceptibles. I l a porté au plus haut
degré la magie des ombres reflétées , largé-
I mentent étendues , & contraftées avec les bruns
les plus vigoureux.
Reflet des objets qui fe mirent dans l’ eau.
Ce fujet fera traité dans le dictionnaire de
pratique.
REFRACTION (fuft. fem.) Rupture apparente
que femble éprouver un objet en paflant
d’un milieu plus rare dans un autre plus denfe,
comme de l’air dans l’eau ; car il n’y a que
certe forte de réfraflion qui intéreflb les peintres.
Tout le monde a apperçu qu’un bâton
parfaitement droit, que l’on plonge en partie
dans l’eau , paroît le brifer, 8c que li la partie
qui refte hors de l’eau eft perpendiculaire,
celle qui eft dans l’eau femble prendre une
direélion oblique.
» Lorfque nous regardons un bâton , une
» pierre, ou quelqu’autre chofe-qui eft ef-
» feélivement dans l’eau, dit Félibien , tous
» ces corps paroiflent à la vue autrement qu’ils
» ne l’ont en effet. C ’eft ainfi que nous voyons
» au fond d’un vafe rempli d’eau , une pièce
a» de monnoié que nous ne pouvions voir au-
» paravant; que la jambe d’un homme qui n’eft:
» qu’à moitié dans l’eaq., nous paroît rompue
» & plus grotte qu’ elle ne l’ eft , & que ce
» qui eft au fond de l’ eau nous parole plus
.» proche. Mais fi les corps paroiflent plus gros
» dans l’eau , les couleurs en même temps s’af-
» foibliflbnt & diminuent à la vue. Cependant
9 il faut avoir égard à la nature des eaux &
I i U