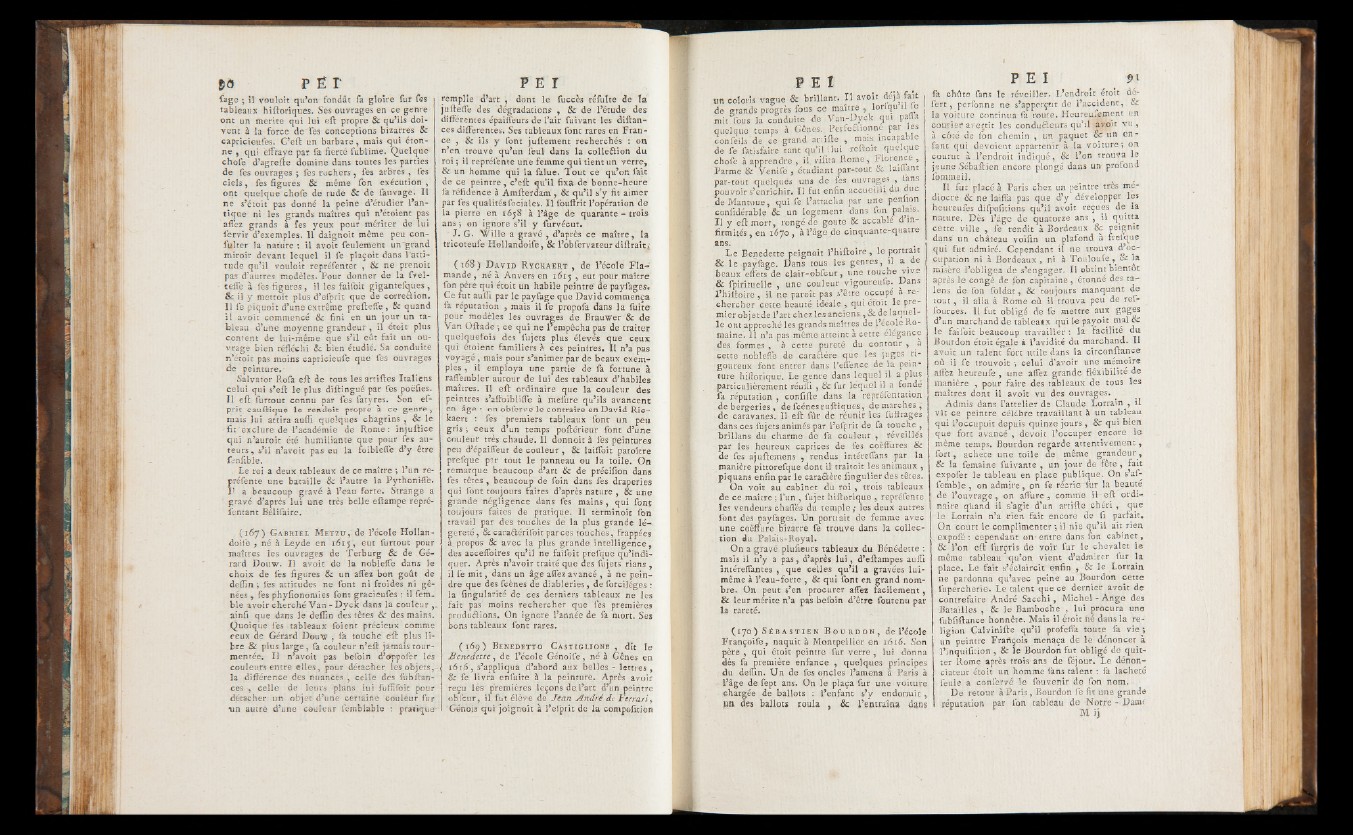
fage • il vouloit qu’on fondât fa gloire fur fes
tableaux hiftoriques. Ses ouvrages en ce genre
ont un mérité qui lui eft propre & qu’ ils doivent
à la force de Tes conceptions bizarres &
capricieufes. C’eft un barbare, mais qui étonne
, qui effraye par fa fierté fublime. Quelque
choie d’agrefte domine dans toutes les parties
de fes ouvrages ; fes rochers, fes arbres., fes
c ie ls , fes figures & même fon exécution ,
ont quelque chofe de rude & de fauvage. Il
ne s’étoit pas donné la peine d’étudier l’antique
ni les grands maîtres qui n’étoient pas
afTez grands à fes yeux pour mériter de lui
fervir d’exemples. 11 daignoit même peu confiai
ter la nature : il avoit feulement un "grand
miroir devant lequel il fe plaçoit dans l'attitude
qu’ il vouloit repréfenter , & ne prenoit
pas d’autres modèles. Pour donner de la fre l-
teffe à fes figures, il les faifoit gigantefques ,
& il y mettoit plus d’efprit que de correâion.
Il fe piquoit d’ une extrême prefteffe, & quand
il avoit commencé & fini en un jour un table
au d’une moyenne grandeur , il étoit plus
content de lui-même que s’ il eût fait un ouvrage
bien réfléchi & bien étudié. Sa conduite
n’étoit pas moins capricieufe que fes ouvrages
de peinture.-
Salvator Rofa eft de tous les artiftes Italiens
celui qui s’eft le plus diftingué par fes poëfies.
Il eft furtout connu par fes fatyres. Son ef-
prit cauftique le rendoit propre à ce genre,
mais lui attira aufli quelques chagrins , & le
• fit 'exclure de l’ académie de Rome: injuftice
qui n’auroit été humiliante que pour fes auteurs,
s’ il n’avoit pas eu la foibleffe d’y être
fenfible.
Le roi a deux tableaux de ce maître ; l’ un repréfente
une bataille & l’autre la Pythoniffe.
I ? a beaucoup gravé à l’eau forte. Strange a
gravé d’après lui une très belle eftampe repré-
fentant Bélifaire.
( 16 7 ) Gabriel Me t zu , de l’école Hollan-
doife , né à Leyde en 1615, eut furtout pour
maîtres les ouvrages de Terburg & de Gérard
Douw. I l avoit de la nobleffe dans le
choix de fes figures & un affez bon goût de
deffin -, fes attitudes ne font ni froides ni gênées
, fes phyfionomies font gracieufes : il fem-
ble avoir cherché Van - Dy ck dans la couleur
ainfi que dans le deflin deS têtes 8c des mains.
Quoique fes tableaux foient préeieux comme
ceux de Gérard Douw , fa touche eft plus libre
& plus large, fa couleur n’eft jamais tourmentée;
Il n’avoit pas befoin d’oppofer lés
couleurs entre elles, pour détacher les objets,-
la différence des nuancés , celle des fubftan-
ces -, celle de leurs -plans lui fuffifoit pour
détacher un objet d’une certaine couleur fur
■ un autre d’une couleur fenrblabié : pratique'-
remplie d’art , dont le fuccès réfulte de la
juftefle des dégradations , & de l ’étude des
differentes épaifl’eurs de l’air fuivant les diftan-
ces différentes. Ses tableaux font rares en France
, & ils y font juftement recherchés : on
n’en trouve qu’un léul dans la collection du
roi ; il repréfente une femme qui tient un verre,
& un homme qui la falue. Tout ce qu’on lait
de ce peintre, c’eft qu’il fixa de bonne-heure
fa réfidence à Amfterdam, & qu’ il s’y fit aimer
par fes qualités fociales. I l fouftrit l’opération de
la pierre en 1658 à l’âge de quarante - trois
ans -, on ignore s’ il y furvécut.
J. G. W ille a gravé , d’ après ce maître, la
tricoteufe Hollandoife, & l ’obferyateur diftrait;j
(16 8 ) David Ryckaert , de l’école Flamande
, né à Anvers en 1615 , eut pour maître
fon père qui étoit un habile peintre' de payfages.
Ce fut auffi par le payfage que David commença
fa réputation , mais il fe propofa dans la fuite
poùr modèles les ouvrages de Brâuwer & de
Van Oftade -, ce qui ne l ’empêcha pas de traiter
quelquefois des fujets plus élevés que ceux
qui étoient familiers à ces peintres. Il n’ a pas
voyagé , mais pour s’animer par de beaux exemples
, il employa une partie de fa fortune à
raffembler autour de lui des tableaux d’habiles
maîtres. Il eft ordinaire que la couleur des
peintres s’aftoibliffe à mefure qu’ils avancent
en âge : on obferve le contraire en David Ric-
kaert : fes premiers tableaux font un peu
gris -, ceux d’ un temps poftérieur font d’une
couleur très chaude. Il donnoit à fes peintures
peu d’épaiffeur de couleur , & laiffoit paroître
prefque par tout le panneau ou la toile. On
remarque beaucoup d’art & de précifion dans
fes têtes, beaucoup de foin dans fes draperies
qui font toujours faites d’après nature , & une
grande négligence dans fes mains , qui font
toujours faites de pratique. Il tèrminoit fon
travail par des touches de la plus grande lé-,
^ereté, & caraélérifoit par ces touches, frappées
a. propos & avec la plus grande intelligence,
des acceffoires qu’ il ne faifoit prefque qu’ indiquer.
Après n’avoir traité que des fujets rians ,
il 1e mit, dans un âgp affez avancé , à ne peindre
que des fcènes de diableries, de forciléges :
la Angularité de ces derniers tableaux ne les
fait pas moins rechercher que fes premières
productions. On ignore l’année de fa mort. Ses
bons tableaux font rares.
( 1 6 9 ) Benedetto Castiglione , dit le
Benedette, de l ’école Génoife , né à Gênes en
16 16, s’appliqua d’abord aux belles - lettres,
8c fe livra enfuite à la peinture. Après avoir
reçu lès premières leçons de. l’art d’ un peintre
obfcur, il fut élève de Jean André de Ferrari,
Génois qui joigneit à l’elprit de la compofitiOn
f E 1 un coloris vague & brillant. I l avoir déjà fait
de grands progrès fous ce maître , loriqu U le
mit fous la conduite de Van-Dyck qui paffa
quelque temps à Gênes. Perfectionne pat es
confeils de ce grand arlifte , mais incapable
de fe fatisfaire tant qu’il .lui reftoit quelque
chofe à apprendre , il. vifita Rome, Florence ,
Parme & Venife , étudiant par-tout & 1 aillant .
par-tout quelquës uns de fes ouvrages , lans
pouvoir s’enrichir. Il fut enfin accueilli du duc
deMantoue, qui fe l’attacha par une penfion
confidérable & un logement dans fon palais.
I l y eft mort, rongé de goûte & accablé d infirmités
, en 1670 , à l’âge de cinquante-quatre
ans. ;
L e Benedette peignoit l’hiftoiré, le portrait
8c le-payfage. Dans tous les genres, il a de
beaux effets de clair-obfcur, une touche vive
& fpirituelle , une couleur vigoureufe. Dans
l ’hiftoire, il ne paroît pas s’être occupé a rechercher
cette beauté idéale , qui étoit le premier
objet de l’art chez les anciens., & de laquelle
ont approché les grands maîtres de l’ecole Romaine.
Il n’a pas même atteint à cette élégance
des formes , à cette pureté du contoür , a
cette nobleffe de cara&ère que les juges rigoureux
font entrer dans l’effence de la peinture
hiftorique. Le genre dans lequel il a plus
particulièrement réuffi , & fur lequel il a fondé
la réputation , confifte dans la repréfentation
de bergeries , de fcénes ruftiques, de marches ,
de caravanes. Il eft fûr de réunir les fuffrages
dans ces fujets animés par l’efprit de fa touche ,
brillans du charme de fa couleur , réveillés
par les heureux caprices de fes çoeffares &
de fes ajuftemens , rendus intéreffans par la
manière pittorefque dont il traîtoit les animaux ,
piquans enfin par le caraCtère fingulier des têtes.
On voit au cabinet du roi , trois tableaux
de ce maître; l’un , fujet hiftorique , repréfente 1
les vendeurs chaffés du temple; les deux autres
font des payfages. Un porttait de femme avec
une coëfrure bizarre fe trouve dans la collection
du Palais-Royal.
On a gravé plufieurs tableaux du Bénédette :
mais il n’y a pas, d’après lu i , d’eftampes aufli
întéreffantes , que celles qu’ il a gravées lui-
même à l’eau-forte , & qui font en grand nombre.
On peut s’ en procurer affez facilement,
& leur mérite n’a pas befoin d’être foutenu par
la rareté.
(1 70 ) S é b a s t i e n B o u r d o n , de l’école
Françoife, naquit à Montpellier en 1616. Son
père, qui étoit peintre fur v e r re , lui donna
dès fa première enfance , quelques principes
du deflin. Un de fes oncles l’amena à Paris à
l ’âge de fept ans. On le plaça fur une voiture
chargée de ballots : l’enfant s’y endormit ,
fttt des ballots roula , & l’entraîna dans
P E I 91
fa chûte fans le réveiller. L’endroit étoit dé-
fe r t , perfonne ne s’apperçtit de l’accident, 8c
la voiture continua fa roure. Heureusement un
courief avertit les conducteurs qu’ ii avoit v u ,
à côté de fon chemin , un paquet 8c un enfant
qui dévoient appartenir à la voiture ; on.
courut à „l’endroit indiqué, 8c l ’on trouva le
jeune Sébaftien encore plongé dans un profond
fommeil.
Il fut placé à Paris chez un peintre très mer
diocrê & ne laiffa pas qu.e d’y développer les
heureufes difpofitions qu’ il avoit reçues de la
nature. Dès l’âge de quatorze ans , il quitta
cette ville , fe rendit à Bordeaux & peignit
dans un château voifin un plafond à frefque
qui fut admiré. Cependant il ne trouva d’occupation
ni à Bordeaux, ni à Toulouie, 8c la
misère l’obligea de s’engager. I l obtint bientôt
après le congé de fon capitaine, étonné des ta-
lens de fon foldat, & toujours manquant de
tou t, il alla à Rome où il trouva peu de rel-
fources. 11 fut obligé de fe mettre aux gages
d’ un marchand de tableaux qui le payoit mal 8c
le faifoit beaucoup travailler : la facilité du
Bourdon étoit égale à l’avidité du marchand. Il
avoit un talent fort utile dans la circonftance
où il fe trouvoit ; celui d’avoir une mémoire
affez heureufe , une affez grande flexibilité de
manière , pour faire des tableaux de tous les
maîtres dont il avoit vu des ouvrages.
Admis dans l’attelier de Claude Lorrain , il
v it ce peintre célèbre travaillant à un tableau
qui l’occupoit depuis quinze jours , & qui bien
que fort avancé , devoit l’occuper encore le
même temps. Bourdon regarde attentivement ,
for t, acheté une toile de même grandeur,
8c la femaîne fuivante , un jour de fê te , fait
expofer le tableau en place publique. On s’ al-
femble , on admire, on fe récrieTiir la beauté
de l’ouvrage, on affure , comme il eft ordinaire
qUand il s’agit d’un artifte chéri , que
le Lorrain n’ a rien fait encore de fi parfait.
On court le complimenter ; il nie qu’ il ait rien
. expofé : cependant on-entre dans fon cabinet,
& l’on eft furpris de voir fur le chevalet le
même tableau qu’on vient d’adm:rer lur la
place. Le fait s’éclaircit enfin , & le Lorrain
ne pardonna qu’avec peine au Bourdon cette
fupercherie. Le talent que ce dernier avoit de
contrefaire André S ac ch i, Michel - Ange des
Batailles , & le Bamboche , lui procura une
fubfiftance honnête. Mais il étoit né dans la religion
Calvinifte qu’ il profeffa toute fa vie ;
un peintre François menaça de le dénoncer à
l’ inquifirion , & le Bourdon fut obligé de quitter
Rome après trois ans de féjour. Le dénonciateur
étoit un homme fans talent : fa lâcheté
feule a confervé le fouvenir de fon nom.
De retour à Paris, Bourdon fe fit une grande
réputation par fon tableau de Notre - Dame
M ij