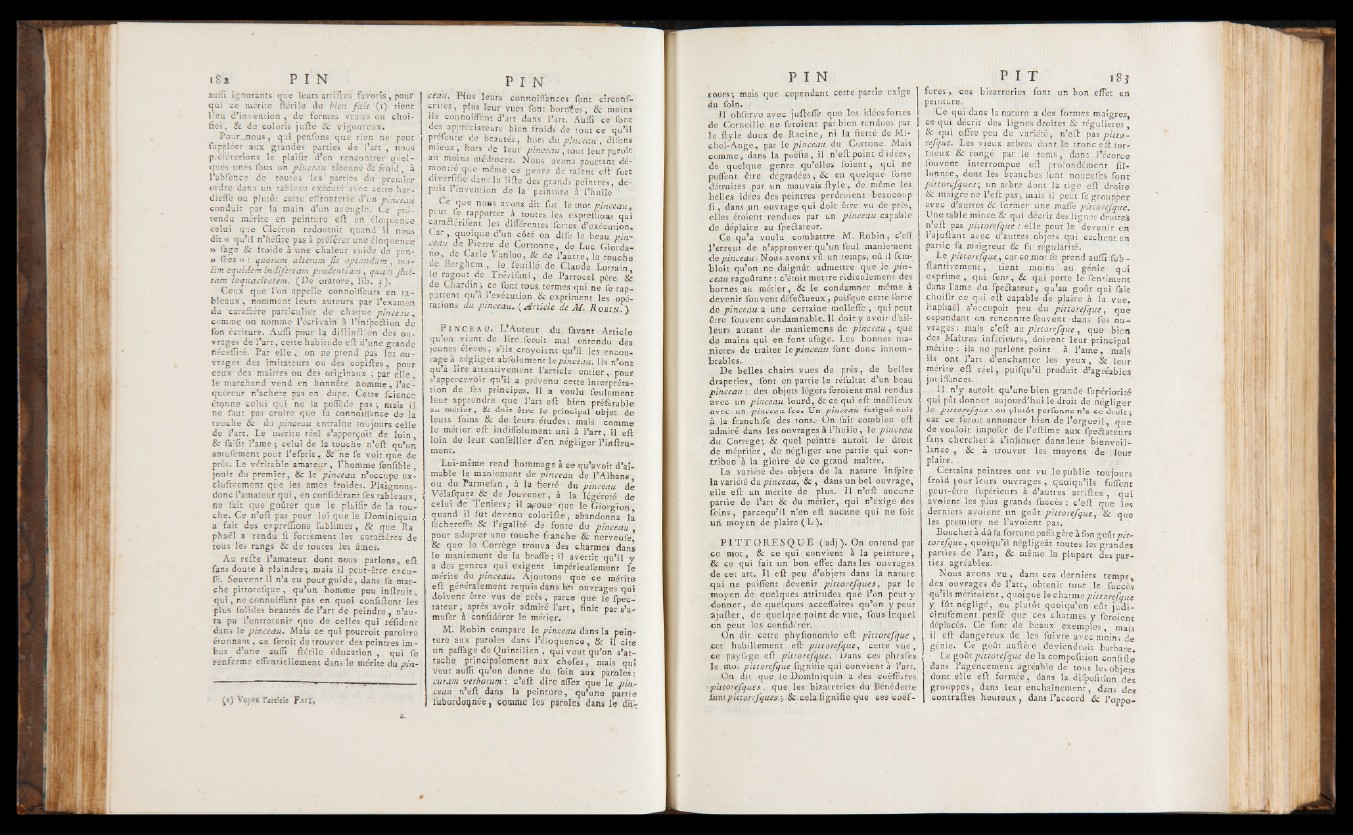
amïi ignorants que leurs arriftes favoris, pour
qui ce mérite itérile du bien fu it (i) tient
lieu d’ invention , de formes vraies ou choi-
fies, & de coloris jufte & vigoureux.
Pour_nous, qui penfons que rien ne peut
fuppléer aux grandes parties de l’art , nous
p.éférerions le plaifir d’ en rencontrer quelques
unes fous un pinceau tâtonné 8c froid à
l’abfence de toutes les parties du premier
ordre dans un tableau exécuté 'avec cette har-
diefl’e ou plutôt cette effronterie d’un pinceau
conduit par la main d’un aveugle. Ce prétendu
mérite en peinture eft en éloquence
celui que Cicéron redoùtoit quand il nous
dit « qu’ il n’héïite pas à préférer une éloquence
» fage & froide à une chaleur vuide de pen-
» fées » : quorum alterum f i t optandum nia-
lim equidem indifertam prudenùam, quant fiul-
tam loquacitatem. (De orâtore, lib. 3).
Ceux que l’on appelle connoîffeurs en tableaux
, nomment leurs auteurs par l’examen
du caraâère particulier de chaque pinceau
comme on nomme l’écrivain à l’ infpeétion de
fon écriture. Audi pour la diftinciion des ouvrages
de l’art, cette habitude eft d’une grande
nécefliré. Par elle , on ne prend pas les ouvrages
des imitateurs ou des copiftes, pour
ceux des maîtres ou des originaux ; par elle
le marchand vend en honnête homme, l ’acquéreur
n’achete pas en dupe. Cette fcience
étonne celui qui ne la poffède pas; mais il
ne faut pas croire que la connoiffance de la
touche & du pinceau entraîne toujours celle
de Part, Le mérite réel s’apperçoit de loin
& faifit l’ame ; celui de la touche n’efl qu’un
amufement pour l’ efprit, &Tne fe voit que de
près. Le véritable amateur, l’homme fenfible
jouit du- premier, & le pinceau n’occupe ex-
clufivement que les âmes froides. Plaignons-
donc l’amateur q ui, en confidérant fes tableaux,
ne fait que goûter que le plaifir de la touche.
Ce n’eft pas pour lui que le Dominiquin
a fait des exprefiions fablimes, & que Ra
phaël a rendu fi fortement les caractères de
tous les rangs & de toutes les âmes.
Au refte l’amateur dont nous parlons, eft
fans doute à plaindre; mais il peut-être excu-
fé. Souvent il n’a eu pour guide, dans fa marche
pirtorefque, qu’un homme peu inftruit
q u i, ne connoiffant pas en quoi confiftent les
plus folides beautés de l’art de peindre, n’aura
pu l’entretenir que de celles qui réfident
dans le pinceau. Mais ce qui pourroit paroître
étonnant, ce feroit de trouver des peintres imbus
d’une aufil ftérile éducation , qui fe
rënferme effentiellement dans le mérite du pin- 1
(1) Voyez Tardcle F aix,
ceau. Hus leurs connoiflances font cîrconf«
crues, plus leur vues font bornfes, 8c moins
ils connoifTent d’art dans l’ art. Aufîi ce font
des appréciateurs bien froids de tout ce qu’il
préfente de beautés, hors du pinceau , difcns
mieux, hors de leur pinceau, tout leur paraît
au moins médiocre. Nous avons pourtant dé-
1!lonuLé cîüe même ce genre de talent eft fort
diverfifié' dans la lifte des grands peintrés, depuis
1 invention de la peinture à l ’huile.
Cè que nous avons dit fur le mot pinceau,
peUta ^ apporter à toutes les exprefïions qui
caratterifent les différentes fortes d’exécution.
C a r , quoique d’un côté on dife le beau pinceau
de Pierre de Cortonne, de Luc Giorda-
no, de Carie Vanloo, & de l’autre, la touche
de Berghem, Je feuille de Claude Lorrain,
le ragoût de Trévifani, de Parrocel père &
de Chardin ; ce font tous termes qui ne fe rapportent
qu a l’execution & expriment les opérations
du pinceau. ( Article de M . R obin. )
P i n c e a u . L’Auteur du favant Article
qu’on vient de lire feroit mal entendu des
jeunes élèves, s’ils croyoient qu’ il les encouragea
négliger abfolument le pinceau. Ils n’ont
qu’ à lire attentivement l’article entier, pour
s’appercevoir qu’ il a prévenu cette interprétation
de fes principes. Il a voulu feulement
leur apprendre que l ’art eft bien préférable
au métier, & doit être le principal objet de
leuis foins & de leurs études; mais comme
le métier eft indiflolument uni à l’art, il eft
loin de leur confejller d’en négliger l’ inftrti-
ment.
Lui-même rend hommage à ce qu’avoit d’aî-
mable le maniement de pinceau de l’Albane
ou du Parmefan , à la fierté du pinceau de
Velafquez & de Jouvenet, à la lçgéreté de
celui de'Tenie rs; il afoue- que le Giorgion
quand il fut devenu colorifte, abandonna la
féchereffe & l’égalité de fonte du pinceau
pour adopter une touche franche & nerveufe
& que le Corrège trouva des charmes dans
le maniement de la brofTe; il avertit qu’ il y
a des genres qui exigent impérieufement le
mérite du pinceau. Ajoutons que ce mérite
eft généralement requis dans les ouvrages qui
doivent être vus de près, parce que le fpeç-
tateur, après avoir admiré l’a rt, finit par s’a-
mufer à confidérer le métier,
M. Robin compare le pinceau dans la peinture
aux paroles dans l’éloquence, & il cite
un partage de Quintilien , qui veut qu’on s’attache
principalement aux chofes, mais qui
veut aüfli qu’on donne du foin aux paroles:
curam verborum : c’eft dire aflez que le p in ceau
n’eft dans la peinture, qu’ une partie
fubordoçnéë f comme les paroles dans le di£;
P I N
cours; mais que cependant cette partie exige
du foin. '
Il obferve avec juftefTe que les idées fortes
de Corneille ne feroient pas bien rendues par |
le ftyle doux de Racine, ni la fierté de Michel
Ange, par le pinceau du Cortone, Mais
comme, dans la poëfie, il n’eft point d’idées,
de quelque genre qu’elles l’oien t, qui ne
puflent être dégradées, & en quelque forte
détruites par un mauvais ftyle, de même les
belles idées des peintres perdraient beaucoup
f i , dans un ouvrage qui doit être vu de près,
elles étoient rendues par un pinceau capable
de déplaire au fpeélateur.
Ce qu’ a voulu combattre M. Robin, c’eft
l ’errçur de n’approuver qu’ un feul maniement
de pinceau, Nous avons vû un temps, où il fem-
bloit qu’on ne daignât admettre que le pinceau
ragoûtant : c’écoit mettre ridiculement des
bornes au métier, & le condamner même a
devenir fouvent défeîlueux, puifque cette forte
de pinceau a une certaine molleffe , qui peut
être lbuventcondamnable.il doit y avoir d ailleurs
autant de maniemens de pinceau, que
de mains qui en font ufage. Les bonnes maniérés
de traiter le pinceau font donc innombrables..
De belles chairs vues de près, de belles
draperies, font en partie le réfultat d’un beau
pinceau : des objets légers feroient mal rendus .
avec un pinceau lourd, &-ce qui eft moelleux
avec un pinCeait fec. Un pinceau fatigué nuit
à la franchife des tons.' On fait combien eft
admiré dans les ouvrages à l’huile , le pinceau
du Correge; & quel peintre aurait le droit
de méprifer, de négliger une partie qui contribue
à la gloire dé ce grand maître,
La variété des objets de la nature infpire
la variété du pinceau, & , dans un bel ouvrage,
élle eft un mérite de plus. Il n’eft aucune
partie de l’art & du métier, qui n’ exige des
foins , pareequ’ il n’en eft aucune qui ne foit
un moyen de plaire ( L ) .
P I T T O R E S Q U E ( adj). On entend par
ce mot, & ce qui convient à la peinture, ,
& ce qui fait un bon effet dans les ouvrages
de cet art. Il eft peu d’objets dans la nature
qui ne puiffent devenir pittorefques, par le
moyen de quelques attitudes que l’on peut y
donner, de quelques acceffoires qu’on y peut
ajufter, de quelque point de vue, fous lequel
on peut les confidérer. .
On dit cette phyfionomie eft pittorefque ,
cet habillement eft pittorefque, cette vue,
ce payfége eft pittorefque. Dans ces phrafes
le. moi pittorefque fignine qui convient à l’arc.
On dit que :ie Dominiquin a des êoëffures
' pittorefques, que les bizarreries- du Bénédecte
iontpittorefques ; 8c .cela fignifie que ces coëf-
P I T i8j
fures, ces bizarreries font un bon effet en
peinture.
Ce qui dans la nature a des formes maigres,
ce qui décrit des lignes droites & régulières
&• qui offre peu de variété, n’eft pas pittorefque.
Les vieux arbres dont le tronc eft tortueux
& rongé par le rems, dont l’écorce
fouvent interrompue eft profondément fil-
lonnëe, dont les branches font noueufes font
pittorefques; un arbre dont là tige eft droite
ik maigre ne l ’eft pas; mais il peut fe groupper
avec d’autres 8c former une maffe pittorefque.
Une table mince 8c qui décrit des lignes droites
n’eft pas pittorefque : elle peut le devenir en
l ’ajuftant avec d’autres objets qui cachent en
partie fa maigreur & fa régularité.
Le pittorefque, c ar ce mot le prend auffi fub-
ftantivement, tient moins ' au génie qui
exprime, qui fenr, & qui porte le.fenciment
| dans l’ame du fpeélateur, qu’au goûr qui fait
j choifir ce qui eft capable de plaire à la vue,
t Raphaël s’occupoit peu du pittorefque, que
cependant on rencontre fouvent dans fes ouvrages
; mais c’eft au pittorefque, que bien
des Maîtres inférieurs, doivent leur principal
mérite: ils ne .parlent point à l’ame, mais
ils ont l’arc d’enchanter les y eu x , & leur
mérire eft réel, puifqu’il produit d’ agréables
joijiftances.
Il n’y aurait qu’ une bien grande fupériorité
qui pût donner aujourd’hui le droit de négliger
le pittorefque : ou plutôt perfonne n’ a ce droit ;
car ce ferait annoncer bien de l ’orgueil, que
de vouloir impofer de l’ëftime aux fpe&ateurs
fans chercher à s’ infinuer dans leur bienveillance
, 8c à trouver les moyens de ; leur
plaire.
Certains peintres ont vu le public toujours
froid pour leurs ouvrages , quoiqu’ ils M e n t
peut-être fupérieurs à d’autres artiftes , qui
avoient les plus grands fuccès : c’eft que les
derniers avoient un goût pittorefque, & que
les premiers ne l’avoient pas.
Boucher à dû fa fortune paflagère à fon goût p ittorefque
, quoiqu’il négligeât toutes les grandes
parties de l’art, & même la plupart des parties
agréables.
Nous avons v u , dans ces derniers temps *
des ouvrages de l’art, obtenir tout le fuccès
qu’ ils méritoient /quoique le charme pittorefque
y fût négligé, ou plutôt quoiqu’ on eût judi-
cieufement penfc que ces charmes y feroient
déplacés. Ce font de beaux exemples, mais
il eft dangereux de les fuivre avec moins de
J génie. Ce goût auftère deviendrait barbare.
J Le goût pittorefque de la compofition confiftj
dans l’agencement agréable de tous les objets
| dont elle eft formée, dans la difpofition des
grouppes, dans leur enchaînement, dans des
| contraftes heureux, dans l ’accord & l’oppo