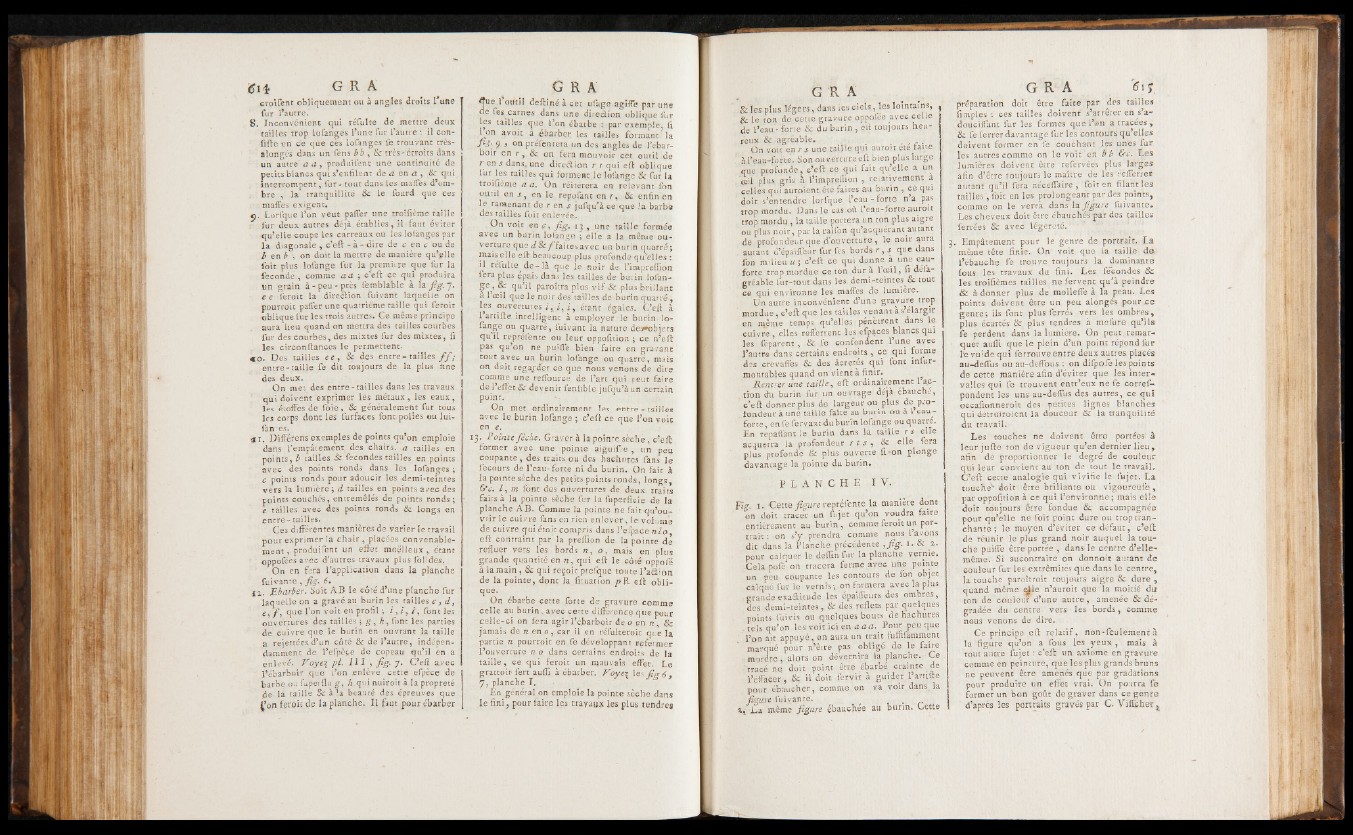
cro ifen t o b liq u em en t ou à a n g les droits Tune
fur l’autre. '
8 . In c o n v é n ie n t q u i réfui te d e m ettre deux
ta illes trop lofan ges l’u n e fur l’autre : il c o n f
ié e e n ce q u e cès lo fa n g es le trou van t très-
a lo n g és dans u n fens b b , & tr è s- étroits dans
un autre a a , p roduisent u n e co n tin u ité de
p etits b lan cs qu i s’en filen t de a en a , ,& q ui
in terrom p en t, fu r -to u t dans les maffes d’om b
re , la tran q u illité 8c le fourd q u e ces
: maffes ex ig e n t.
9 . L orfque l ’on v eu t paffer u n e troifièm e ta ille
v fur d eux autres déjà é ta b lie s , i l faut év iter
qu ’e lle coupe le s carreaux ou les lofan ges par
la d iagon ale , ç’eft - à - dire de c en c ou de
b en b -, on doit la m ettre de m anière qu’f ile
fo it plus lo fa n g e fur la premicre q u e fur la
féco n d é , com m e a a ; c’e ft ce q ui produira
u n grain à - peu - près fem b làb le à la fig. 7.
t e feroit la direction fu ivant la q u e lle on
pourroit paflèr un e quatrièm e ta ille q ui feroit
o b liq u e fur le s trois autres. C e m êm e principe
aura lie u q uand on m ettra d es ta illes courbes
fur des c o u r b e s,d e s m ix tes fur des m ix te s , fi
... le s circo n ftan ces le p erm etten t.
«O . D es ta ille s ee , 8c d es e n tr e - ta ille s f f ;
e n tr e -ta ille fe dit toujours de la plus fin e
d es d eu x.
O n m et des e n tr e -ta ille s dans les travaux
q u i d o iv en t exprim er le s m éta u x , les e a u x ,
le s étoffes d e f o i e , & g én éralem en t fur tous
le s corps d on t le s furfaces font, p o lies ou lu i-
f a n e s .
£ i . D iffère ns exem p les de points qu’on em p loie
dans l’em p âtem en t des ch airs, a ta ille s en
p o in ts, b ta illes 3c fécon d és ta ille s en p oints
a v e c des points ronds dans les lo fa n g es ;
c points ronds pour adoucir les d em i-tein tes
v er s la lum ière ; d ta ille s en p oints a v ec des
p o in ts c o u ch é s, entrem êlés d e p oin ts ro n d s; e ta illes a v ec des points ronds & lo n g s en
e n tr e -ta ille s .
C es d ifférentes m anières de v arier le travail
p our exp rim er la c h a ir , placées co n v en a b lem
en t , produifent un effet m o elleu x , étant
oppofées a vec d’autres travaux plus folid es.
' O n en fera l'a p p lication dans la p lan ch e
fu iv a n te., f i g . 6 , iz. Ebarber. S o it A B le coté d’une p lan ch e fur
la q u e lle on a g ra vé au burin les ta ille s c , dj
e, ƒ , q u e l ’on v o it en profil -, / , / , t , fon t les
o u vertu res des ta ille s -, g , A , font les parties
d e c u iv re q u e le burin en ouvrant la ta ille
a rejettée&d’un côté & de l’a u tre, in d ép en d
am m ent de l’efpèçe de copeau qu’il en a
e n le v é . Voye\ pi. I I I , fig. 7 . C ’eft a v e c
l’ébarboir q u e l’on e n lè v e c ette efp èce d e
barbe oufuperflu g , h.qui nuiroit à la propreté
d e la ta ille & à la beauté d es épreuves q u e
l ’on feroit d e la p la n ch e. I l faut pour ébarber
*fue 1 o iïtil d eftin é à c e t u fage a giffe par une
de fes carn es dans u n e direction o b liq u e fur
le s ta illes q u e l’on ébarbe : par ex em p le, fi
I o n avo ir à ébarber les tailles form an t la
fio\ 9 > on préfentera un des a n gles de l’ébar-
boir en r , & on fera m o u v o ir c e t o u til de
r en s d a n s,u n e direction r f q u i e ft o b liq u e
lur les ta illes q u i form ent le lofan ge & fur la
troifiem e a a. O n réitérera en relev a n t fon
o u til en s , en le repofant en r , & en fin en
le ram enant d e r en s jufqu'à ce q u e la barbe
des ta illes foit e n lev ée.
O n v o it en ç y fig . , u n e ta ille form ée
a v ec un burin lo tâ n g e ; e lle a la m êm e o u vertu
re q u e d 8c f fai tes a v e c un burin q uarré;
m a ise lle e ft beaucoup plus profonde qu’e lle s :
il reluire^ d e - là q u e le n o ir de l’im preflion
fera plus épais dans les ta illes d e burin lofan -
g e , & q u ’il paroîtra plus v if & plus b rilla n t
a 1 oe il q u e le n oir des ta illes de burin quarré ,
le s ou vertu res i , 2, £ , étant ég a les. C’eft à
1 artifte in te llig e n t à em p lo yer le b u r in -lo fan
ge ou q u arré, fu iva n t la nature des»objers
q u il repréfente ou leur, oppoficion ; ce n’e ft
pas q u ’on n e puiffe b ien faire en gravant
tou t a v ec un burin lo fa n g e ou q u arré, m ais
on doit regarder c e q u e nous ven on s de dire
com m e une reffource d e l’art q u i peut faire
d e l’effet 8c d ev en ir fen fib le ju fq u ’à un certain
poin t.
Ç)n m et ord in airem en t le s en tre - ta illés
a v ec le burin lo fa n g e ; c ’eft: ce q u e l’on v o it
en e.
13. P ointe fâche. Graver à la p oin te s è c h e , c’e ft
form er a v ec u n e p o in te a ig u ife , un peu
c o u p a n te , des traits ou d es h a ch u res fans le
fecours de l ’eau -fo rte n i du b u rin . On fait à
la pointe s èch e des petits points ro n d s, lo n g s ,
Z, m fon t des ou vertu res de d eux traits
faits à la p oin te sèch e fur la fu p erficie de la
p lan ch e A B . C om m e la p oin te n e fait q u ’ouvrir
le cu iv re fans en rien e n le v e r , le v olum e
d e cu ivre q u i étoit com p ris dans l’efpace nlo
e ft con train t par la preftion d e la p o in te d e
refluer v ers les bords n , 0 , m ais en plus
g ra n d e q u an tité en n , q u i e ft le côté oppofé
à la m ain , 8c q u i reçoit prefque tou te l ’a â io n
d e la p o in te , d o n t la fituation p R e ft o b liq
u e.
O n ébarbe cette forte d e gravu re com m e
c e lle au b u rin , a v ec ce tte différence q u e pour
c e lle -c i on fera agir l ’ébarb oir de o pn n . 8c
jam ais de n en o ,.c a r il en réfü lteroit q u e la
partie n pourroit en fe d évelop pant referm er
l ’ouverture n o dans certain s en d roits d e la
ta ille , c e q u i fero it un m auvais * effet. L e
, grattoir- fert aufii à ébarber. Voyex les E s 6 .
7 , p la n e h e l.
En général on em p lo ie la p oin te sèch e dans
le fin i, pour faire les travau x le s p lu s tendres
& les plus lé g e r s , dans les ciels., les lo in ta in s, ,
& le ton de c e tte gravu re oppofée a v ec c e lle
de l ’eau - force & du burin , eft tou jours h ç u - .
feu x & a gréab le. ,
O n v oit en r s une ta ille qui au roit ete faite
à l’eau -forte. Son o u vertu re e ft bien pltis large <
que p ro fo n d e, c ’e ft ce q ui fait qu’e lle a un
oe il plus gris à l’ impreflion , relativement a
c e lle s q u i a u ro ien tété faites au burin , c è q ui
d o it s'en ten d re lorfque l’e a u -fo r te n’a pas
trop m ordu. D ans le cas où l’eau -fo rte auroit
trop mordu , la ta ille portera un ton plus aigre
ou p'iu’s n o ir , par la. raifpn qu’acquérant autant
de profondeur q u e d’ou vertu re , le n o ir aura
autant d’épaiffeur fur fes bords r , j q u e dans
fon milieu u j c’e ft c e q u i d onne à u n e eau -
forte trop m ordue ce ton dur a 1 oe il, fi d él’a-
g réa b le fu r-tou t dans le s d em i-tein tes & tout
ce q u i en v iron n e les maffes d e lum ière.
U n autre in co n v én ien t d’u n s gravu re trop
m o r d u e , c’eft q u e les ta illes v en a n ta s’élargir
en m êm e tem ps qu’elles pén ètren t dans le
cu iv re , e lles refferrent les efpaces b lan cs q u i
les fép a ren t, & fe con to n d en t l’u n e a vec
l ’autre dans, certain s en d roits , c e q u i form e
d es crevaffes & des âcretés q u i fonc in fu r-
m on tab les quand on v ie n t à fin ir. ^
Rentrer une taille, e ft o rd in a irem en t 1 a,c-
tio n du burin fur un o u vra ge déjà éb a u ch é,
c ’eft donner plus de largeu r ou plus de^profon
d eu r à une ta ille faite au b u rin o u à 1 e a u -
forte , en fe fervaat du burin lo fa n g e ou quarré.
E n repaffant le burin dans la ta ille r s e lle
acquerra la profondeur r t s , & e lle fera
plus profonde & plus o u v erte fi-o n p lo n g e
d avan tage la p ointe du b u rin .
, P L A N C H E I V .
Éig. 1. C ette figure repréfente la m aniéré don t
o n d o it tracer un fu jet qu ’on vou d ra faire
entièrem en t au burin , com m e feroit un portrait
: on s’y.p ren d ra com m e nous l’avon s
d it dans la P la n ch e précédente ,fig . 1. & f -
pour calq u er le deflïn fur la p lan ch e v ern ie.
•Cela pofé on tracera ferm e a vec u n e p oin te
un peu cou pante les con tours d e fon o b jet
calq u é fur le v ern is; on form era a v ec la plus
grande exa& itu d e les épaiffeurs des om b res,
des d em i-te in te s , & des reflets par q u elq u es
points fui vis ou q u elq u es bouts d e hach u res
. te ls qu ’on les v o it ici en a a a. Pour peu q u e
■ l’on ait a p p u yé, on aura un trait luffifam ment
marqué pour n’êcre pas o b lig e d e le fa ii e
m o rd re, alors on dévern ira la plan ch e. C e
tracé n é d o it point être ébarbe crain te de
l’éffa cer, &; il d oit ferv ir à g u id er l’artifte
pour éb a u ch er, com m e on va voir d an s; la
figure fu iv a n te. .
s.» L a m êm e figure éb a u ch ée au b u rin . C ette
préparation doit être fa ite par d es ta ille s
fin iples : ces ta illes d o iv e n t s’arrêter en s’a -
douciffant fur les form es q u e l’o n a tracées ,
& fe ferrer d avan tage fur le s con to u rs q u ’e lle s
d o iv e n t form er en fe co u ch an t lés u n es fur
les autres com m e on le v o it en b b &rc. L es
lum ières d o iv e n t être refervées plus la rg es
afin d’être toujours le m aître d e le s refferrer
autant qu’il fera n éceffaire , fo it en filan t le s
ta ille s , foit en les p ro lo n gea n t par des p o in ts,
com m e on le verra dans la figure fu iva n te.
Les ch ev eu x d o it être éb au ch és par des ta ille s
ferrées 8c a v e c lég èreté. ’ '
3. E m p âtem ent pour le g en re d e portrait. La
m êm e tête fin ie. O n v o it q u e la ta ille d e;
l’éb a u ch é fe tro u v e tou jou rs la dom in an te
fou s les travau x du fin i. L é s fécon d és &
le s troîfièm es ta ille s . n e ferv en t qu'à p ein d re
& à don n er plus d e m olleffe à la peau. L es
p oints d o iv en t être un peu a lo n gés p o u r ,c e
g e n r e ; ils fon t plus ferrés vers les o m b r e s,
plus écartés & plus ten d res à m efu re qu’ils
fe perdent dans la lum ière. O n peut, remarquer
aufii q u e le p lein d’un p o in t répond fur
îe y u :d e q u i fe trou ve en tre d eu x autres placés
au-deffu s ou au -deffous : on d ifp ofè les p o in ts
d e c e tte m an ière afin d’év iter q u e les in ter v
a lle s q u i fe tro u v en t en tr’eu x n e fe co rref-
p ondent les uns au -d effu s d es a u tres, ce q u i
o cca fio n n eroit d es p etites lig n e s b la n ch es
qui d étru iroien t la d ou ceu r 8c la tran q u ilité
du travail.
L e s tou ch es n e d o iv e n t être portées à
leu r ju fte ton d e v ig u eu r qu ’en d ern ier lie u ,
afin d e proportionner le d eg ré d e co u leu r
qui leu r c o n v ien t au ton de tou t le tra v a il.
C ’e ft c e tte a n a lo g ie q u i vivi f ie le fu jet. La
to u ch e1* d o it être b rilla n te où v ig o u r e u fe ,
par oppofitîok à ce q u i l’en v iron n e ; m ais e lle
d o it tou jours être fon d u e & accom p agn ée
pour q u ’e lle n e fo it poin t dure ou trop tranch
a n te ; le m o yen d’év iter c e d éfa u t, c’e ft
d e réunir le plus grand n o ir a u q u el la tou ch
e puiffe être portée , dans le cen tre d’e lle -
m êm e. S i aucontraire o n d onnoie autant d e
co u leu r fur les' extrém ités q u e dans le cen tre,
la to u ch e paroîtroit toujours a ig re & dure ,
quand m êm e ©Me n’auroit que la m oitié du
ton d e co u leu r d’u n e a u tr e , am en ée & d égrad
ée du cen tre vers les b o r d s, com m e
nous v en o n s d e d ire.
C e principe e ft r e la tif, n o n -fe u lem en t à
la figu re q u ’on a fou s les y e u x , m ais à
tou t autre fu jet : c’e ft un a xiom e en gravu re
com m e en p ein tu re, q u e le s plus grands bruns
n e p eu v en t être amériés q u e par grad ation s
I pour produire un effet vrai. O n pourra fe form er u n b o n g oû t d e graver dans ce g en re
d’après les portraits gravés par C . V iflb h er a