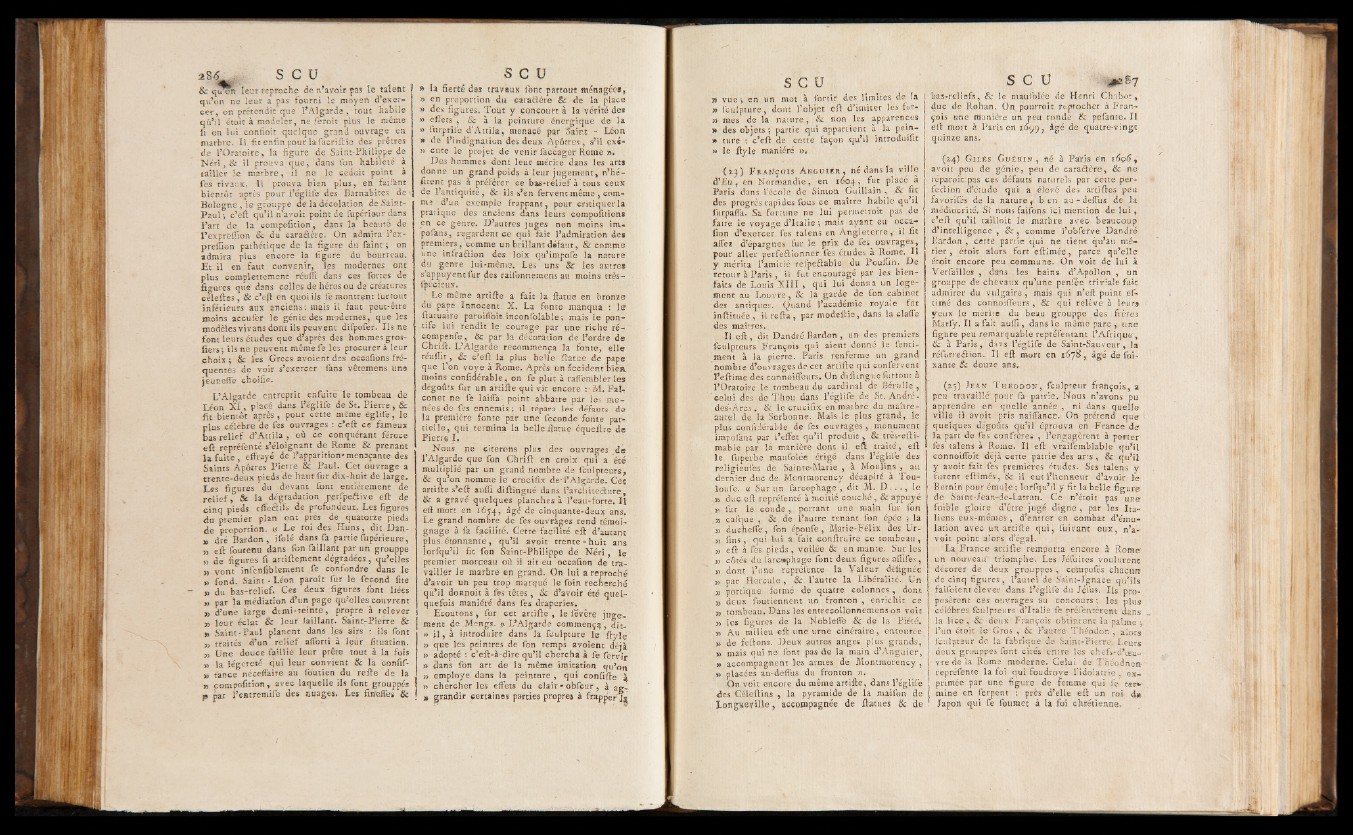
s c u
& leur reproche de n’ avoir pas le talent
qur’on ne leur a pas fourni le moyen d’exerce
r , on prétendit que l’ Al garde, tout habile
qu’ il étoit à modeler, ne feroit plus le même
li on lui confioit quelque grand ouvrage en
marbre. Il fit enfin pour lafaeriftie des prêtres
de l’Oratoire, la figure de Saint-Philippe de
N é r i, & il prouva que, dans fon habileté à
tailler j e marbre, il ne le cédoit point a
fes rivaux. I l prouva bien plus, en faifant
bientôt après pour l ’églile des Barnabites de *
Bologne, le grouppe de ladécojation de Saint-
Paul -, c’eft qu’ il n’a voit point de fupériour dans
l ’art de la compofition , dans la ' beauté de
l ’ expreffion & du caraélère. On admira l’ex-
preflion pathétique de la figure du faint ; on
admira plus encore la figuré du bourreau.
Et il en faut convenir, les modernes ont
plus complettement réufli dans ces fortes de
figures que' dans celles de héros ou de créatures
céleftes , & c’eft en quoi ils fe montrent l'urtout
inférieurs aux anciens: mais il faut peut-être
moins acçufer le génie des modernes, que les
modèles vivans dont ils peuvent difpofer. Ils ne
font leurs ,études que d’après des hommes gros-
fiers-, ils ne peuvent même fe les procurer à leur
choix ; 8c les Grecs avoient des occafions fréquentes
de voir s’ exercer fàns vêtemens une
ieuneffc choifie.
L’Algardë entreprit enfuite le tombeau de
Léon X I , placé dans l’églife de St. Pierre, &
fit bientôt après , pour cette même é g life , le
plus célèbre de fes ouvrages : c’eft ce fameux
bas-relief d’Attila , où Ce conquérant féroce
eft repréfenté s?éloignant de Rome 8c prenant
la fu ite , effrayé de l’apparition* menaçante dés
Saints Apôtres Pierre & Paul. Cet ouvrage a
trente-deux pieds de haut fur dix-huit de large.
Les figures du devant font entièrement de
r e l ie f , & la dégradation pçrfpeÂive eft de
cinq pieds effectifs de profondeur. Le? figures
du premier plan ont près de quatorze pieds
de proportion. # L e roi des Huns, dit Dan-
» dré Bardon, ifolé dans fa partie fupérieure,
» eft foutenu dans fon Taillant par un grouppe
» de figures fi artifteynent dégradées, qu’elles
» vont infenfiblement fe confondre dans le
» fond. Saint - Léon paroît fur le fécond fite
» du bas-relief. Ces deux figures font liéçs
» par la médiation d’un page quelles couvrent
» d’une large demi-teinte, propre à relever
» leur éclat & leur laillant. Saint-Pierre &
„ Saint- Paul planent dans les airs : ils font
» traités d’un relief afforti à leur fimation.
» Une douce faillie leur prête tout à la fois
» la légèreté qui leur convient & là çonfif-
» tance néceffaire au fôutien du refte de la
» compofition, avec laquelle ils font grouppés
p par l’eatremife des nuages. Les fiifeffes &
s c u
» îa fierté des travaux font partout ménagées,
» en proportion du çara&ère 8c de la place
» des figures. Tout y concourt à la vérité de*
» effets1, & à la peinture énergique de la
» furprifc d’A ttila , menacé par Saint - Léon
» de l’indignation des deux Apôtres, s’ il ex«-
» cute le projet de venir faccager Rome ».
Des hommes dont leur mérite dans les arts
donne un grand poids à leur jugement, n’hé-
fitent pas a préférer ce bas-rélief à tous ceux
| de l’antiquité, & ils s’en fervent même , corn-
m? d’uty exemple frappant, pour critiquer la
pratique des anciens dans leurs compofition*
en ce genre. D’autres juges non moins im-*
pofans, regardent ce qui fait l’admiration des
premiers, tomme un brillant défaut, & compte
une infraction des loix qu’impofe la nature
du genre lui-même. Les uns & les autres
s’appuyentfur des raifonnemens au moins très-?
fpécieux.
Le même artifte a fait la ftatue en bronze
du pape Innocent X. La fonte manqua : le
ftatuaire paroifîbic. inçojilbîable; mais le pontife
lui rendit le courage par une riche ré?
compenfe, 8c par la décoration 4e l’ordre de
Chrift. L’Algarde recommença la fonte, ellç
reuflit, & c ’eft la plus belle ftatue de pape
que l'on voye à Rome. Après un accident bien
inoinaxonfidérable, on fe plut à raflèmbler les
dégoûts fur un artifte qui vit encore : M. Fal-
conet ne fe lâiffa- point abbatre par les me-,
nées de fes ennemis-, il.répara les défauts de
la première fonte par une fécondé fonte part
ie lle , qui termina la belle ffatue équeftre de
Pierre I .
Nous ne citerons plus des ouvrages de
l’Algarde que fon Chrift en croix qui a été
multiplié par un grand nombre de fculpteurs,
& qu’on nomme le crucifix de-l’Algarde. Cec
artifte s’eft aufii diftingué dans l’architeélure,
& a gravé quelques planches à l’eau-forte. I l
eft mort en 1654, âge de cinquante-deux ans.
Le grand nombre de fes ouvràges rend témoignage
à fa facilité. Cette facilité eft doutant
plus.étpnnante ? qu’il ayoit trente-huit ans
lorfqu’ il fit fon Saint-Philippe dé N é r i, le
premier morceau où il ait eu occafion de travaillai*
le marbre en grand. On lui a reproché
d’avoir un peu trop marqué Je foin recherché
qu’ il donnoit à fes têtes, & d’avoir été quelquefois
maniéré dans fes draperies.
Ecoutons, fur cet artifte , le févère jugement
de Mengs. jr L’ Algarde commença dit-
» j l , à introduire dans la fculpture \p ûyle
y> que les peintres de fon temps avoient déjà
» adopté : c ’eft-à-dire qu’ il chercha à fe fervir
» 4ans fon art de la même imitation qu’on
I » employé dans la peinture , qui confifte 4
1 » chercher les effets du clair * obfçur, à ag-
! » grandir certaine* parties propres à frapper
s c u
n vue -, en un mot à fortif des limites de la
» fculpture, dont l ’objet eft d’ imiter les for-
>5 mes de la nature, 8ç non les apparences
» des objets *, partie qui appartient a la pôift-
» tufe : c’eft de cette façon qu’ il intfoduifit
» le ftyle maniéré
(2 3) F rançois à n g u îé r , né dans la ville
d’ Eu ^ en Normandie, en 1604^ fut placé à
Paris dans l’école de Simon Guillaïn , .8c fit
des progrès rapides fous ce maître habile qu’ il
liirpaflà. Sa fortune ne lui permettoit pas de
faire le voyage d’Italie -, mais ayant eu occafion
d’exercer fes talens en A nglete rre, il fit
affez d’épargnes fur le prix de fes ouvrages,
pour aller perfectionner fes études a Rome. I l
y mérita l’ amitié réfpeélable du Poulfin. De
retour à Paris , il fut encourage par les bienfaits
de Louis X I I I , qui lui donna un logement
au Louvre, 8c la garde de fon cabinet
des antiques.- Quand l ’académie royale fut
inftituée , i l r e f ta , par modeftie, dans la claffe
des maîtres..
Il e f t , dit Dandré Bardon , un des premiers
fculpteurs François qui aient donné le Centi-
ment a la pierre. Paris renferme un grand
nombre d’ouvrages de cet artifte qui eonfervent
l ’eftime des connoiffeurs. On difiingue furtout à
l ’Oratoire le tombeau du cardinal de Bertille,
celui des de Thou dans l’églife de St. André-
des-Arcs , 8c le crucifix en maibre du maître-
autel de la Sorbonne. Mais le plus grand, le
plus confidérable de fes ouvrages , monument
impôfant par l’effet qu’ il produit , & très-efti-
mable par là manière dont il eft traité, eft
le fuperbe maufolée érigé dans l’églife des
religieufes de Sainte-Marie , à Moulins , au
dernier duc de Montmorency décapité à Tou-
lou fe. « Sur un farcophage , dit M. D . . . , le
35 duc eft repréfenté à moitié couché, 8c appuyé
» fur le coude, portant une main fur fon
.» cafque , & de l’autre tenant fon épée la
» ducheffe, fon époufe , Marie-Félix des Ur-
» fins, qui lui a fait conftruirë ce tombeau,
» eft à fes pieds , voilée & en mante. Sur les
» côtés du làrc«#phage font deux figures afiiPes,
» dont l’ une reprélente la Valeur délignéc i
» par Hercule, & l ’autre la Libéralité. Un
x> portique formé de quatre colonnes , dont
,3 deux foutienner.t un fronton , enrichit ce
» tombeau. Dans les entrecollonnemens on voit
» les figures de la Noblefle 8c de la Piété.
» Au milieu eft une urne cinéraire , entourée
» de fêlions. Deux autres anges plus grands,
» mais qui ne font pas de la main d’Anguier,
» accompagnent les armes de Montmorency,
» placées au-deffus du fronton ».
On voit encore du même artifte, dans l’églife
des Céleftins , la pyramide de la maifon de
Longuev ille, accompagnée de ftatues & de
S C U
bas-reliefs, 8c le maufolée de Henri Chabot, 4uc de Rohan. On pourroit reprocher à François
une manière un peu ronde & pefante. Il
eit mott à Paris ert 1099, âgé de quacre-vingc
quinze ans.
(24) Gilés Guérin , né à Paris en 16ç6 9
avoit peu de génie, peu de caraélère, & fie
réparoit pas ces défauts naturels par cette perfection
d’étude qui à élevé des artiftes peu
favorifes de la nature ^ b:cn au-deffus de la
médiocrité. Si noüs faifons ici mention de lu i ,
c’eft qu’ il tailloit le marbre avéo beaucoup
d’intelligence , & , comme l’obfefve Dàndi'é
Bardon , cette patrie qui ne tient qu’au métier
j étoit alors fort eftimée, parce qtf’elîc
étoit encore peu commune. On voit de lui à
Verfailles , dans les bains d’Apollon , un
grouppe de chevaux qu’ uné penfée triviale fait
admirer du vulgaire , mais qui n’ eft point e£»
timé des conrtoifieurs, & qui relève à leur»
yeux lé mérite du beau grouppe des frères
Marly. I l a fait auffi, dans le mêmë parc, une
figure peu remarquable reprefentant l’Afriqu e,
8c à Paris , da?s l’églife de Saint-Sauveur , la
féffurrëélîori. I l eft mort en 1678, âgé de foi-
xante 8c douze ans.
(25) Jean T hèodôn, fcnîpteur rrahçois, 2
peu travaillé' pour fa patrie. Nous n’avons pu
apprendre en quelle année , ni dans quelle
v ille iï avoit pris naiffance. On prétend que <
quelques dégoûts qu’ il éprouva en France de
la part de fês confrères , l’engagèrent à porter
fes talens à Rome. Il eft vraifemblable qu’ il
connoiffoit déjà cette patrie des arrs , & qu’ il
y avoit fait fes premières études. Ses talens y
furent eftimés, 8c il eut l’ henneur d’avoir le
Bernin pour émule ; lprfq.uyil y fît la belle figure
de Saïnt-jean-de-Latran. Ce n’étoit pas une
foible gloire d’être jugé digne , par les Italiens
eux-mêmes, d’ entrer en combat d’émulation
avec un artifte q ui, fuivant eux, n’a-
voit point alors d’égal.
La France artifte remporta encore à Rome
.un nouveau triomphe. Les Jéfuites voulurent
décorer de deux grouppés, cotnpofés chacun1
de cinq figures, l ’autei de Saint-Ignace qu’ ils
faifoient élever dans l ’églilè du Jéfus. Ils proposèrent
ces ouvragés au concours -, les plus
célèbres fculpteurs d’ Italie fe préfentèrent dans'
la lice , 8c deux François obtinrent la palme -y
, l’ un étoit le Gros , 8c l ’autre Théodon alors
| fculpteur do la fabrique de Saint-Pierre. Leurs
deux grouppés font cités entre les chefs-d’oeuvre
de la Rome moderne. Celui de Théodncrr
reprélente la foi qui foudroyé fidolâtrie exprimée
par une figure de femme qui le ter*
mine en ferpent : près d’elle eft un roi dut
Japon qui fe fournée à la foi chrétienne^