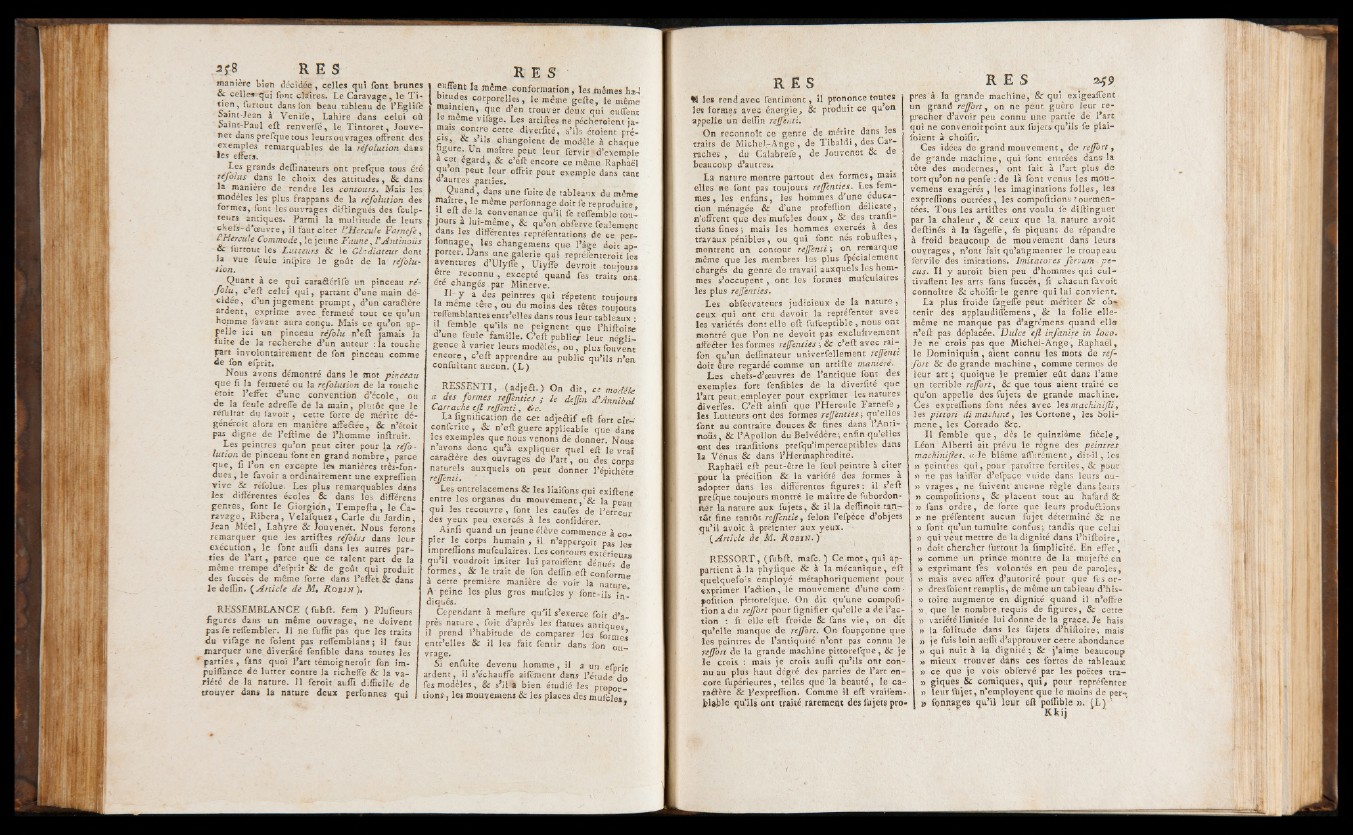
R E S maniéré bien décidée, celles qui {ont brunes
& celles q'ui font clifires. Le Caravage, le T i tien
, furtout dans fon beau tableau de l’Eglife
Saint-Jean a Ven ife , Lahire dans celui où
Saint-Paul eft renverfé, le T into ret, Jouve-
net dans prefquetous leiirsouvrages offrent des
exemples remarquables de la réfolution dans
les effets.
Les grands deffinateurs ont prefque tous été
réjblus àans le choix des attitudes, & dans
la manière de rendre les contours. Mais les
modèles les plus, frappans de la réfolution des
formes, font les ouvrages diftingués des fculp-
teurs antiques. Parmi la multitude de leurs
chefs-d'oeuvre y il faut citer l ’Hercule Farneje,
C Hercule Commode, le jeune Faune, VAntinous
& furtout les Lutteurs & le Gladiateur dont
la vue feule infpire le goût de la réfolution.
Quant à ce qui caraâérlfe un pinceau ré-
f °}u , c’efl celui q u i, partant d’ une main décidée,
d’un jugement prompt, d’un caraâère
ardent, exprime avec fermeté tout ce qu’un
homme favant aura conçu. Mais ce qu’on appelle
ici un pinceau réfolu n’eft jamais la
fuite de la recherche d’ un auteur : la touche
part involontairement de Ion pinceau comme
de Ion efprît.
Nous avons démontré dans le mot pinceau
que fi la fermeté ou la réfolution de la touche
étoit l’effet d’une convention d’école, ou
de la feule adreffe de la main' plutôt que le
réfulrat du fa voir , cette forte de mérite dé-
généroit alors en manière affe&ée, & n’étoit
pas digne de l’eftime de l’homme infirme.
Les peintres qu’on peut citer pour la réfolutio
n ae pinceau font en grand nombre, parce
que, fi l ’on en excepte les manières très-fondues
, le favoir a ordinairement une exprefiien
v ive & réfolue. Les plus remarquables dans
les différentes écoles & dans les différens
genres, font le Giorgion, Tempefta, le Caravage
, Ribera, Velafquez, Carie du Jardin,
Jean Méel, Lahyre & Jouvenét. Nous ferons
remarquer que les artiftes refolus dans leur
exécution, le font aulfi dans les autres parties
de l’a r t , parce que ce talent part de la
même rrempe d’ efprit & de goût qui produit
des fuccès de même forte dans l ’effek«: dans
le deflin. ( A rticle de M, R o b i n ),
RESSEMBLANCE ( fubft. fem ) Plufieurs
figures dans un même ouvrage, ne doivent
pas fe reffembler. I l ne fuffit pas que les traits
du vifage ne foient pas reffemblans ; il faut
marquer une diverfiee fenfible dans toutes les
parties , fans quoi l’art témoigneroit fon im-
puiflance de lutter contre la richeffe & la variété
de la nature. Il feroit aulfi difficile de
trouver dans la nature deux perfonnes qui
RES
I ? même conformation, les mêmes h»,1
1 îtudes corporelles, le même gefte, le même
maintien, que d’en trouver deux qui euffent
le même vifage. Les artiftes ne pécheraient jamais
contre cette diverfué, s’ ils étoient pré-
f i s , & s’ ils changoient de modelé à chaque
ligure. Lin maître peut leur fervir d’exemple
a cet egard , & c’eft encore ce même Raphaël
quon peut leur offrir pour exemple dans tant
d autres p arles.
Quand, dans une fuite de tableaux du même
•1 m^me Perf°image doit fe reproduire.
il eft de la convenance qu’ il fe reffemble toujours
a lui-même, & qu’on obferve feulement
dans les différentes repréfentations de ce per-
lonnage, Us changemens que l’âge doit apporter.
Dans une galerie qui repréiënteroit les
aventures d’UIyfle , Uiyffe devrait toujoui.
être reconnu, excepté , quand fes traits ont
ete changés par Minerve.
ï l - y a des peintres qui répètent toujours
la meme tête , ou du moins des têtes toujours
Teflemblantes entr’elles dans tous leur tableaux :
U femble qu’ils ne peignent que l’hiftoire
d une feule famille. C’eft publier leur négligence
à varier leurs modèles, ou, plus fouvent
encore, c’eft apprendre au public qu’ ils n’en
confultant aucun. (L )
RESSENTI, (a d je â .) On d it, et modUe
a des formes refendes ; le defm d’Annibal
Carrache ejt refend, &c.
La Lignification de cet ad je a if eft fort c ir -
confcrite, & n’ eft guere applicable que dans
les exemples que nous venons dé donner. Nous
n’avons donc qu’à expliquer quel eft le vrai
caraâère des ouvrages de l’ar t, ou des corps
naturels auxquels on peut donner l ’épithète
refend.
Les entrelacemens & les liaifons qui exiftenc
entre les organes du m o u v em en t& la peau
qui les recouvre, font les caufes de Terreur
des yeux peu exercés à les confidérer.
. Ainfi quand un jeune élève commence à copier
le corps humain , il n’apperçoit pas le*
impreflïons mnfculaires. Les conrours extérieur»
qu’il voudrait imiter lui paroiffent dénués de
formes, & le trait de fon deffm. eft conforme
à cette première manière de voir la nature.
A peine les plus gros mufcles y font-ils indiqués.
Cependant à mefure qu’ il s’exerce foit d’après
nature , foit d’après les ftarues antiques"
il prend l’habitude de comparer les formes
entr’elles & il les fait fentir dans fon ouvrage
Si enfuite devenu homme, il a un efprir
ardent, il s’échauffe aifément dans l’étude d©
fes modèles, & s’ il a bien étudié les proportions,
1er mouvemens & les places des mufcles
R E S W les fend avec fentiment, il prononce toutes
les formes avec énergie, & produit ce qu on
appelle un delfin rejfenti.
On reconnoît ce genre de mérite dans les
traits de Michel.-Ange , de T ib a ld i , des Car-
raches , du Calabrefe, de Jouvenet & de
beaucoup d’autres.
La nature montre partout des formes, mais
elles ne font pas toujours refendes. Les femmes,
les enfans, les hommes d'une éducation
ménagée & d’une profeffion délicate,
n’offrent que des'mufcles doux, 8c des tranfi-
tions fines *, mais les hommes exerces a des
travaux pénibles, ou qui font nés robuftes,
montrent on contour refen d ; on remarque
même que les membres les plus fpecialement
chargés du genre de travail auxquels les hommes
s’occupent , ont les formes mufculaires
les plus refendes.
Les obfervateurs judicieux de la nature,
ceux qui ont cru devoir la repréfenter avec
les variétés dont e lle eft fulèeptible, nous ont
montré que l’on ne devoit pas exclufivement
affeéler les formes refendes ; & c’eft avec rai-
fon qu’ un deflinateur univerfellement refend
doit êçre regardé comme un arcifte maniéré.
Les chefs-d’peuvres de l’antique font des
exemples fort fenfibles de la diverfite que
l ’art peut, employer pour exprimer les natures
dlverfes. C’ eft ainfi que l’Hercule Farnefe,
les Lutteurs ont des formes refend es -, qu’elles
font au contraire douces & fines dans l’Anri-
rtoüs, & l’Apollon du Belvédère-, enfin qu’elles
ont des tranfitions prefqu'imperceptibles dans
la Vénus & dans l ’Hermaphrodite.
Raphaël eft peut-être le feul peintre à citer
cour la précifion & la variété des formes a
adopter dans les différentes figures : il s’eft
prefque toujours montré le maître de fubordon-
fte'r la nature aux fujets, & i l ia defiinoic tan--
tôt fine tantôt re fe n d e , félon l’efpèce d’objets
qu’ il avoit à prélënter aux yeux.
( A rticle àe M . R g b jn .)
RESSORT, (fubft. mafe. ) C ém o t, qui appartient
à la pliÿfique & à la mécanique, eft
quelquefois employé métaphoriquement pour
exprimer l'aélion, le mouvement d’une corn-
pofition pittorefque. On dit qu’une compofi-
tion a du refort pour lignifier qu’elle a de l’action
: fi elle eft froide & fans v ie , on dit
qu’ elle manque de refort. On foupçonne que
les peintres de l’antiquité n’ont pas connu le
refort de la grande machine pittorefque, & je
le crois : mais je crois aulfi qu’ ils ont connu
au plus haut degré des parties de l’ art encore
fu.périeures, telles que la beauté, le ca-
raftère & Fexprelfion. Comme il eft vraifem-
i'iable qu’ils ont traité rarement des fujets pro-
R E S près â la grande machine, & qui exîgeaffent-
un grand refort, on ne peut guère leur reprocher
d’avoir peu connu une partie dé l’art
qui ne convenoit point aux fujets qu’ils fe plai-
foient à choifir.
Ces idées de grand mouvement, de refort f
dé grande machine, qui font entrées dans la
tête des modernes, ont fait à l’ art plus de
tort qu’on ne penfe : de là font venus les mouvemens
exagérés, les imaginations folles, les
exprelfions outrées , les compoficions tourmentées.
Tous les artiftes ont voulu fe diftinguer
par la chaleur , & ceux que la, nature avoit
deftinés à la fagefle, fe piquant de répandre
à froid beaucoup de mouvement dans leur*
ouyrages, n’ont fait qu’aügmenter le troupeau
fervile des imitations. Imitatores fervum vécus.
I l y auroit bien peu d’ hommes qui cultivaient
les arts fans fuccès, fi chacun favoit
connoître & choifir le genre qui lui convient.
La plus froide fageffe peut mériter & obâlB
tenir des applaudiflemens, & la folie elle-
même ne manque pas d’agrt'mens quand elle
n’eft pas déplacée. Dulce ejl infanire in loco.
Je ne crois pas que Michel-Ange, Raphaël,
le Dominiquin, aient connu les mots de ref-
fort & de grande machine, comme termes de
leur art ; quoique le premier eût dans l’ame
un terrible refort, & que tous aient traité ce
qu’on appelle des fujets de grande machine.
Ces exprelfions font nées avec les mac'hinijliy
les pittori di machiné, les Cortone , les Soll-
mene, les Corrado & ç .
Il femble q u e , dès le quinzième fiè c le ,
Léon Alberti ait prévu le règne des peintres
machiniflet. «-Je blâme alfurément, dic-il, les
» peintres q u i, pour paroître fertiles, & pour
» ne pas laiiTer d’ efpaçe vuide dans leurs ou-
» vrages , ne fuivent aucune règle dans leurs
» compofitions, & placent tout au hafard 8c
» fans ordre, de forte que leurs produélions
» ne préfentent aucun fujet déterminé & ne
» font qu’ un tumulte confus’, tandis que celui
» qui veut mettre de la dignité dans l’ hiftoire,
n doit chercher furtout la fimplicité. En effet,
» comme un prince montre de la majefté en
» exprimant fes volontés en peu de paroles,
» mais avec affez d’autorité pour que {fes or-
» dreslbient remplis, de même un tableau d’his-
» toire. augmente en dignité quand il n’offre
» .q u e l,e nombre requis de figures, & cette
» variété limitée lui donne de la grâce. Je hais
» la folitude dans les fujets d’ hiftoire-, mais
.» je fuis loin atjfii d?approuver cette abondance
» qui nuit à la dignité; 8c j’ aime beaucoup
» mieux trouver dans ces fortes de tableaux
» ce que je vois obfcrvé par les poètes tra-
» giques & comiques, q u i# pour repréfenter
» leur ftijet, n’employent que le moins de per-»
» tonnages qu’ il leur eft poflible ». (L ) ' K-kij