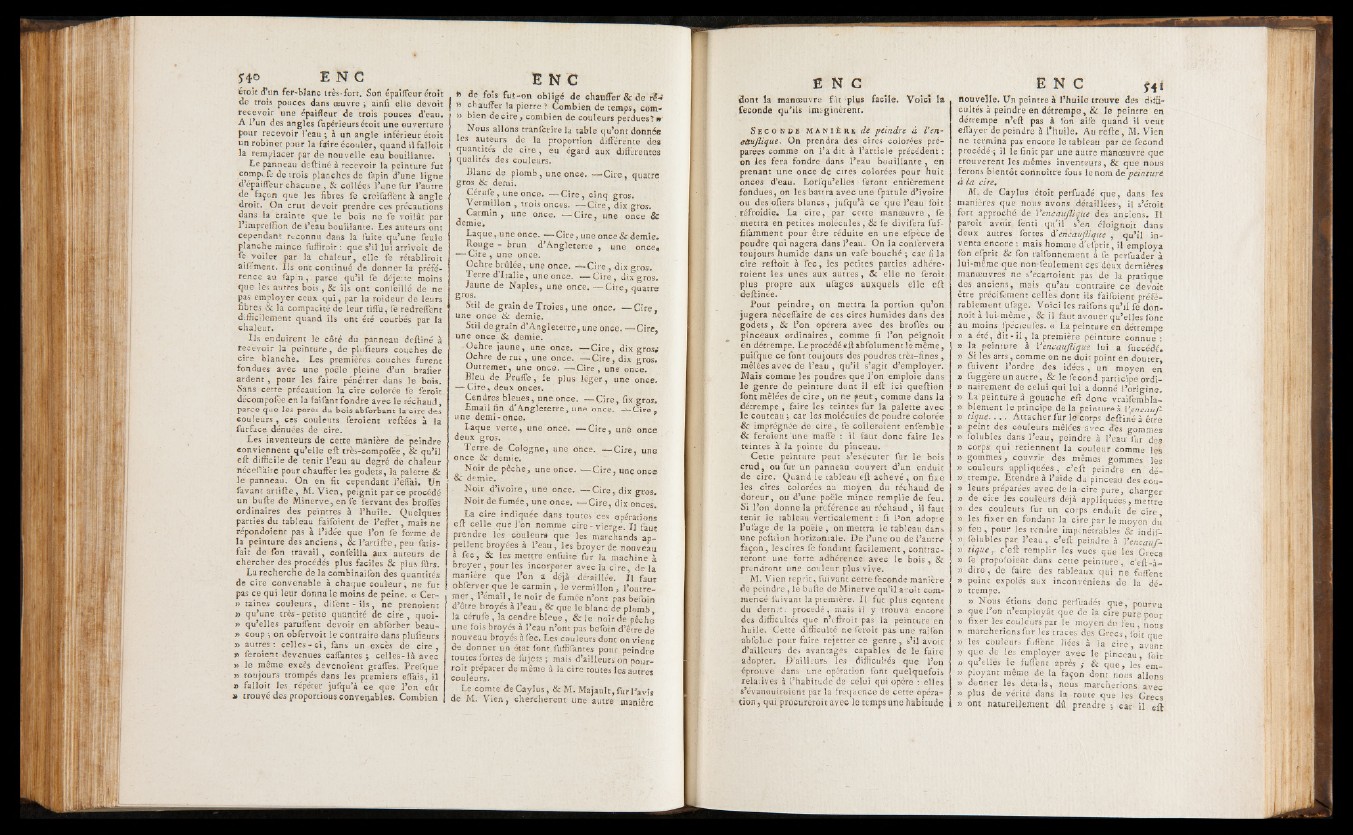
ttoit d’un fer-blanc très-fort. Son épaîfleur étoit
de trois pouces dans oeuvre ; ainfi elle devoit |
recevoir une épaîfleur de trois pouces d’eau, j
A l’ un des angles fapérieurs étoit une ouverture 1
pour recevoir feau ; à un angle inférieur étoit I
un robinet pour la faire écouler, quand il falloir I
la remplacer par de nouvelle eau bouillante.
Le panneau deftiné à recevoir la peinture fut
compvTe de trois planches de lapin d’ une ligne
d’épaiffeur chacune , & collées l ’une fur l ’autre
de façon que les fibres le croifafl'ent à angle
droit. On crut devoir prendre ces précautions
dans la crainte que le bois ne fe voilât par 1 imprefiion de l’eâu bouillante. Les auteurs ont
cependant reconnu dans la fuite qu’ une feule
planche mince fuffiroit : que s’ il lui arrivoit de
fe voiler par la chaleur, elle fe rétabliroit
aifement. Ils ont continué de donner la préférence
au lapin,, parce qu’il fe déjette moins
que les autres b ois , & ils ont confeillé de ne
pas employer ceux q ui, par la roideur de leurs
fibres 8c la compacité de leur tilfu, fe redreflent
difficilement quand ils ont été courbés par la
chaleur.
Ils enduirent lé côté du panneau deftiné <à
recevoir la peinture, de plufieurs couches de
cire blanche. Les premières couches furent
fondues avec une poêle pleine d’ un brader
ardent, pour les faire pénétrer dans le bois.
Sans cette précaution la cire colorée fe feroit
décompofëe en la faifant fondre avec le réchaud,
parce que les pores du bois abforbant la cire des
couleurs, ces couleurs feroient reftées à la
furface dénuées de cire.
Les inventeurs de cette manière de peindre
conviennent qu’ elle eft très^compofée, & qu’ il
eft difficile de tenir l’eau au degré de chaleur
néceffaire pour chauffer les godets, la palette &
le panneau. On en fit cependant l’ eflai. Un
favanc artifte, M. V ien, peignit parce procédé
un bufte de Minerve, en 1e fervant des broffes
ordinaires des peintres à l’huile. Quelques
parties du tableau faifoient de l’effet, mab ne
répondoient pas à l’ idée que l’on fe forme de
la peinture des anciens , & l’artifte, peu fatis-
faic de fon travail, confeilla aux auteurs de
chercher des procédés plus faciles & plus fûrs.
La recherche de la combinaifon des quantités
de cire convenable à chaque couleur, ne fut
pas ce qui leur donna le moins de peine. « Cer-
» taines couleurs, d ile n t - ils , ne prenoient
» qu’ une très-petite quantité de cire , quoi-
» qu’elles parurent devoir en abforber beau-
» coup *, on obfervoit le contraire dans plufieurs
» autres: c e lle s - c i, fans un excès de c ire ,
» feroient devenues caffantes ; ce lle s -là avec
» le même excès devenoient graffes. Prelque
» toujours trompés dans les premiers effaîs, il
» falloir les répéter jufqu’à ce que l ’on eût
» trouyé des proportious convenables. Combien
9> de fois fut-on obligé de chauffer & de rë*
» chauffer la pierre ? Combien de temps, coin-
» bien de cire 3 combien de couleurs perdues? n'
Nous allons tranlcrire la table qu’ont donnée
les auteurs de la proportion différente des
quantités de c ir e , eu égard aux différentes
qualités des couleurs.
Blanc de plomb , une once. — C ire , quatre
gros & demi.
Cérufe, une once. •— C ire , cinq gros.
Vermillon , trois onces. — C ire, dix gros.
Carmin, une once. «— C ire, une once 8c
demie»
Laque, une once. — Cire, une once & demie.
Rouge - brun d’Angleterre , une once,
— Cire , une once.
Ochre brûlée, une once. — Cire , dix gros.
Terre d’Italie, uneonce. — C ire , dix gros.
Jaune de Naples, une onee. — Cire, quatre
gros.
Stil de grain de Troies, une once. — C ire,
une once 8c demie.
Stil de grain d’Angleterre, une once.—-Cire,
une once & demie.
• Ochre jaune, une once. — C ire, dix grosj
Ochre de r u t , une once. — Cire, dix gros.
Outremer, une once. — C ire , une once.
Bleu de Pruffe, le plus lé g e r , une once.
— C ire, deux onces.
Cendres bleues, une once. — Çire, fix gros.
Email fin d’Angleterre, une once. - t-C ire ,
une demi-once.
Laque verte, une once. — C ire, une once
deux gros.
Terre de Cologne, une once. — Cire, une
once & demie.
Noir de pêche, une once. — Cire une once
& demie.
j Noir d’ivoire , une once. — Cire, dix gros.
Noir de fumée, une once. ■— Cire, dix onces.
La cire indiquée dans toutes ces opérations
eft celle que l ’on nomme cire - vierge. Il faut
prendre les couleurs que les marchands appellent
broyées à l’ eau, les broyer de nouveau
à fe e , & les mettre enfuite (ür la machine à
broyer, pour les incorporer avec la cire, d elà
manière que Ton a déjà détaillée. I l faut
oblerver que le carmin , le vermillon , l’outremer
, l’émail, le noir de fumée n’ont pas befoin
d’être broyés à l’eau, & que le blanc de plomb
la cérufe , la cendre bleue , & le noir de pêché
une fois broyés à l’eau n’ont pas befoin d’être dé
nouveau broyés à fec. Les couleurs dont on vient
de donner un état font, fuffifantes pour peindre
toutes fortes de iiijets ; mais d’ailleurs on pour-
roit préparer de même à la cire toutes les autres
couleurs.
Le comte deCaylus, & M. Majault,furTavis
de M. V ien, cherchèrent une autre manière
dont la manoeuvre fàt plus facile. Vole! la
fécondé qu’ ils imaginèrent.
S e c o n d e m a n i è r e de peindre à l'en-
cdujllque. On prendra des cires colorées préparées
comme on l’a dit à l ’article précédent :
on les fera fondre dans l ’ eau bouillante, en
prenant une once de cires colorées pour huit
onces d’eau. Lorlqu’ elles feront entièrement
fondues, on les battra avec une fpatule d’ ivoire
ou des ofiers blancs, jufqu’à ce que l’eau foit
refroidie. La c ire, par cette manoeuvre , fe
mettra en petites molécules, & fe divifera fuf-
filamment pour être réduite en une efpèce de
poudre qui nagera dans l’eau. On la confervera
toujours humide dans un vafe bouché ; car (i la
cire reftoit à fe c , les petites parties adhére-
roient les unes aux autres, & elle ne feroit
plus propre aux ufages auxquels elle eft
deftinée.
Pour peindre, on mettra la portion qu’on
jugera néceffaire de ces cires humides dans des
godets, & l’on opérera avec des brofles ou
pinceaux ordinaires, comme fi l’on peignoir
en détrempe. Le procédé eft abfolument le même,
puifque ce font toujours des poudres très-fines ,
mêlées avec de l’eau, qu’il s’agit d’employer.
IVlais comme les poudres que l’on emploie dans
le genre de peinture dont il eft ici queftion
lont mêlées de c ire , on ne peut, comme dans la
détrempe , faire les teintes fur la palette avec
le couteau ; car les molécules de poudre colorée
& imprégnée de c ire, fe colleraient enfemble’
& feroient une maffe : il faut donc faire les
teintes à~ la pointe du pinceau.
Cette peinture peut s’exécuter fur le bois
crud, ou fur un panneau couvert d’un enduit
de cire. Quand îe tableau eft achevé , on fixe
les cires colorées au moyen du réchaud de
doreur, ou d’une poêle mince remplie de feu.
Si l’on donne la préférence au réchaud , il faut
tenir le tableau verticalement : fi l ’on adopte
l’ufage de la poêle, on mettra le tableau dans
une pcficion horizontale. De l’une ou de l ’autre
façon, les cires fe fondant facilement, contracteront
une forte adhérence avec le bois &
prendront Une couleur plus vive.
M. Vien reprit, fuivant cette fécondé manière
de peindre., le bufte de Minerve qu’il a voit commencé
fuivant la première. I l fut plus cqntent
du dern:?v procédé, mais il y trouva encore
des difficultés que n’ oftroit pas la peinture en
huile. Cette difficulté ne feroit pas une raifon
abfolue pour faire rejetter ce genre, s’ il avoir
d’ailleurs des avantages capables de le faire
adopter. D ’ailleurs les difficultés que l ’on
éprouve dans une opération font quelquefois
rela;ives à l’habitude de celui qui opère : elles
s’évanouiroient par la fréquence de cette opération,
qui procureroit avec le temps une habitude
nouvelle. Un peintre à l’huile trouve des difficultés
à peindre en détrempe, & le peintre en
détrempe n’eft pas à l’on aife quand il veut
effayer de peindre à l’ huile. Au refte, M. Vien
ne termina pas encore le tableau par ce fécond
procédé-; il le finit par une autre manoeuvre que
trouvèrent les mêmes inventeurs, & que nous
ferons bientôt connoître fous le nom de peinture
à la cire»
M. de Caylus étoit perfuadé que, dans les
manières que nous avons détaillées', il s’étoit
fort approche de Yencaujliqïie des anciens. U
paroît avoir, fenti qu’ il s’en éloignoit dans
d'eux autres fortes d’ eticaufiique , qu’il inventa
encore ! mais homme d elprit, il employa
fon efprit & fon rationnement à fe petfuader à
lui-même que non-feulement ces deux dernières
manoeuvres ne s’écartoient pas de la pratique
des anciens, mais qu’au contraire ce devoit
être précifement celles dont ils faifoient préférablement
ufage. Voici les raifons qu’ il fe don-
noir a lui-même , 8c il faut avouer qu’elles font
au moins, fpécteufes. « La peinture en détrempe
» a été, d i t - i l , la première peinture connue :
» la peinture à Vencaujlique lui a fuccédé.
» Si les arts, comme on ne doit point en douter,
» fuivent Tordre.des idées, un moyen en
» fuggère un autre, & le fécond participe ordi-
» nairement de celui qui lui a donné l’origine.
» La peinture à gouache efl donc vrailembla-
» blement le principe.de la peinture à Vencauf-
» t iq u e .... Attacher fur le'corps deftiné à être
» peint des couleurs mêlées avec des gommes
»/folubles dans l’eau, peindre à l’ eau fur des
» corps qui retiennent la couleur comme les
» gommes, couvrir des mêmes gommes les
» couleurs appliquées, c’eft peindre en dé-
» trempe. Etendre à l’aide du pinceau des cou-
» leurs préparées avec de la'cire pure, charger
» de cire les couleurs déjà appliquées, mettre
des couleurs fur un corps enduit de cire
»■ les fixer en fondant la cire par le moyen du
» feu , pour les rendre impénétrables & indif-
» folubles par. l’eau, c’ eft peindre à l’encauf-
» tique, c’eft remplir les vues que les Grecs
» fe propofôient dans cette peinture, c’eft-à-
» dire , de faire des tableaux qui ne fi,(Tene
» point ex pôles aux inconvéniens de la dé-
» trempe.
» Nous étions donc perfuadés que, pourvu
» que l’on n’employât que de la cire pure pour
» fixer les couleurs par le moyen du feu , nous
» marcherions fur les traces des Grecs, foit eue
» les couleurs biffent liées à la c ir e , avant
» que de les employer avec le pinceau , foit
» qu’elles le fuffenc après ; & q ue, les em-
» ployant même de la façon dont nous allons
» donner les détails, nous marcherions avec
» plus de vérité dans la route que les Grecs
» ont naturellement dû prendre -, car il t (t