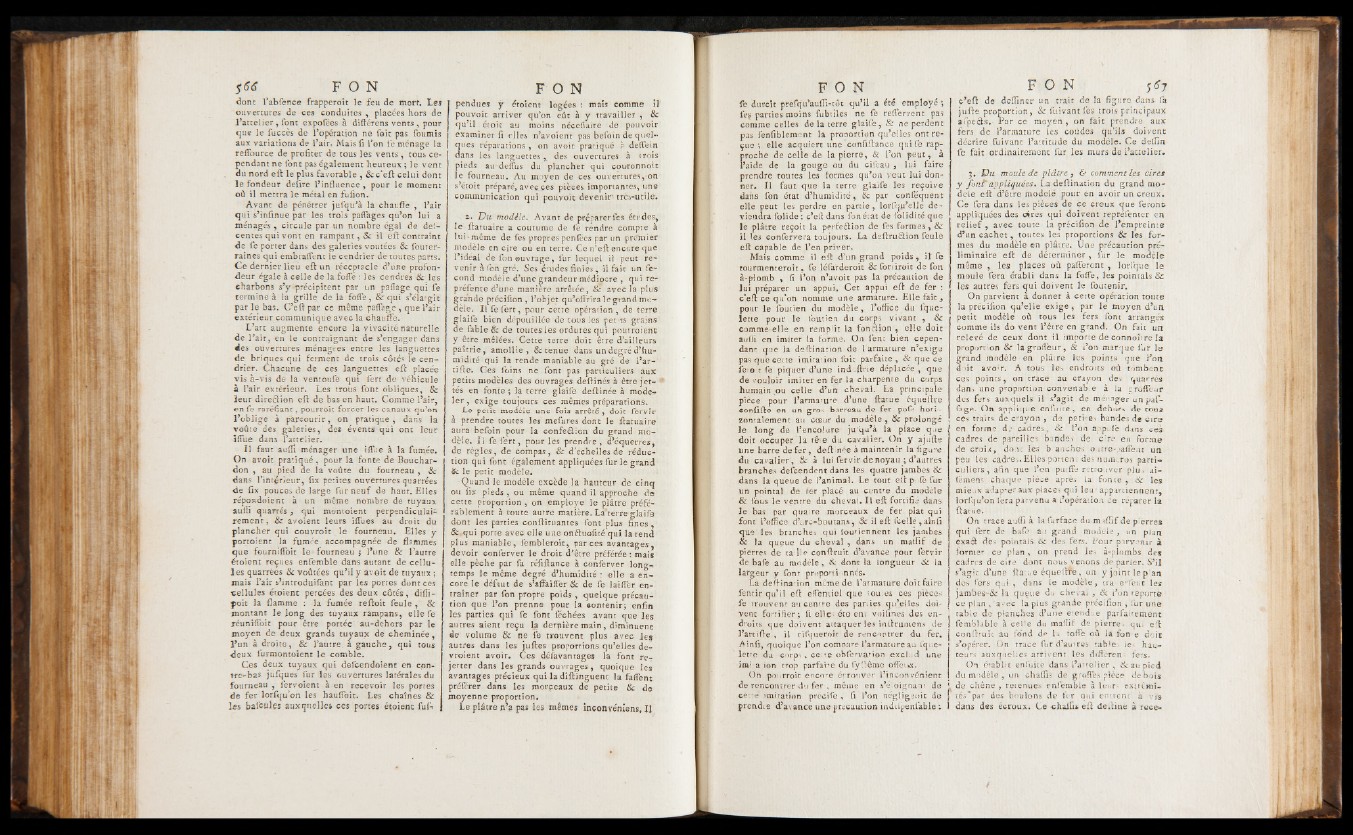
dont l’abfence frapperoit le feu de mort. Les
ouvertures de ces conduites , placées hors de
l ’attelier, font expofées à diftérens vents , pour
que le fuccès de l’opération ne (bit pas fournis
aux variations de l’air, Mais fi l’on le ménage la
reffource de profiter de tous les vents , tous cependant
ne font pas également heureux ; le vent
du nord eft le plus favorable , & c 'e ft celui dont
le fondeur defire l’ influence , pour le moment
où il mettra le métal en fufion.
Avant de pénétrer jufqu’ à la chauffe , l’air
qui s’ infinue par les trois partages qu’on lui a
ménagés , circule par un nombre égal de dei-
centes qui vont en rampant, 8c il eft contraint
de fe porter dans des galeries voûtées & fouter-
raines qui embralfent le cendrier de toutes parts.
C e dernier lieu eft un réceptacle d’une profondeur
égale à celle de la forte : les cendres & les
charbons s’y-précipitent par un partage qui fe
termine à la grille de la forte, & qui s’élargit
par le bas. C’ eft par ce même partage , que l’air
extérieur communique avec la chauffe.
L’art augmente encore la vivacité naturelle
de l ’air, en le contraignant de s’engager dans
des ouvertures ménagées entre les languettes
de briques qui ferment de trois côtés le cendrier.
Chacune de ces languettes eft placée
vis à-vis de la ventoule qui fert de véhicule
à l’air extérieur. Les trous font obliques, &
leur direction eft de bas en haut. Comme l’air,
en fe raréfiant, pourroit forcer les canaux qu’on
l ’oblige à parcourir, on pratique, dans la
voûte des galerie s,1 des évents qui ont leur
îflue dans l’attelier.
I l faut aufli ménager une îflue à la fumée.
On avoit pratiqué, peur la fonte de Bouchar- |
don , au pied de la voûte du fourneau , &
dans l’intérieur, fix petites ouvertures quarrées
de fix pouces de large fur neuf de haut. Elles
réposdoient à un même nombre de tuyaux
au fil quarrés, qui montoient perpendiculairement
, & avoient leurs iffues au droit du
plancher qui couvroit .le fourneau. Elles y
portoient la fumée accompagnée de flammes
que fournifioit le-fourneau j l’ une & l ’autre
étoient reçues enfemble dans autant de cellule
s quarrées & voûtées qu’ il y avoit de tuyaux -,
mais l’air s’introduifant par les portes dont ces
'cellules étoient percées des deux côtés, difii-
poit la flamme : la fumée reftoit feu le , &
montant le long des tuyaux rampans, elle fe
réunifloit pour être portée au-dehors par le
moyen de deux grands tuyaux de cheminée,
l ’ un à droite, 8c l’autre, à gauche, qui tous
deux furmontoient le comble.
Ces deux tuyaux qui delcendoient en contre
bas jufques fur les ouvertures latérales du
fourneau , fervoient à en recevoir les portes
de fer lorfqu’on les haufloit. Les chaînes &
les bafeuies auxquelles ces portes étoient fufr
pendues ÿ étoient logées : mais comme il
pouvoit arriver qu’on eût à y travailler , &
qu’il étoit au moins néceflàire de pouvoir
examiner fi elles n’avoient pas befoin de quelques
réparations , on avoit pratiqué ? deflein
dans les languettes, des ouvertures à trois
pieds au-deflus du plancher qui couronnoic
le fourneau. Au moyen de ces ouvertures, on
s’étoit préparé, aveç.çes pièces importantes, une
communication qui pouvoit devenir très-utile.
a. Du modèle. Avant de préparerfes études,
le ftatua re a coutume de fe rendre compte à
lui-même de fes propres penfées par un premier
modèle en cire ou en terre. Ce n’eft encore que
1 idéal de fon ouvrage, fur lequel il peut revenir
a fort gré. Ses études finies, il fait un fécond
modèle d’une grandeur médiocre , qui repréfente
d’une manière arrêtée, 8c avec la plus
grande précifion , l ’objet qu’offri raie grand modèle.
Il fe fe r t, pour cetre opération, de terre
glaife bien dépouillée de tous les petits grains
de fable & de toutes les ordures qui pourroienc
y être mêlées. Cette terre doit être d’ailleurs
paîtrie, amollie, & tenue dans un degré d’ humidité
qui la rende maniable au gré de l’ar-
tifte. Ces foins ne font pas particuliers aux
petits modèles des ouvrages deftinés à être jet- ‘
tés en fonte ; la terre glaife deftinée à modeler
, exige toujours ces mêmes préparations.
Le petit modèle une fois arrêté, doit fervir
a prendre toutes les mefures dont le ftatuaire
aura befoin pour la confe&ion du grand modèle.
Il fe.fert, pour les prendre, d’équerres,
de règles, de compas, & d’échelles de réduction
qui font également appliquées fur le grand
& le petit modèle.
Quand le modèle excède la hauteur de cinq
ou fix pieds , ou même quand il approche de
cette proportion , on employé le plâtre préférablement
à toute autre matière. La terre glaife
dont les parties conftituantes font plus fines,
&,qui porte avec elle une onftuofité qui la rend
plus maniable, fembleroit, par ces avantages,
devoir conferver le droit d’être préférée : mais
elle pèche par fa réfiftance à conferver long-»
temps le même degré d’humidité : elle a encore
le défaut de s’affaifler & de fe lairter entraîner
par fon propre poids , quelque précaution
que l’on prenne pour la contenir; enfin
les parties qui fe font féchées avant que les
autres aient reçu lg derpière main, diminuent
de volume & ne le trouvent plus avec les
autres dans les juftes proportions qu’elles der
vroient avoir. Ces défavantages la font re-
jertër dans les grands ouvrages, quoique les
avantages précieux qui la diftinguent la fartent
préférer dans les morçeaux de petite 8c de
moyenne proportion.
Le plâtre n?a pas les mêmes inconvéniens. Il
fe durcit prefqu’aufli-tôt qu’ il a été employé ;
fes parties moins fubtiles ne fe refferrenc pas
comme celles de la terre g la ife , & ne perdent
pas fenfiblement la proDorcion qu’elles ont reçue
; elle acquiert une confiftance qui fe rapproche
de celle de la pierre, & l’on peut, à
l’aide de la gouge ou du cil’eau , lui faire
prendre toutes les formes qu’on veut lui donner.
Il faut que la terre glaife les reçoive
dans fon état d’humidité, 8c par conféquent
elle peut les perdre en partie, lorfqji’elle deviendra
folide : c’ efl dans fonérat de folidité que
le plâtre reçoit la perfeélion de fes formes, 8c
il les confervera toujours. La deftruélion feule
eft capable de l’en priver.
Mais comme il eft d’un grand poids, i l fe
tourmenteroit, fe léfarderoit & fortiroit de fon
à-plomb , fî l’on n’avoit pas la précaution de
lui préparer un appui. Cet appui eft de fer :
c’eft ce qu’on nomme une armature. Elle fa it,
pour le foutien du modèle, l’office du fque-
lette pour le foutien du corps vivant , &
comme elle en remplit la fonftion , elle doit
aufli en imiter la forme. On lent bien cependant
que la deftinacion de l armacure n’exige
pas que ce i te imita: ion loir parfaite, & que ce
fe o t fe piquer d’une ind .ftrie déplacée , que
de vouloir imiter en fqr la charpente du corps
humain ou celle d’urr cheval. La principale
pièce pour l ’armature d’ une ftatue équeftre
confifte en un gro» barreau de fer pofe horizontalement
au coeur du modèle , 8c prolongé
le long de l’encolure ju'qu’ à la place que
doit occuper la tête du cavalier. On y ajufte
une barre de fe r , deft née à maintenir la figure
du cavalier , 8c à lui fervir de noyau ; d’autres
branches descendent dans les quatre jambes 8c
dans la queue de l’animal. Le tout eftp.-fëfur
un pointai de fer placé au centre du modèle
& fous le ventre du cheval. Il eft fortifie dans
le bas par quatre morceaux de fer plat qui
font l’office, d’urc-boutans, & il eft lce!lé,ainfi
que les branches qui louriennent les jambes
& la queue du cheval , dans un maifif de
pierres de taille conftruit d’avance pour fervir
de bafe au modèle, & dont la longueur 8c la
largeur y font proporti mnés.
La deftirvarion meme de l’armature doit faire
fentir qu’ il eft efleniiel que tou:es ces pièces
fe trouvent au centre des parties qu’elles doivent
fortifier; fi elle-; éto enr voifines des en- .
droits que doivent attaquer les inftrumens de |
l’artifte , il rifqueroir de rencontrer du fer. I
ôinfi, quoique l’on compare l’armature au l'que- J
letto du corps, ce.te obfervation exclad une
îmi a ion trop par fa ne du fy dénie ofleuec.
On poi-rroit encore éprouver l’ inconvénient
de rencontrer du fer , même en s’éloignant de j.
cette imitation précife , fi l’on négligeoit de |
prendre d’avance une précaution indiipenl’able : 1
c’eft de défitner un trait de la figure dans fa
jufte proportion, 8c fuivant fes trois principaux
afpeêls.- Par ce moyen, on fait prendre aux
fers de l’ armature les coudes qu’ils doivent
décrire fuivant l’attitude du modèle. Ce delfin
fe fait ordinairement fur les murs de i’ateelier.
3. Du moule de plâtre , <5* comment les cires
y fo n t appliquées. La deftination du grand modèle
eft d’être modelé pour en avoir un creux.
Ce fera dans les pièces de ce creux que feronc-
appliquées des câres qui doivent repréfenter en
relief , avec toute la précifion de l’empreinte
d’un cache t, toutes les proportions 8c les formes
du modèle en plâtre. Une précaution préliminaire
eft de déterminer , fur le modèle
même , les places où pafieront , lorlcjue le
moule fera établi dans la folfe, les pointais &
les autres fers qui doivent le foutenir.
On parvient à donner à cette opération toute
la précifion qu’elle e x ig e , par le moyen d’un
petit modèle où tous les fers font arrangés
comme ils do vent l’être en grand. On fait un
relevé de ceux dont il importe de connoître la
proportion 8c la grofl’eur, & i’on marque fur le
grand modèle en plaire les points que ton.
doit avo:r. A tous les endroits où tombcnc
ces points, on trace au crayon des quarrés
dans une proportion convenable à la grofie.cr
des fers auxquels il s’agit.de ménager un paf-
fage. On applique enfuite, en dehors de tous
ces traits de crayon , de pethe» bandes de cire
en forme d f cadres, 8c l’on appuie dans cescadres
de pareilles bande» de cire en forme
de croix, donc les b anches 0atre-parte.1t un
peu les cadres. Elles portent des numéros particuliers,
afin que l’en pin fie rétro iver plu, ai-
Cément chaque pièce après la fonce, 8c les
mieux adap-er aux places qui leur appartiennent,
lorfqu’on fera parvenu a l’opération de réparer la
ftatue.
On trace au fil à la furface dumeftif de pierres
qui fert de bafe au grand modèle , un plan
exact dès pointais 8c des fers. Pour parvenir à
former ce plan , on prend les à-plombs des
cadres de cire dont nous venons de parler. S’ il
s’agit d’une ftatue équeftre, on y joint le p'an
des fers qui , dans le modèle, tra e^fenc les
jambes~&r la queue du cheval , 8c i’on reporte
ce plan , 'avec la plus grande précifion , fur une
table de planches d’ une étendue parfaitement
femblable à celle du mafiif de pierre, qui eft
conftruic au fond de la fofie où la fon e doit
s’opérer. On trace fur d’aucres table» ie-- hauteurs
auxquelles arrivent les différén. fers.
On établit enfuite dans l’artelier , & au pied
du modèle , un chaflis de grofies pièce de bois
de chêne , retenues enfemble à leur- extrémités*
par des boulons de ter qui entrent à vis
dans des écrcmx. Ce-chaifiseft deitine à rcce