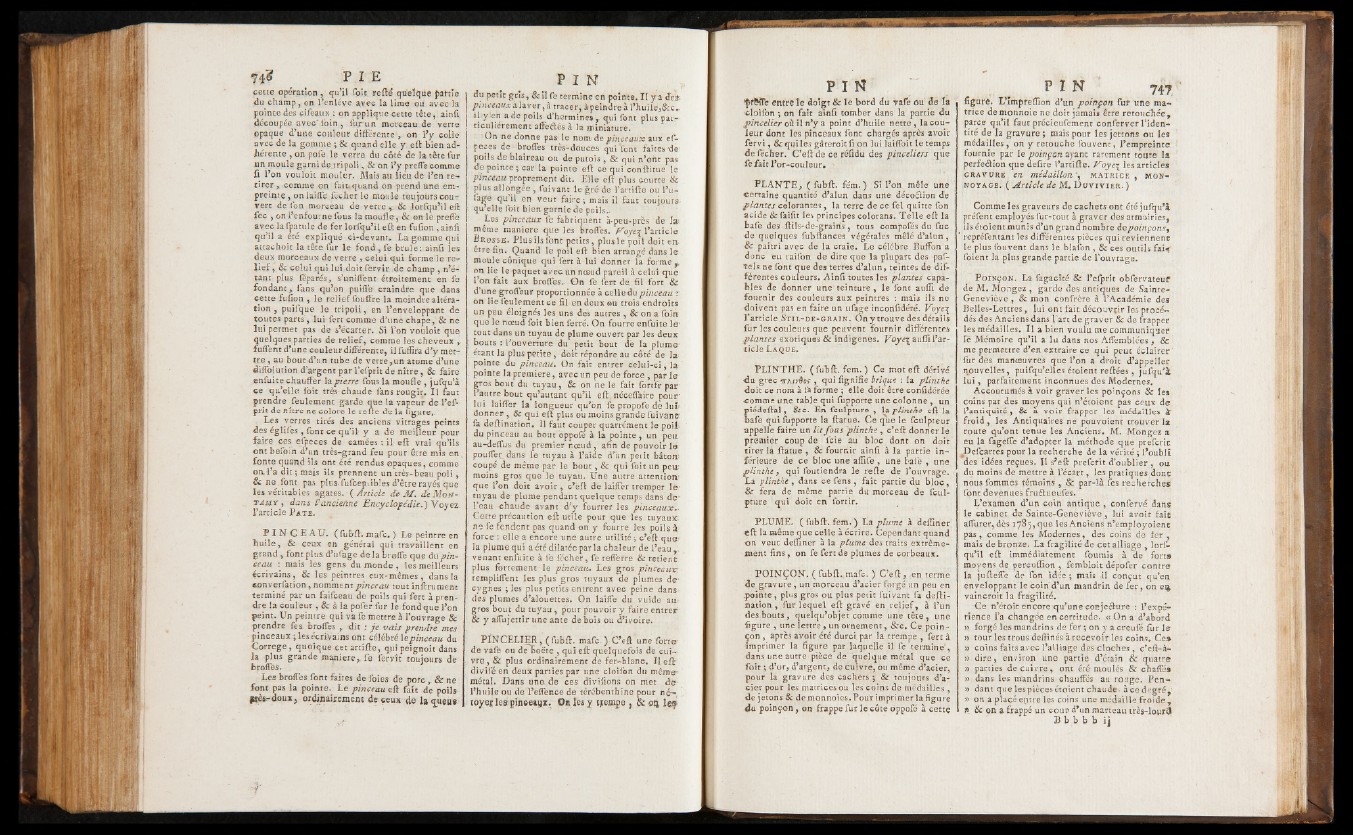
I
K
P I E
cette operation , qu’il foit refte quelque pahïè
du champ, on l’enléye avec la lime ou avec la
pointe des çifeaux : on applique cette tête,, ainfi
découpée avec'loin , fur'un morceau de verre
opaque d’une couleur différente , on l’y colle
avec de la gomme ; & quand elle, y.jeft bien adhérente
, on pofe le verre du côté de la tête fur
un moule garni de tripoli, & on l’y preffe comme
fi l’on voulôit mouler. Mais air lieu de l’en retirer
, comme on fait* quand ôn prend une empreinte
, on laiffe, fécher le moule toujours cour
vert de fon morceau de yerre.^ & lorfqu’ il eft
fec , on l’enfourne fous la moufle, & on le preffe
avec la fpatule de fer lorfqu’ il eft en fufion, ainfi
qu’il a été expliqué ci-devant. La gomme qui
attachoit la tête fur le fond , fe brûle: ainfi les
deux morceaux de verre , celui qui formelle relie
f , & celui qui lui doit, fervir de champ , n’ër
tant plus féparés, s’uniffent étroitement en fe
fondant * fans qu’on puifle craindre que dans
cette fufion , le relief fouffre la moindre altération
, puifque le tripoli, en l’enveloppant de
toutes parts, lui fert comme d’une chape, & ne
lui permet pas de s’écarter. Si l’on vouloit que
quelques parties de relief, comme les cheveux
fuffent d’une couleur différente, il fuffira d’y mettre
, au bout d’un tube de verre „un atome d’une
diffolution d’argent par l’efprit de nître, & faire
enfuite chauffer la pierre fous la moufle , jufqu’à
ce qu’elle foit très-chaude- fans rougir. I l faut
prendre feulement garde que la vapeur de l’ef-
prit de nître ne colore le refte de la figure,.
Les verres tirés des anciens vitrages peints
des églifes , font ce qu’i l y a de meilleur pour
faire ces efpeces de camées : il eft vrai qu’ils
ont beioin d’ un très-grand feu pour être mis en v
fonte quand ils ont été rendus opaques, comme
on. l’a dit ; mais Ms prennent un très-beau p o li,
& ne font pas plus- fufcep.âbles d’être rayés que
les véritables agates. ( Article de M . d e M o n -
t a m y , dans Vancienne Encyclopédie.) Voyez
l’article Pâte.
P I N C E ALT. (fubft. mafe,) Le peintre en
h u ile , & ceux en général qui travaillent en
grand , font plus d’ iifage delà broffe que à\xpinceau
: mais les gens du monde, les meilleurs
écrivains, & les peintres eux-mêmes , dans la
converfation, nomment pinceau tout inftrumem
termine par un faifeeau de poils qui fert à prendre
la couleur , & à la pofer fur le fond que l’ on
peint. Un peintre qui va fe mettre à l’ouvrage &
prendre fes. broffes dit : j e vais prendre mes
pinceaux ^les écrivains ont célébré \epinceau du
Correge, quoique cet artifte, qui peignoir dans
la plus grande maniéré., fe l’ervît toujours dé
broffes.
Les broffes font faites de foies de porc r & ne
font pas la pointe. Le pinceau eft fait de poils
Hèfr-ooux, ordinairement de ceux de la queue
p i n
du petit gris., & il fe termine en pointe. Il y a des:.
pinceaux à laver, à tracer, à peindre à l’ huilë,&c..
il-yen a de poils d’hermines,- qui font plus patr
ticuliérement affeélés à la miniature.
'On ne donne pas le nom. de pinceaux aux ef-
peses de broffes tres-douces qui font faites-de;
poils de blaireau ou de putois ,. & qui n’oht pas
de pointe ; car ia pointe eft ce qui conftitue le
pinceau proprement dit. Elle eft plus courte &
plus allongée, (uivant le gré de l’artifte ou l’u-
fage qu’il en veut faire; mais il faut toujours
qu’ elle foit bien garnie de poils..
Les pinceaux fe fabriquent à-peu-près de la;
même maniéré que les broffes. Voye\- l’article
Brosse. Plus ils font petits, plus le poil doit en
etre fin. Quand le poil eft bien arrangé dans le
moule cônique qui fert à lui donner la forme y,
on lie le paquet avec un noeud pareil à celui que
l’on fait aux broffes. On fe fert de fil fort &
d’une groffeur proportionnée à celle du pinceau v
on lie feulement ce fil en deux où trois endroits
un peu éloignés les uns des autres , & on a foin
que le noeud foit bien ferré. On fourre enfuite le ’
tout dans un tuyau de plume ouvert par les deux
. bouts : l’ouverture du petit bout dè la plume-
. étant la plus petite, doit répondre au côté de la
pointe du pinceau. On fait entrer c e lui-c i, la
pointe la première, avec un peu de force , parle
gros bout du tuyau, & on ne le fait fortfr par
l’autre bout qu’àutant qu’ il eft. néceffaire pour
lui laiffer la longueur qu’on fe propofe de Iur
donner, & qui eft plus ou moins grande fuivanr
fa deftination. Il faut couper quarrément le poil
du pinceau au bout oppofé à la pointe , un peu.
au-deffus du premier noeud , afin de pouvoir le
pouffer dans le tuyau à l’aide d’ un petit bâton-
coupé de même par le b out, & qui foit un peu;
moins gros que le tuyau. Une autre attention1
que l’on doit a v o ir , c’ëft de laiffer tremper le -
tuyau de plume pendant quelque temps dans dé*
l ’eau chaude avant d’y fourrer les pinceaux.-
Cette précaution eft utile pour que les tuyaux;
ne fe fendent pas quand on y fourre les poils à
force : elle a encore une autre utilité; c’eft que
la plume qui a été dilatée par la chaleur de l’eau
venant enfuite à fe fécher, fe refferre & retient;
plus fortement le pinceau. Les gros pinceaux-
rempliffent les plus gros tuyaux de plumes dé-
cygnes ; les plus petits entrent avec peine dans
des plumes d’alouettes. On laiffe du vuide au
gros bout du tuyau, pour pouvoir y faire entrer
& y affujettir une ante de bois ou d’ iyoire.
PINCELIER, (fubft. mafe.) C’eft une forte
de vafe ou de boëte , qui eft quelquefois de cuiv
ré , & plus ordinairement dè fer-blanc. Il eft
divifé en deux parties par une cloifon du même*
métal. Dans une. de ces divifions on met dé
l’huile ou de l’ effence de térébenthine pour né-,
toyeslespineeiax. On les y trempe , & ©ij leç
p I N $rëHTe entre le doigt & le bord du vafe du de la
cloifon ; on fait ainfi tomber dans la partie du
pincelier où il n’y a point d’huile nette , la couleur
dont les pinceaux font chargés après avoir
fe r v i, & qui les gâteroitfion lui laiffoit le temps
de fécher. C ’eft de ce réfidu des pinceliers que
ie fait l’or-couleur« s
P L A N T E , ( fubft. fém. ) Si l’on mêle une
certaine quantité d’alun dans une déçoélion de
plantes colorantes, la terre de ce fel quitte fon
acide &faifit les principes colorans. T e lle eft la
bafè des ftils-de-grains , tous compofés du fuc
de quelques fubftances végétales mêlé d’alun ,
& paitri avec de la craie. Le célébré Buffon a
donc eu raifon de dire que la plupart des paf-
Tels ne font que des terres d’alun, teintes de différentes
couleurs. Ainfi toutes les plantes capables
de donner une teinture, le font aulfi dé
fournir des couleurs aux peintres : mais ils ne
doivent pas en faire un ufage incorifidéré. Voye\
Particle St il -de-grain. On y trouve des détails
fur les couleurs que peuvent fournir différentes
plantes exotiques & indigènes. Voyez auflil’article
L aque,
PLINTHE. ( fubft. fem. ) Ce mot eft dérivé
«du grec T/urêor , qui lignifie brique : la plinthe
«lait ce nom à fa forme ; elle doit être confidérée
•comme une table qui fupporte une colonne un
piédeftal, & c. En fculpture , la plinthe eft la
bafe qui fupporte la ftatue. Ce que le fculpteur
appelle faire un lit fous plinthe , c’eft donner le
premier coup de feie au bloc dont on doit
tirer là ftatue , & fournir ainfi à la partie inférieure
de ce bloc une aflife , une bafe , une
plinthe, qui foutiendra le refte de l’ouvrage.
La pliritliè , dans ce fens , fait partie du b lo c ,
& fera de même partie diï morceau de fculpture
/ q u i doit en for tir.
PLUME. ( fubft. fem. ) La plume à delïiner
tîft la même que celle à écrire. Cependant quand
on veut deffiner à la plumé des traits extrêmement
fins, on fe fert de plumés de corbeaux.
POINÇON. ( fubft.(mafc. ) C ’eft , .en terme 3 e gravure, un morceau d’acier forgé un peu en
pointe, plus gros pu plus petit fuivant fa destination
, fur lequel eft gravé en relief, à l’un
des bouts, quelqu’objet comme une tête , une
figure , une lettre, un ornement ,& c . Ce poinçon
, après avoir été durci par la trempé , fert à
Imprimer la figure par laquelle il fe termine’ ,
dans line autre pièce de quelque métal que ce
foit ; d’or, d’ argent, de cuivre, ou même d’acier,
pour la gravure des cachets ; & toujours d’acier
pour les matrices ou les coins de médailles ,
de jetons & de monnoies. Pour imprimer la figure
du poinçon, on frappe fur le côte oppofé à cette
P I N 747
figure. L’împreflion d’un poinçon fur une matrice
demonnoie ne doit jamais être retouchée ,
parce qu’il faut précieufement conferver l’identité
de la gravure ; mais pour les jettons ou les
médailles, on y retouche fouvent, l’ empreinte
fournie par le poinçon ayant rarement toute la
perfection que defire l’artifte. Voye\ les articles
gr a vu r e en médaillon“, ma tr i c e , mo n-
n o y a g e . ( Article de M. D u v i v i e r . )
Comme les graveurs de cachets ont été jufqu’à
préfent employés fur-tout à graver des armoiries,
ils étoient munis d’ un grand nombre depoinçons9
repréfentant les differentes pièces qui reviennenc
le plus fouvent dans le blafon , & ces outils fai*
foient la plus grande partie de l’ouvrage.
P oin çon. La fagaeîté & l’efprit obfervateuf
de M. Mongez , garde des antiques de Sainte-
Geneviève , & mon confrère à l’Académie des
Belles-Lettres , lui ont fait découvrir les procédés
des Anciens dans l'art de graver & de frapper
les médailles. Il a bien voulu me communiquer
Lé Mémoire qu’ il a lu dans nos Affemblées , &
me permettre d’ en extraire ce qui peut éclairer
fur des manoeuvres que l’on a droit d’appeller
nouvelles, puifqu’elles étoient reliées , jufqu’à
lu i , parfaitement inconnues des Modernes.
Accouturtiés à voir graver les poinçons & les
coins par des moyens qui n’étoient pas ceux de
l’antiquité , & à voir frapper les médailles à
froid , les Antiquaires ne pouvoient trouver la
route qu’ont tenue, les Anciens. M. Mongez a
eu la fageffe d’adopter la méthode que preferit
#Defcartes pour la recherche de la vérité ; l’oubli
des idées reçues. Il s’ eft preferit d’oublier , ou
du moins de mettre à l’écart, les pratiques dont
nous fommes témoins , & par-là (es recherches
font devenues fru&ueufes.
L’ examen d’ un coin antique , confervé dans
le cabinet de Sainte-Geneviève, lui avoit fait
affurer, dès 1785, que les Anciens n’empJoyoienc
pas, comme les Modernes, des coins de fer ,
mais de bronze. La fragilité de cet alliage , lo r fqu’
il eft immédiatement fournis à de forts
moyens de pereuflion , fembloit dépofer contre
la jufteffe de fon idée; mais il conçut qu’en
enveloppant le coin d’ un mandrin de fe r , on e$
vaincroit la fragilité.
Ce n’étoit encore qu’ une coi?jeélurè : l’expérience
l’a changée en certitude. « On a d’abord
» forgé les mandrins de fer ; on y a creufé for le
» tour les trous deftinés à recevoir les coins. Ces
» coins faits avec l’alliage des cloches , c ’eft-à-
» dire, environ une partie d’étain & quatre
» parties de cu iv re , ont été moulés & chaffés
» dans les mandrins chauffés au rouge. Pen-
» dant que les pièces étoient chaude' à ce degré,'
» on a placé entre les coins une médaille froid e,
£ & on a frappé un coup d’ un marteau très-lourd
B b b b b i j