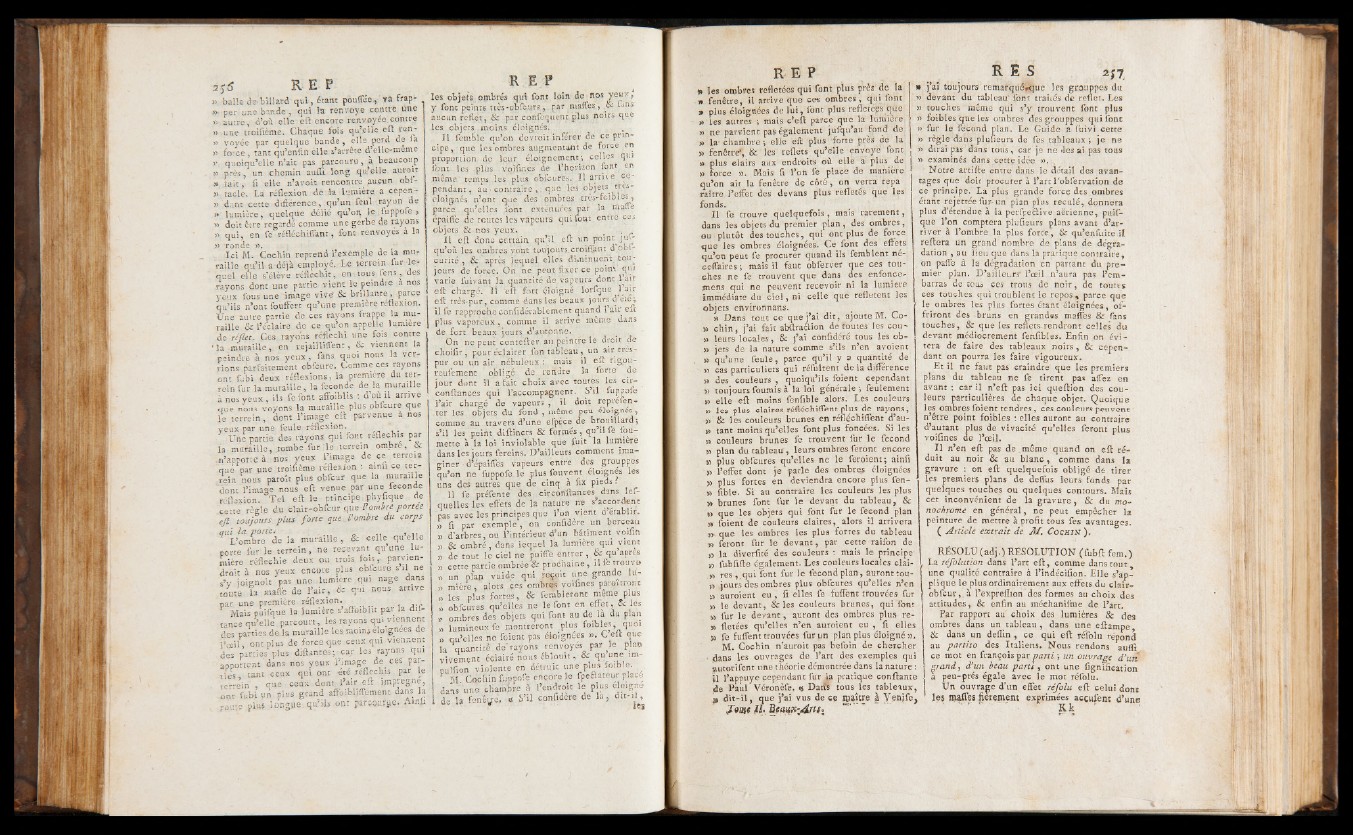
*5* R E P
» balle de-billard q u i, étant pôuffée., va frapf ,
»> per une bande , qui la- renvoyé contre üne
» autre, d’où elle eft encore renvoyée contre
».une troifième. Chaque fois qu’e lle eft reiv*
» voyée par quelque bande, elle perd de la
» force , tant qu’enfin elle s’arrête d’ elle-meme
y quoiqu’ elle n’ait pas parcouru,..a beaucoup
» près, un chemin aufli- long qu’ elle auroit
» ta it , fi elle n’avoit rencontre aucun obt-
» racle. La réflexion dé la lumière a cepen-
» dunt cette différence, qu’ un Lcu'l rayon de
» lumière, quoique délié qu’oq leTuppole,
» doit être regardé comme une gerbe de rayons
» qui, en ré réfléchiffant, font renvoyés à la
» -ronde ». .> } - - • ~-
Ic i M. Cochin reprend l’exemple de la mur
raille qu’ il a déjà employé. Le verrein.fur 1er
quel elle s’élève réfléchit, en tous rens, des
rayons dont une partie vient-le peindre à nos
yeux icus une image vive' & brillante, parce
qu’ ils n’ont foùffert qu’une première réflexion.
Une autre partie de ces rayons frappe la muraille
& l’éclaire de ce qu’on appelle lumière
de reflet. Gcs. rayons réfléchi une fois contre
■ la muraille, en rejailliffent, & viennent la
peindre à nos y e u x , fans quoi nous la verrions
parfaitement obfcure. Comme ces rayons
ont fubi deux réflexions, la première du ter-
rein fur la.muraille, la fécondé de la muraille
à nos y e u x , ils fe font affoiblis -. d’ où il arrive
uue nous voyons, la muraille plus obfcure que
le terrein, dont l’image eft parvenue a nos
y e u x par une feule: réflexion. -
LT ne partie, des rayons qui font réfléchis par
la muraille, tombe fur le terrein ombre, &
m’apporte à., nos yeux l’ image de ce terreia
que par une troifième réflexion : ainlt ce terrein
nous paraît plus obfcur que la muraille
"dont l’image nous eft venue par une fécondé
réflexion. T e l eft. le principe ,.phÿfique de
.cette règle du clair-obfcur que P ombre portez
ejl toujours plus, forte que J ombre du corps
qui la porteî ■ , ,,
L’ombre de la muraille.,, & celle qu elle
porte fur le terrein, ne recevant qu une lumière
réfléchie .deux ou trois fois,, parviendrait
à nos yeux encore plus obfcure s il ne
s’v ioignoit pas une lumière.qui nage dans
toute la malle de l’a ir , & qui nous; arrive
nat une première réflexion. _
* Mais puifque la lumière s’affoiblit par la dif-
tance qu’elle parcourt, les rayons qui viennent
des parties d éjà muraille les moins éloignées de
l ’oeil, ont plus de force que ceux qui viennent
des parties plus diftantes; car les rayons qui
armorient'dans nos yeux l ’ image de ces part
ie s , tant ceux qui ont été réfléchis par Je
terrein , que ceux dont, l ’air eft imprégné.,
ont fubi un. plus grand affoibljffement dans la
ponte plus, longue, qu’ ils ont parcourue. Ainfl
R E P
les objets ombrés qui font loin de nos y eu x ,
y font peints ttcs-Qbfoyrs. par màffes.', ,& Caris
aucun reflet, & par conséquent plus noirs que
les objets . moins éloignés; , .
I l femble qu’ on devroit inférer de ce principe,
que les ombres augmentant de force en
proportion de leur éloignexnent-, celles qui
font les .plus voifines de . i’hçrizon font en
même temps les plus obfcures. Il arriye c e pendant
, au • contraire que lés objets .três-
eloignés n’ont que " dès pmbref .itrôs-fcibles ,
parce; qu’elles font exténuées par la hiaue
épâiffe de toutes les vapeurs qui font entre .ces
objets &• nas yeux» . • r
I l eft donc certain qu’ il eft un point^juf-
qu’où les ombres yont toujours, croifïjint d.obf-
curité , & après lequel elles diminuent: toujours
de force. On ne peut fixer ce point qui
varie luivant la quantité de vapeurs dont 1 air
eft chargé. l i eft fort çloignëTorfque Pair
eft très-pur, comme dans les beaux jours d’été;
il fe rapproche confidérablement quand 1 air eft
plus vaporeux, comme il arrive meme dans
de fort beaux jours d’autpntve.
On ne peut conteftèr au peintre le droit de
choifir, pour éclairer fon tableau, un air très-
pur ou un air nébuleux :. mais il eft ngmt-
reufement obligé de . .i'etidre la forte de
jour dont il a fait choix avec toutes les çtr-
conftances qui raccompagnent. S’ il fuppofe
l’air chargé de vapeurs , il doit repréfen-
ter les. objets du fond , même peu éloignés ,
comme au travers d’ une efp|ce de brouillard;
s’il les peint diftincts & formés, qu’ il fe fou-
mette à la loi inviolable que fuit la lumière
dans les jours fereins. D’ailleurs comment imaginer
• d’épaiffes vapeurs entré des grouppes
qu’on ne fuppofe. le plus fouvent .éloignes les
uns des autres que de cinq à fix pieds .
11 fe prérente des. circonftances dans lesquelles
les effets de Ja nature ne s’accordent
pas avec les principes que l ’on vient d établir.
» fi par exemple, on confidere un berceau
» d’arbres, ou l’ intérieur d’ un bâtiment voifiti
» & ombré, dans lequel.la lumière qui vient
» de tout le ciel ne puiffe entrer , & qu apres
» cette partie ombrée & prochaine, il fe trouve
n un plan vuide qui reçoit une grande lu-
» mière , alors ces" ombres voifines paroi tronc
» les plus fortes, & femblëront même plus
» obfcures qu’elles ne le font en effet, &: les
ombres des objets qui font au de là du plan
» lumineux fe montreront plus foibles, quoi
» qu’elles ne foient pas éloignées ». C elt que
la quantité de rayons renvoyés par le plan
vivement éclairé nous éblouit, & q ftdn| im-
oulfion violente en détruit une plus foible. ,./
V M C.Qchin fuppofe encore Je fpeéiateur place
dans une chambre à l’endroit le plus éloigné
de la fenéyrc. « S’il confidere de la , djt-iJ,
R E P
» les ombres reflétées qui font plus près de la
* fenêtre, il arrive que ces ombres, qui font
» plus éloignées de lu i, font plus refletéps tjüe
» les autres ; mais c’eft parce que la lumière,
» ne parvient pas également jufqu’ au fpnd de
» la1 chambre ; elle eft plus fforte près de la
» fenêtre1', & les reflets qu’ elle envoyé' fontj
» plus elairs aux endroits où elle a plus^ de^ ,
» force ». Mais fi l’on fe placé de manière
qu’on ait la fenêtre de cô té , on verra repa
raître l ’effet des de vans plus reflétés que les
fonds.
Il fe trouve quelquefois, mais rarement,
dans les objets du premier plan, des ombres,
eu plutôt des touches, qui ont plus de force,
que les ombres éloignées. Ce font des effets
qu’on peut fe procurer quand ils femblent né-,
ceffaires ; mais il faut obferver que ces touches
ne fe trouvent que dans des enfonce-
mens qui ne peuvent recevoir ni la lumière
immédiate du c ie l , ni celle que reflètent les
objets environnans.
» Dans tout ce que j’ ai dit, ajoute M. Co-
» chin, j’ ai fait abftraétion de toutes les cou-
» leurs locales, & }’ai confidere tous les ob-
» jets de la nature comme s’ ils n’ en avoient
» qu’ une feule, parce qu’ il y a quantité de
s » cas particuliers qui réfultent de la différence
>» des couleurs , quoiqu’ ils foient cependant
» toujours fournis à la loi generale ; feulement
» elle eft moins fenfible alors. Les couleurs
» les plus claires réfléchiffent plus de rayons,
» & les couleurs brunes en réfléchiffent d’au-
» tant moins qu’elles font plus foncées. Si les
» couleurs brunes fc trouvent fur le fécond
» plan du tableau , leurs ombres feront encore
» plus obfcures qu’elles ne le feroient; ainfi
» l’effet dont je parle des ombres éloignées
plus fortes en deviendra encore plus fen-
» fible. Si au contraire, les couleurs les plus
» brunes font fur le devant du tableau, &
» que les objets qui font fur le fécond plan
» foient de couleurs claires, alors il arrivera
»> que les ombres les plus fortes du tableau
» feront fur le devant, par cette raifon de
» la diverfité des couleurs : mais le principe
j? fubfifte également. Les couleurs locales clai-
» res , oui font fur le fécond plan, aurontcou-
w jours des ombres plus obfcures qu’elles n’en
» auroient e u , fi elles fe fuffent trouvées fur
» le devant, & les couleurs brunes, qui font
» fur le devant, auront des ombres plus re-
» fletées qu’elles n’en auroient eu , fi elles
» fe fuffent trouvées fur un plan plus éloigné ».
M. Cochin n’auroit pas befoin de chercher
■ (dans les ouvrages de l’arc des exemples qui
^utorifent une théorie démontrée dans la nature :
si l’ap.puye pep,endant fur la pratique confiante
.de Paul Véronèfe. Daire tous les tableaux,
p d i t - i l, que j’ai vus de ce à Venjfe , Jqw€ IL Bçaux-drtSi
R E S 2j7
» j’ai toujours'.rèmarquéfque les grouppes du
» devant du tableau* font traités de reflet. Les
» touches même qui s’y trouvent font plus
» foibles que les ombres des grouppes qui font
» fur le fécond plan. Le Guide a fuivi cette
» règle dans plulieurs de Ces tableaux ; je ne
» dirai pas'dans tous, car je ne des ai pas tous
» examinés dans cette idée ». ,
Notre artifte entre dans le détail des avantages
que doic procurer à l’art l'oblèrvation de
ce principe. La plus grande force des ombres
étant rejettée fin- un pian plus reculé, donnera
plus d’étendue à la perfpeétive aérienne, puifque
l’on comptera plufieurs plans avant d’arriver
à l ’ombre la plus forte, & qu’en fuite il
reliera un grand nombre de plans de dégradation
, au lieu que dans la pratique contraire,
on paffe à la dégradation en partant du premier
plan. D ’aiileur? l’oeil n’aura pas l’embarras
de tous ces trous de n oir , de toutes
ces touches, qui troublent le repos, parce que
le ombres les plus fortes étant éloignées, o f friront
des -bruns en grandes maffes & fans
touches, & que les reflets^rendront celles du
devant médiocrement fenfibles. Enfin on évitera
dé faire des tableaux noirs, & cependant
on pourra les faire vigoureux.
Et il ne faut pas craindre que les premiers
plans du tableau ne fe tirent pas affez en
avant : car il n’eft pas ici queftion des couleurs
particulières de chaque objet. Quoique
les ombres foient tendres, ces couleurs peuvent '
n’être point foibles : elles auront au contraire
d’autant plus de vivacité qu’elles feront plus
voifines de l’oeil.
I l n’en eft pas de .même quand on eft réduit
au noir & au b lan c , comme dans la
gravure : on eft quelquefois obligé de tirer
les premiers plans de deffus leurs fonds par
quelques touches ou quelques contours. Mais
cet inconvénient de la gravure, & du m<?-
nochrome en général, ne peut empêcher la
peinture de mettre à profit tous fes avantages.
( Article extrait de M , Co c h in ).
RÉSOLU(adj.) RÉSOLUTION (fubft fem.)
La réfolution dans l ’art e ft , comme dans tout
une qualité contraire à l’ indécifion. Elle s’applique
le plus ordinairement aux effets du clair*
obfcur,. à l’ exprefiion des formes au choix des
attitudes, & enfin au méchanifme de l ’ art.
Par rapport au choix des lumières & des
ombres dans un tableau, dans une eftampe,
& dans un deflin , ce qui eft réîolu répond
au partito des Italiens. Nous rendons aullî
ce mot en françois par parti ; un ouvrage d’utt
grand, d’un beau p a r t i, ont une lignification
à peu-prés égale avec le mot réfolu.
Un ouvrage d’un effet réfolu eft celui dont
le$ maffes fièrement exprimées aeçufent d’une
f ■ r. ■ — ■ Kfe