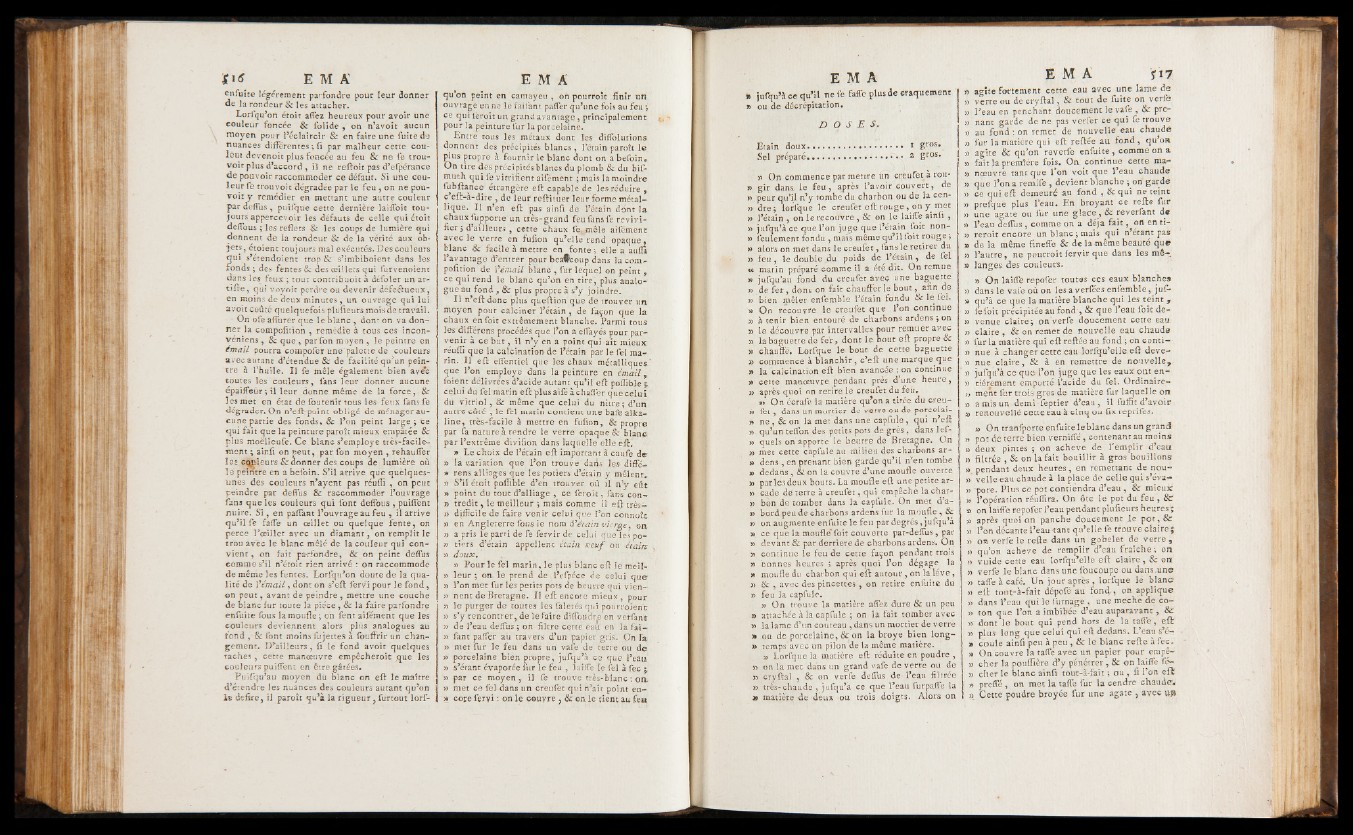
enfuite légèrement parfondre pour leur donner
àe la rondeur & les attacher.
Lorfqu’on étoit aflez heureux pour avoir une
couleur foncée & folide , on n’avoit aucun
moyen pour l ’éclaircir & en faire une fuite ds
nuances differentes -, fi par malheur cette cou-
leui devenoit plus foncée au feu & ne fe trou-
voit plus d’accord , il ne reftoit pas d’efpérance
«e pouvoir raccommoder ce défaut. Si une couleur
fe trou voit dégradée par le feu , on ne pouvoir
y remédier en mettant une autre couleur
par deflus , puifque cette dernière laifloit toujours
appercevoir les défauts de celle qui étoit
deflous ; les reflets & les coups de lumière qui
donnent de la rondeur & de la vérité aux objets
, étoient toujours mal exécutés. Des couleurs
qui s’érendoient trop & s’ imbiboîent dans les
fonds ; des fentes & des oeillets qui furvenoient
dans les feux ; tout contribuoit à défoler un ar-
t ilte , qui voyoic perdre ou devenir défe&ueux,
en moins de deux minutes , un ouvrage qui lui
avoir coûté quelquefois pîufieurs mois de travail.
On ofe affurer que le blanc , dont on va donner
la compofition , remédie à tous ces incon-
véniens , & que , par fon moyen , le peintre en
émail pourra compoler une palette de couleurs
avec autant d’étendue & de facilité qu’ un peintre
à l’huile. Il fe mêle également bien avec
toutes les couleurs, fans leur donner aucune
épalfleûr ; il leur donne même de la force, &
Jes met en état de fouteriir tous les feux fansfe
dégrader. On n’eft'point obligé de ménager aucune
partie des fonds, & l’on peint la rge; te
qui fait que la peinture paroît mieux empâtée &
plus moëlleufe. Ce blanc s’employe trèfc-facile“
ment ; ainfi on peut, par fon moyen , rehaufler
les copieurs & donner des coups de lumière où
le pèintre en a befoin. S’ il arrive que quèlques-
unes des couleurs n’ayent pas réufli , on peut
peindre par deflus & raccommoder l’ouvrage
fans que les couleurs qui font deflbus , puiflent
nuire. S i , en paflant l’ouvrage au feu , il arrive
qu’ il fe fafle un oeillet ou quelque fente, on
perce l ’oeillet avec un diamant, on remplit le
trou avec le blanc mêlé de la couleur qui conv
ien t , on fait parfondre, & on peint deflus
comme s’ il n’étoit rien arrivé : on raccommodé
de même les fentes. Lorfqu’on doute de la qualité
de Vémail, dont on s’eft fervi pour le fond,
en peut, avant de peindre , mettre une couche
de blanc fur toute la pièce , & la faire parfondre
enfuite fous la moufle; on fent aifément que les
couleurs deviennent alors plus analogues au
fond , & font moinsSujettes à fouffrir un changement.
D’ailleurs, fi le fond avoit quelques
taches, cette manoeuvre empêcheroit ^jue les
couleurs puiflent en être gâtées.
Puifqu’au moyen du blanc on eft le maître
d’étendre les nuances des couleurs autant qu’on
1« defire, il paroît qu’à la rigueur, furtout lorfqu
on peint en camayeu , oh pourroit finir lin
ouvrage en ne le faifant pafler qu’une fois au feu ;
ce qui lèroit un grand avantage, principalement
pour la peinture fur la porcelaine.
Entre tous les métaux dont les diflolutions
donnent des précipités blancs, l’étain paroît le
plus propre à fournir le blanc dont on a befoin.
On tire des précipités blancs du plomb & du bif-
muth qui fe vitrifient aifément ; mais la moindre
fubftance étrangère eft capable de les-réduire ,
c’eft-à-dire , de leur reftituer leur forme métallique.
Il n’ en eft pas ainfi de l’étain dont la
chaux fupporte un très-grand feu fansfe revivifier
; d’ailleurs , cette chaux fe, mêle aifément
avec le verre en fufion qu’ elle rend opaque,
blanc & facile à mettre en fonte ; elle a aufix
l’avantage d’entrer pour beaucoup dans la compofition
de l’émail blanc , fur lequel on peint,
ce qui rend le blanc qu’on en tire, plus analogue
au fond , & plus propre à s’y joindre.
Il n’eft donc plus queftion que de trouver un
moyen pour calciner l’étàin , de façon que la
chaux en foit extrêmement blanche. Parmi tous
les différons procédés que l’on a effayés pour parvenir
à ce b ut, il n’y en a point qui ait mieux
réufli que la calcination de l’étain par le fel marin.
Il eft eflèntiel que les chaux métalliques’
que l’on employé dans la peinture en émail r
foient délivrées d’acide autant qu’ il eft poflibie»
celui du fel marin èft'plusaifé àchaflèr que celui
du v itr iol, & même que celui du niti;e; d’un
autre côté , le fel marin contient une bafe allta-
line, très-facile à mettre en fufion, & propre
par fa nature.à rendre le verre opaque & blanc
par l’extrême divifion dans laquelle elle eft.
» Le choix de l’étain eft important à caufe de
» la variation que l’on trouve daûs les diffe-
» rens alliages que les potiers d’étain y mêlent»
» S’ il étoit poffible d’en trouver où il n’y eût
» point du tout d’alliage , ce feroit, fans con-
» tredit, le meilleur ; mais comme il eft très-
» difficile de faire venir celui que l’on connoît
» en Angleterre fous le nom d’étain vierge, on
» a pris le parti de fe fervir de celui que les po-
» tiers d’étain appellent étain neuf ou étain
» doux.
» Pour le fel marin, le plus blanc eft le meil-
» leur ; on. le prend de l’efpéce de celui que1
» l’on met fur les petits pots de beurre qui vien-
» nent de Bretagne. Il eft encore mieux, pour
» le purger de toutes les faletés qui pourroieritr
» s’y rencontrer, de le faire diflbüdre en verfant
» de l’eau deflus ; on filtre cette eau en la fai-
» fiant pafler au travers d’un papier gris. On la
» met fur le feu dans un vafe de terre ou de
» porcelaine bien propre, jufqu’à ce que l’eau
» s’étant évaporée fur le feu , laifle le fel à fec ;
» par ce moyen, il fe trouve très-blanc : on.
» met ce fel dans un creufet qui n’ait point en-
» core feryi : on le couvre , & on le tient au fe»
» jufqu’à ce qu’ il ne fe faffe plus de craquement
» ou de décrépitation.
D O S E S , .
Etain doux.................... .. i gros.
Sel préparé« ..................... a gros.
» On commence par mettre (in cr|èufetwà rou-
» gir dans, le feu, après l’avoir couvert, de
» peur qu’il n’y tombe du charbon ou de la cen-
» dre ; lorfque le creufet eft rouge , on y met
» l’étain , on le recouvre , & on le laifle ainfi ,
» jufqu’à ce que l’on- juge que l’etain foit non-
» feulement fondu , mais même qu’ il foit rouge ;
» alors on met dans le creufet, fans le retirer du
» fe u , le double du poids de l ’etain, de fel
'<c marin préparé comme il a été dit. On remue
» jufqu’au fond du creufet aveç une baguette
» de fe r , dont on fait chaufferie bout, afin de
» bien niêler enfemble l’étain fondu & le fel.
» On recouvre le creufet que l’on continue
>5 à tenir bien entouré de charbons ardens ;on
» le découvre par intervalles pour remuer avec
» la baguette de fer 9 dont le Dout eft propre &
» chauffe. Lorfque le bout de cette baguette
» commence à blanchir, c’eft une marque que
» la calcination eft bien avancée : on continue
» cette manoeuvre pendant près d une heure,
» après quoi on retire, lé creufet du feti.
»> On écrafe la matière qu’on a tirée du creu-
» fe t , dans un mortier de verre ou de porcelai- i
» ne , & on la mer dans une cap.fule, qui n’eft
» qu’ un teflon des petits pots de grès , dans lef-
» quels on apporte le beurre de Bretagne. On
» met cette capfule au milieu des charbons ar-
» dens , en prenant bien garde qu’ il nyen tombe
» dedans , & on la couvre d’une moufle ouverte
» parles deux bouts. La moufle eft une petite ar-
» cade de terre à creufet, qui empêche la char-
» bon de tomber dans la capfule. On met d’a-
» bord peu de charbons ardens fur la moufle , &
» on augmente enfuite le feu par degrés, jufqu’à
» ce que la moufle*foit couverte par-deflus, par
» devant & par derrière de charbons ardens. On
» continue le feu de cette façon pendant trois
» bonnes heures ; après quoi l’ on dégage la
» moufle du charbon qui eft autour, on la lè v e ,
» & , avec des pincettes , on retire enfuite du
» feu la capfule.
» On trouve la matière aflez dure & un peu
» attachée à la capfule ; on la fait tomber avec
» la lame d’ un couteau , dans un mortier de verre j
» ou de porcelaine, & on la broyé bien long-*-
» temps avec un pilon de la même matière.
» Lorfque la matière eft réduite en poudre ,
» on la met dans un grand vafe de verre ou de
t> cryftal , & on verfe deflus de l’eau filtrée
» très-chaude , jufqu’à ce que l ’eau furpafle la
» matière de deux ou trois doigts. Alors on
9) agite fortement cette eau avec une lame de
» verre ou de c ry ftal, & tout de fuite on verfe
» l ’eau en penchant doucement le vafe , & pre-
» nant garde de ne pas verfer ce qui fe trouve
» au fond : on remet de nouvelle eau chaudé
» fur la matière qui eft reftée au fond, qu on
» agite & qu’on reverfe enfuite, comme on a
» fait fa première fois. On continue cette ma-
» noeuvre tant que l’on voit que l’ eau chaude
» que l ’on a remife , devient blanche ; ori garde
» ce qui eft demeuré au fond , & qui ne teint
» prefquè plus l’eau. En broyant ce refte fur
» une agate ou fur une g la c e , & reverfant d®
» l’eau deflus , comme on a déjà fa it , on en ti-
» reroit encore un blanc;mais qui n’étant pas
» de la même finefle & de la même beauté que
» l’autre, ne pourroit fervir que dans les mê-
» langes des couleurs.
» On laiffe repofer toutes ces eaux blanches
» dans le vafe où on lésa verfées enfemble, juf*
» qu’à ce que la matière blanche qui les teint ,
»> fefoit précipitée au fond , & que l’eau foit de-
» venue claire; çm'verfe doucement cette eau
» claire , & on remet de nouvelle eau chaude
» fur la matière qui eft reftée au fond; on conti-
» nue à changer cette eau lorfqu’elle.eft deve-
» nue claire, & à en remettre de nouvelle,
» jufqu’à ce que l’on juge que les eaux ont en-
» tiéremenc emporté l’acide du fel. Ordinaire-
,, ment fur trois gros de matière fur laquelle on
» a mis un demi-feptier d’eau, il fuflit d’avoir
x> renouvelle cette eau à cinq ou fix reprifes.
» On tranfporte enfuiteleblanc dans un grand
» pot de terre bien verniffe, contenant au moins
» deux pintes ; on achevé de Tèmplir d’eau
» filtrée , & on la fait bouillir à gros bouillons
» pendant deux heures, en remettant de nou-
» velle eau chaude à la place de celle qui s’éva-
» pore. Plus ce pot contiendra d’ eau, & mieux
» l’opération réuflira. On ôte le pot du feu , 8c
» on laifle repofer l’eau pendant pîufieurs heures;
» après quoi on panche doucement .le p ot, &
» l’ on décante l’eau tant qu’elle fe trouve claire;
» on verfe le refte dans un gobelet de verre ,
» qu’on achevé de remplir d’ eau fraîche ; on
i » vuide cette eau lorfqu’elle eft c la ire , & on
! » verfe le blanc dans une foucoupe ou dans .une
» tafieàcafé. Un jour après , lorfque iè blanc
» eft tout-à-fait dépofé au fond/, on applique
» dans l’eau qui le furnage , une meche de co-
» ton que l’on a imbibée d’eau auparavant, &
dont le bout qui pend hors de la tafle, eft
» plus long que celui qui eft dedans. L’ eau s’é-
» coule ainfi peu à peu , & le blanc refte à fec.
» On couvre la tafle avec un papier pour empê-
» cher la pouflière d’y pénétrer, & on laifle fié-
» chef le blanc ainfi tout-à-fait ; ou , fi l’on eft
» prefle , on met la tafle fur la cendre chaude*
» Cette poudre broyée fur une agate , avec up