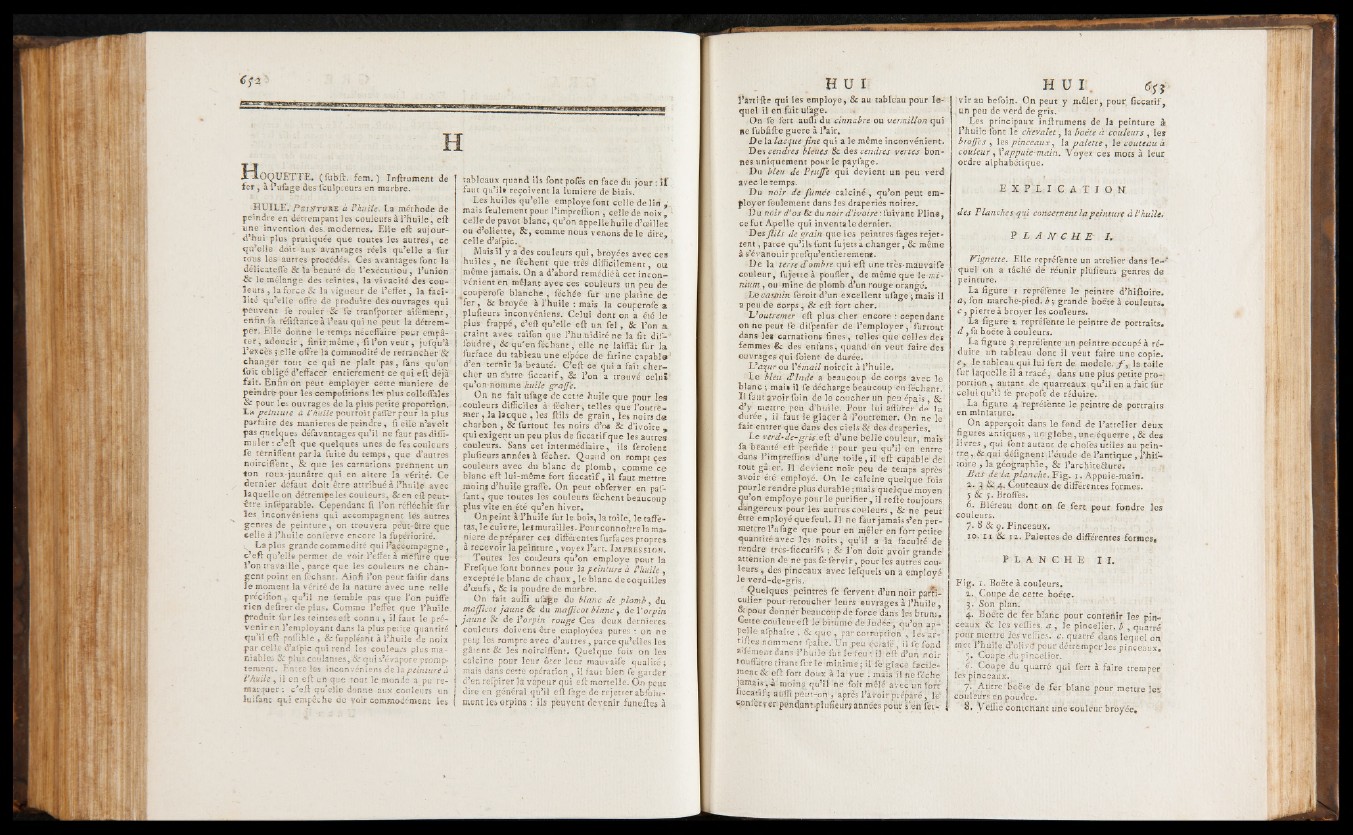
H
H o q u e t t e , ( fubft. fem. ) Inftrument de
f e r , à l’ufage des fculpteurs en marbre.
H U IL E .P einture à Vhuile. La méthode de
peindre en détrempant les couleurs à l’huile , eft
une invention des. modernes. Elle eft aujourd’hui
plus pratiquée que toutes les autres, ce
qu’elle doit aux avantages réels qu’elle a fur
tous les autres procédés. Ces avantages font la
délicatefle & la beauté de l ’exécutiou , l ’union
•& le mélange des teintes, la vivacité des couleurs
, la force & la vigueur de l ’e ffet, la facilité
qu’elle offre de produire des ouvrages qui
peuvent fe rouler ;& le tranfporter aifément,
enfin fa réfiftance à l’eau qui ne peut la détremper.
Elle donne le temps néceffaire pour empâter
, adoucir , finir même , fi l ’on v eu t, jufqu’à
1 excès ; telle offre la commodité de retrancher &
changer tout ce qui ne plaît pas , fans qu’on
foit obligé d’effacer entièrement ce qui eft déjà
fait. Enfin on peut employer cette maniéré de
peindre- pour les compétitions les plus colloflaîés
& pour les ouvrages de la plus petite proportion.
La peinture à Vhuile pourroit païfer pour la plus
parfaite des maniérés de peindre, fi éîTe .n’avoit
pas quelques défavantages qu’ il ne faut pas difii-
tnuler : c’eft que quelques unes de fesxouleurs
fe tèrniffent parla fuite du temps, que d’autres
noirciflent, & que les carnations prennent un
ton roux-jaunâtre qui en altéré Ta vérité. Ce
dernier défaut doit être attribué à j ’ huilë avec
laquelle on détrempe les couleurs, & en eft peut-
■ être inféparable. Cependant fi l’on réfléchit fur
les inconvéniens qui accompagnent lès autres
genres de peinture, on trouvera peut-être que
celle à l’hu île conferve encore la fupériorité.
k Lapins grande commodité qui Paccom pagne ,
c’eft qu’elle permet de voir l’effet à mëliire que
l ’on travaille , parce que les couleurs ne changent
point en féchant. Ain fi l’on peut faifir dans
le moment la vérité de la nature avec une telle
précifion, qu’ il ne femble pas que Ton puifle
Tien defirer de plus. Comme l ’effet que l’huile,
produit furies teintes eft connu , il faut le prévenir
en l ’employant dans la plus petite quantité
qu’il eft poffible , & fuppléant à l’huile de noix
par celle d’afpic qui rend les couleurs plus maniables
& plus coulantes, & qui s’évapore promptement.
Entre les inconvéniens dé la peinture à
Vhuile, il en eft un que tout le.monde a pu remarquer
: c’eft qu’elle donne aux couleurs un
luifanî qui empêche de voir commodément les
tableaux quand ils font pofés en face du jour : i f
faut qu’ il# reçoivent la lumière de biais,
x ^es huiles qu’elle employé font celle de lin
mais feulement pour l’impreflion , celle de noix,
celle de pavot blanc, qu’ on appelle huile d’oeillec
ou d’oliette, & , comme nous venons de le dire,
celle d’afpic.^
Mais 31 y a des couleurs qui, broyées avec ces
huiles , ne féchent que très difficilement, ou
même jamais. On a d’abord remédié à cet inconvénient
en mêlant avec ces couleurs un peu de
^couperofe blanche, féchée fur' une platine de
;fe r , & broyée à l’huile : mais la couperofe a
plufieurs inconvéniens. Celui dont on a été le
plus frappé, c’ eft qu’elle eft un fel , & l’on a
craint avec raifon que l’humidité ne la fit d i f - '
foùdré , 8c qu'en féchant, elle ne laiflat fur la
fuxface du tableau une efpéce de farine capable
d’en ternir la beauté. C’eft ce qui a fait chercher
un afutre ficcatif, 8c l’on a trouvé celui
qu’on nomme huile grajfe.
On he fait ufage de cette huile que pour les
.couleurs difficiles à fécher, telles que l’outremer
, la Jacque , les ftils de grain, les noirs de
charbon , & furtout les noirs d’oe 8c d’ivoire
qui exigent un peu plus de ficcatif que les autres
couleurs. Sans cet intermédiaire, ils feroienc
plufieurs années à fécher. Quand on rompt ces
couleurs avec du blanc de plomb, comme ce
blanc eft lui-même fort fic catif, il faut mettre
moins d’ huile grafle. On peut obferver en paf-
fant, que toutes les couleurs féchent beaucoup
plus vîte en été qu’ en hiver.
On peint à l’huile fur le bois, la toile, le taffetas,
le cuivre, les murailles. Pourconnoîtrela maniéré
de préparer ces différentes furfaces propres
à recevoir la peinture, voyez l’art. Impression.
Toutes les couleurs qu’on employé pour la
Frefque font bonnes pour la peinture à l’huile ,
excepté le blanc de chaux, Je blanc de coquilles
d’oeufs , & la poudre de marbre.
On fait auffï ufa^e du blanc de plomb du
mafficot jaune 8c du majjicot blanc , de V or pin
jaune & de Vorpin rouge Ces deux dernieres
couleurs doivent être employées pures : on ne
peliy les rompre avec d’autres, parce quelles les
gâtent & les noirciflent. Quelque fois on les
calcine pour leur ô.rer leur mauvaife qualité;
mais dans cette opération , il faut bien fe garder
d’ enrefplrer la yapeur qui eft mortelle. On peut
dire en général qu’ il eft (âge de rejetter ab foi liment
les orpins : ils pWyent devenir funeftes à
H u i
ï*ârtifte qui les employé, & au tableau pour lequel
il en fait ufage.
On fe fert aufli du cinnabre ou vermillon qui
ne fubfifte guere à l’air.
De la lacque fine qui a le même inconvénient.
Des cendres bleues 8c des cendres vertes bonnes
uniquement pour le payfage..
Du bleu de Prujfe qui devient un peu yerd
avec le temps.
Du noir de fumée calciné , qu’on peut employer
feulement dans les draperies noires.
Du nôir d?os 8c du noir d'ivoire : fuivant Pline,
ce Fut Apelle qui inventale dernier.
Des ftils de grain que les peintres fages rejettent
, parce qu’ils font fujetsà changer, & même
â s’évanouir prefqu’entieremen*.
De la terre d'ombre qui eft une très-mâuvaife
couleur, fujette à pouffer, de même que \e minium
t ou mine de plomb d’un rouge orangé*
l i e carmin feroit d’un excellent ufage; mais il
a peu de corps, 8c eft fort cher.
U outremer eft plus cher encore : cependant
on ne peut fe difpenfer de l’employer, furtout
dans le« carnations fines-, telles que celles des
femmes 8c des entans, quand on veut faire des
ouvrages'qui (oient de dorée.
L’azur ou V6ma.il noircit à l’huile.
Le bleu d’Inde a beaucoup de corps avec le
blanc ; mai» il fe décharge beaucoup-en féchant.
U faut avoir foin de le coucher un peu épais , &
d’y mettre peu d’huile. Pour lui aflurér 'de la
durée , il faut le glacer à l’outremer. On ne le::
fait entrer que dans des ciels & des draperies.
Le verd-de-gris',eft d’une b'élîè couleur, mais
fa beauté eft perfide : pour peu qu’il en entre
dans l ’ impreffïoB d’une to ile , il eft capable dèl
tout gâter. Il devient noir peu de temps après
avoir été employé. On le calciné quelque fois
pourle rendre plus durable ; mais quelque moyen
qu’on empîoyepourle purifier, il refte toujours
dangereux pour les autres couleurs, 8c ne peut
être employé que feul. Il ne faut jamais s’en permettre
l ’ufage que pour en mêler en fort petite
quantité avec les noirs , qu’ il a la faculté'de
rendre tres-ficcàtifs ; & l ’on doit avoir grande
attention de ne pas fe fe rv ir , pour les autres couleurs
, des pinceaux avec lefquels on a employé
le verd-de-gris..
Quelques peintres fe fervent d’un noir pat%-
culier pour retoucher leurs ©ùvrages à l’h u ile ,
& pour donner beaucoup dé force dans les bruns.
Gette couleur eft le bitume de Judée; qu’on ap^
pelle afphaîte , & que , par corruption , lés ‘ar -;
tiftes nomment fpalte. Un,peu éciafé, il fe fond
aVfémeiit dansThuilé (ur le-feu • il eft d’un noir
rouffâtre tirant fur le minime; il fe-glacé faciie-
ntent 8c eft fort doux .à la vue . mais il ne fcçhe
jamais, -à moin^ qu’ il ne foit mêlé avec un fort
ficcatif; aiiffi peut-on1, après l’avoir pré^àré y le’
çpnferyer pendant.plufieurs années poiir s’en fet-
H U I . 4 0
vir au befoin. On peut y mêler, pour ficcatif,
un peu de verd de gris.
Les principaux inftrumens de la peinture à
l’huile font 1 e chevalet, la boéte à couleurs , les
brojjes , les pinceaux, la palette, le couteau à.
couleur , Vappuie-main. Voyez1 ces mots à leur
ordre alphabétique.
E X P L I C A T I O N
des Planches qui concernent la peinture à Vhuile.
P L A N C H E ; I .
Vignette. Elle repréfente un attelier dans 'le-'*
quel on a tâché de réunir plufieurs genres de
!• peinturé.
La figure i repréfénte le peintre d’hiftoire.
a, fon marche-pied, b ; grande boëte à couleurs.
! c , pierre à broyer le$ couleurs.
La figure a repréfente le peintre de portraits.
d , fa boëte à couleurs.
La figure 3 repréfente un peintre occupé à réduire
un tableau dont il veut faire une copie.
er le tableau qui lui fert de modèle. f x la toile
, lur laquelle il a tracé, dans une plus petite pro->
portion , autant de quarreaux qu’ il en a fait fur
1 celui qu’ il fe propofe de réduire.
La^ figure 4 'reprélènte le peintre de portraits
en miniature.
j On apperçoit dans le fond de l ’attelier deux
J figures antiques , urrglobe,une/équerre , 8c des
; livres , qui font autant de chofes utiles au pein-
1 rrf. j & qui défigne.nt l ’étude de l’antique, l’hif-
; toire , la géographie, & l’architefture.
E a s de,'la planche. F ig , 1. Appuie-main.
2“ . 3 &i.4* Couteaux de différentes formes.
5 & 5. Brofles.
6. Bléreau dont on Te fert pour fondre les
couleurs.
7* 8 & 9. Pinceaux.
10. 11 8c iz. Palettes.de différentes formes*
P L A N C H E I I .
F ig . 1. Boëte à couleurs.
a. Coupe de cette boëte..
3. Son plan.
4. Boëte de fer blanc pour contenir les pinceaux
& lès veffïes. <2 , le pincelier. b , quatre
péur mertre Ies veffies. c. quarré dans lequel on
mec l’huile d’oli vé pour détremper les pinceaux.
5. Coupe dupincelier. r ’
6: 1Coupe du quarré qui fert à faire tremper
lès pinceaux.
7*; A¥ tre 'bçëce dé fer blanc pour mettre les
coul eurs en poudre.
o. Vëffié contehant line coulëur broyée.