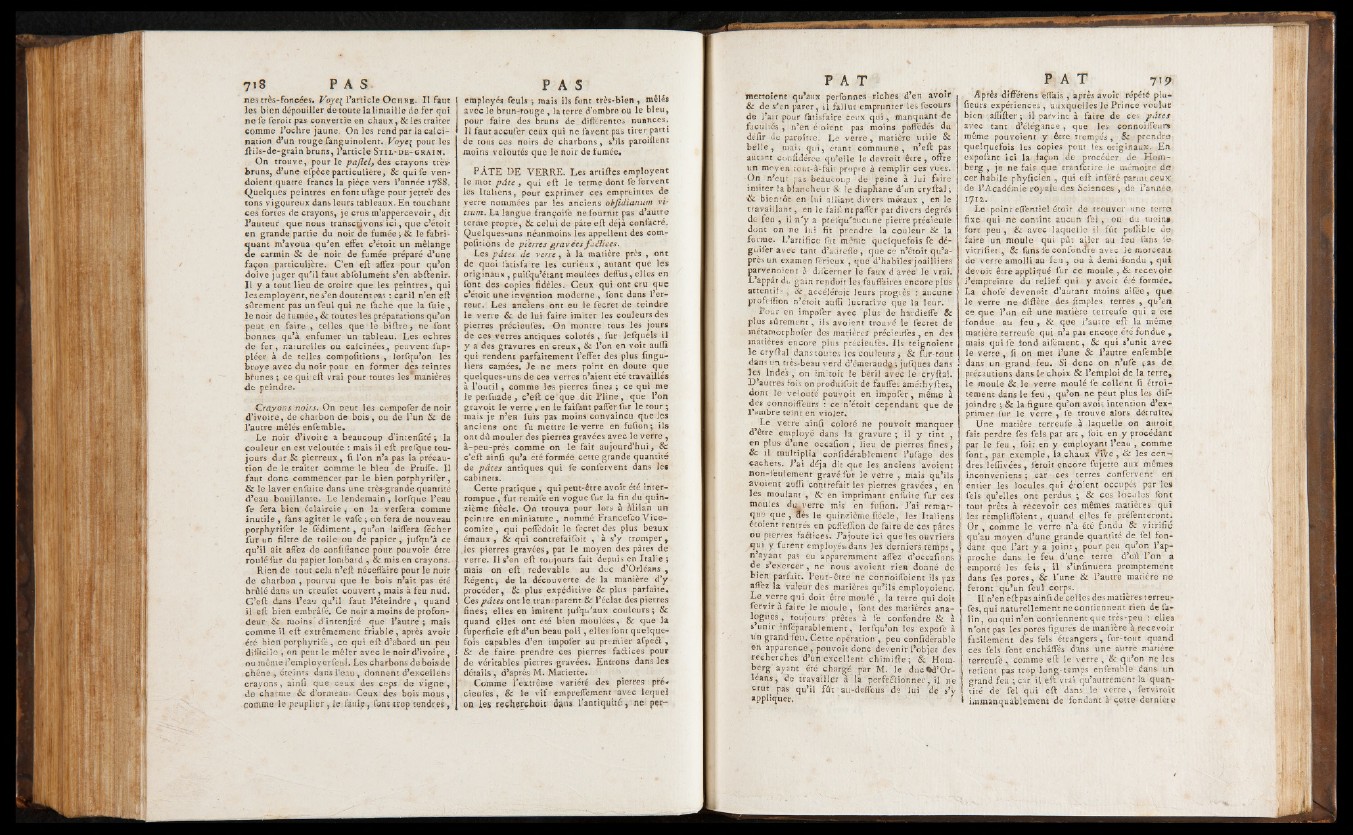
nés très-foncées. Voyc{ l’article Ochre. I l faut
les bien dépouiller de toute la limaille de fer qui
ne fe feroit pas convertie en chaux, &les traiter
comme l’ochre jaune. On les rend par la calcination
d*un rouge fanguinolenr. Voyez pour les
Hils-de-grain bruns, l ’article Stil-de- grain.
On trouve, pour le pafiely des crayons très-
bruns, d’ une efpèce particulière, & qui fe ven-
doient quatre francs la pièce vers l’année 1788.
Quelques peintres enfontufage pour jette’r des
tons vigoureux dans leurs tableaux. En touchant
ces fortes de crayons, je crus m’appercevoir, dit
l ’auteur que nous transcmvons ic i , que c’étoit
en grande partie du noir de fumée ; & le fabricant
m’avoua qu’en effet c’étoit un mélange
e carmin & de noir de fumée préparé d’ une
façon particulière. C ’en eft allez pour qu’on
doive juger qu’ il faut abfolument s’en abftenir.
Il y a tout lieu de croire que les peintres, qui
les employenc, ne s’en doutent nas : car il n’en eft
sûrement pas un feul qui ne fâche que la fuie ,
le noir de fumée, & toutes les préparations qu’ on
peut en faire , telles que le b iftrc , ne font
bonnes qu’à enfumer un tableau. Les ochres
de fe r , naturelles ou calcinées,, peuvent Tup-
pléer à de telles cotnpofitions , lorfqu’on les
broyé avec du noir pour en former des teintes
brunes ; ce qui eft vrai pour toutes les manières
•de peindre.
Crayons noirs. On peut les compofer de noir
d’ivoire, de charbon de bois, ou de l’un 8c de
l ’autre mêlés enfemble.
Le noir d’ ivoire a beaucoup d’intenfité ; la
couleur en est veloutée : mais il eft prefque toujours
dur & pierreux, fi l’on n’a pas la précaution
de le traiter comme le bleu de Pruffe. Il
faut donc commencer par le bien porphyrifer,
& le laver enfuite dans une très-grande quantité
d’eau bouillante. Le lendemain , lorfque l’eau
fe fera bien éclaircie,! on la verfera comme
Inutile , fans agiter le vafe ; on fera de nouveau
porphyrifer le fédiment , qu’on laiflera fecher
fur un filtre de toile ou de papier, jufqu’à ce
qu’ il ait artez de confifiance pour pouvoir être
roulé fur du papier lombard , 8c mis en crayons. •
Rien de tout cela n’ eft néceffaire pour le noir
de charbon , pourvu que le bois n’ait pas été
brûlé dans un creufet couvert, mais à feu nud.
C ’eft dans l’eau qu’ il faut l’éteindre , quand
il eft bien embrâfé. Ce noir a moins de profondeur.
& moins’ d’intenfiré qu.e l’autre; mais
comme il eft extrêmement friab le, après avoir
été bien porphyrifé, ce qui eft d’abord un peu
difficile on peut le mêler avec le noir d’ivoire,
ou même l’employer feul. Les charbons de bois de
çhêne , éteints dans Peau , donnent d’excellens i
crayons, ainfi que ceux des ceps de v ig n e ,
de charme & d’ormeau. Ceux des bois mous,
comme le .peupliçr, fe faulç, font trop tendres,
employés feuls ; mais ils font très-bien , mêlés
avec le brun-rouge , la terre d’ombre ou le bleu,
pour faire des bruns de differentes nuances.
Il faut accufer ceux qui ne favent pas tirer parti
de tous ces noirs de charbons, s’ils paroiflent
moins veloutés que le noir de fumée.
PÂ TE DE VERRE. Les artiftes employent
le mot pâte , qui eft le terme dont fe fervent
les Italiens, pour exprimer ces empreintes de
verre nommées par les anciens objidianum vi-
trum. La langue françoife ne fournit pas d’autre
terme propre, 8c celui de pâte eft déjà confacré.
Quelques-uns néanmoins les appellent des com-
pofitions de pierres gravées fùftices.
Les pâtes de verre, à la matière près , ont
de quoi fatisfa:re les curieux , autant que les
originaux, puifqu’étant moulées deffus, elles- en
font des copies fidèles. Ceux qui ont cru que
c’étoit une invention moderne , font dans l’erreur.
Les anciens ont eu le fecret de teindre
le verre 8c de lui faire imiter les couleurs des
pierres précieufes. On montre tous les jours
de ces verres antiques colorés, fur lefquels il
y a des gravures en creux, 8c l’on en voit aufiî
qui rendent parfaitement l’effet des plus fingu-
liers camées. Je ne mets point en doute que
quelques-uns de ces verres n’aient été travaillés
à l ’o u t il, comme les pierres fines ; ce qui me
le per Iliade , c’eft ce que dit Pline, que l’on
gravoit le verre , en le faifant pafler fur le tour ;
mais je n’ en fuis pas moins convaincu que les
anciens ont fu mettre le verre en fufion; ils
ont dû mouler des pierres gravées avec le verre ,
à-peu-près comme on le fait aujourd’h u i, &
c’eft ainfi qu’ a été formée cette grande quantité
de pâtes antiques qui fe confervent dans les
cabinets.
Cette pratique , qui peut-être avoit été interrompue
, fut remife en vogue fur la fin du quinzième
fiècle. On trouva pour lors à Milan un
peintre en miniatuxe , nommé Francefco V ice -
comité, qui poffedoit le fecret des plus beaux
émaux , &: qui contrefaïfbic , à s’y tromper,
.les pierres gravées, par le moyen des pâtes de
verre. I ls ’Gn eft toujours fait depuis en Italie;
mais on eft redevable au duc d’Orléans ,
Régent, de la découverte de la manière d’y
procéder, & plus expéditive 8c plus parfaite.
Ces pâtes ont le transparent 8c l’ éclat des pierres
fines; elles en imitent jufqu’ aux couleurs ; &
quand elles ont été bien moulées, & que la
fuperficie eft d’un beau p o li, elles font quelquefois
capables d’en impofer au premier afpeél,
& de faire prendre ces pierres fa&ices pour
de véritables pierres gravées. Entrons dans les
détails, d’après M. Mariette.
Comme l’extrême variété- des pierres précieufes,
& le v if empreffement avec lequel
on les reçherchoit dans l’antiquité, ne permettaient
qu’aux perfonnes riches d’ en avoir
8c de s’ en parer , il fallut emprunter les fecours
de l’ait pour fatisfaire ceux qui , manquant de
facultés , n’ en é oient pas moins poftedés du
dëfir de paroître. Le v erre, matière utile &
b e lle , mais qui, étant commune, n’ eft pas
autant confidérée qu’elle le devroit être , offre
un moyen tout-à-fait propre à remplir ces vues.
On n’eut pas beaucoup de peine à lui faire
imiter la blancheur 8c. le diaphane d’ un cryftal ;
8c bientôt en lui alliant divers métaux , en le
travaillant, en le fa if. ne partir r par divers degrés
de-feu , il n’y a prefqu'aucune pierre précieule
donc on ne lui fit prendre la couleur 8c la
forme. L’ artifice fut même quelquefois fe dé-
guifer avec tant d’acireffe , que ce n’étoit qu’a-
près un examen férieux , que’ d’habiles joailliers
parvenoienc à djfcerner le faux d avec le vrai.
L appât du gain rendoit les fauflaires encore plus
attentif.«, 8c v accéléroit leurs progrès : aucune
profeffion n’étoit aufiî lucrative que la leur.
Four en impoffer avec plus de hardiefle &
plus sûrement, ils avoient trouvé le fecret de
inétamorphofer des matièreî précieufes, en des
matières encore plus précieufes. Ils teignoienc
le cryftal dans toutes les couleurs, & fur-tout
dans un très-beau verd d’émerand^ ; jufques dans
le s Indes , on imitait le béril avec le cryftal.
D autres fois on produifoit de fauffes amérhyftes,
dont le veloufé pouvoit en impofer, même à
des connoirteurs : ce n’étoit cependant que de
l ’ambre teint en violer.
Le verre ainfi coloré ne pouvoit manquer
d’etre employé dans la gravure ; il y cint ,
en plus d’une occafion , lieu de pierres fines,
& il multiplia confidérablement l’ufage des
cachets. J’ai déjà dit que les anciens avoient
non-feulement gravé fur le verre , mais qu’ils
avoient aufii contrefait les pierres gravées, en
les moulant , 8c en imprimant enfuite fur ces
moules dq^verre mis en fufion. J’ai remarqué
q u e , ffès le quinzième fiècle, les Italiens
écoient rentrés en porteffion de faire de ces pâtes
bu pierres faétices. J’ajoute ici que les ouvriers
qui y furent employés.dans les derniers temps ,
n ayant pas eu apparemment afl'ez d’occafions
de s’exercer, ne nous avoient rien donné de
bien parfait. Peut-être ne connoirtoient ils pas
aflez la valeur des matières qu’ils employoient.
Le verre qui.doit être moulé , la terre qui doit
feryir à faire le moule , font des matières analogues,
toujours prêtes à fe confondre & à
s unir inféparablement, lorfqu’on les expofe à
un grand feu. Cette opération , peu confidérable
en apparence , pouvoit donc devenir l’objet des
recherches d’ un excellent chimifte; 8ç Hom-
berg ayant été charge pàr M. le ducfcd’Or-
leans, de travailler à la përfeélibnner, il ne
crut pas qu’ il fût au-deflciis' d? lui de s’ÿ
appliquer.
Après difFérens leffais, aprèsavoîr répété plu-
fieurs expériences , auxquelles le Prince voulue
bien afïifter ; il parvint à faire de ces pâtes
avec tant d’élégance, que les connoirteurs
même pouvoient y être trompés, & prendre-
quelquefois les copies pour les originaux. En
exportant ici la façon de procéder de Hom-
b e rg , je ne fais que tranferire le mémoire de
cer habile phyficien , qui eft inféré parmi ceux
de l’Académie royale des Sciences , de l ’année,
iy i z .
Le point efferttiel étoir de trouver une terre,
fixe qui ne contînt aucun f e l , ou du moins
fort peu , 8c avec laquelle il fût polîible de;
faire un moule qui pût aller au feu fans fe-
vitrifier , & fans fe confondre avec le morceau,
de verre amolli au feu , ou à demi fondu , qui
devoir être appliqué fur ce moule , 8c recevoir
i’empreinre du relief qui y avoir éié formée.
La chofé devenoit d’autant moins ai fée, que
le Verre ne diffère des fimples terres , qu’en
ce que l’ un eft une matière terreufe qui a été
fondue au fe u , & que l’autre eft la même
matière terreufe qui n’a pas encore été fondue ,
mais qui fe fond aifément, & qui s’ unit avec
le verre , fi on met l’une & l’autre enfemble
dans un grand feu. Si donc on n’ufe pas de
précautions dans le choix & l’emploi de la terre,
le moule & le verre moulé fe collent fi étroitement
dans le feu , qu’on ne peut plus les disjoindre
; & la figure qu’on avoic intention d’ exprimer
fur le verre , le trouve alors détruite.
Une matière terreufe à laquelle on auroit
fait perdre Ces fels par a r t, foit en y procédant
par le feu , foit en y employant l’eau , comme
font, par exemple, la chaux vive , & les cendres
lefiivées , feroit encore fujette aux mêmes
inconvëniens ; car ces terres confervent en
entier les locules qui é-O'.ent occupés par les
: fels qu’elles ont perdus ; & ces locales font
tout prêts à recevoir ces mêmes matières qui
les remplifloient, quand elles fe préfenteront.
Or , comme le verre n’ a été fondu & vitrifié
qu’au moyen d’ une grandé quantité de fel fon-
I dant que l’art y a jo in t, pour peu qu’on l’approche
dans le feu d’une terre d’où l’on a
emporté les fels , il s’ infinuera promptement
dans fes pores, & l’une & l ’autre matière ne
feront qu’ un feul corps.
Il n’en èft pas ainfi de celles des matières terreu-
fes, qui naturellement ne contiennent -rien de fa-
lin, ou qui n’en contiennent que très-peu t elles
n’ont pas les pores figurés de manière aTecevoir
facilement des fels étrangers, fur-tcut quand
ces Tels font enchârtes dans une autre matière
terreufe , comme eft le verre, & qu’on ne les
retient pas trop long-temps enfemble dans un
grand feu ; car. il eft vrâi qu’autrement la quantité
de fel qui eft dans le verre, ferviroit
» immanquablement de fondant à cette dernière