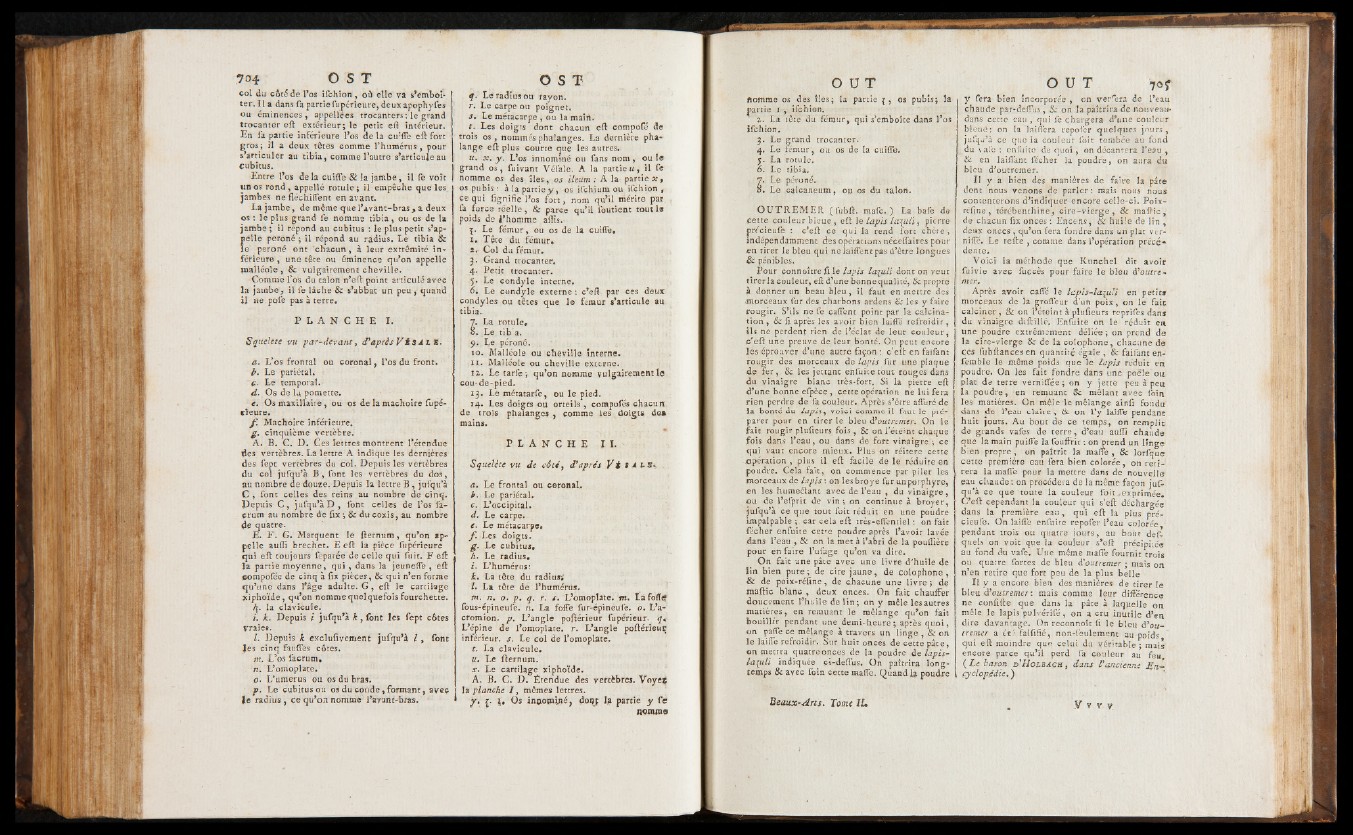
col du côté de l’ os ifchion , où elle va s’emboîter.
Il a dans fa partie fupérieure, deux apophyfes
ou éminences , appellées trocanters ; le grand
trocanter eft extérieur; le petit eft intérieur.
En fa j» rt'ie inférieure l’os de la cu'ffe eft fort
gros ; il a deux têtes comme l ’humérus , pour
s’articuler au tibia, comme l’autre s’articule au
cubitus.
Entre l’os delà cuiffe 8t la jambe, il fe volt
tin os rond, appelle rotule; il empêche que les,
jambes ne fléchiffent en avant.
La jambe, de même que l’ avant-bras y a deux
os : le plus grand le nomme tib ia, ou os de la
jambe ; il répond au cubitus : le plus petit s’appelle
péroné ; il répond au radius. Le tibia &
le péroné ont 'chacun, à leur extrémité inférieure
, une tête ou éminence qu’on appelle
malléole , & vulgairement cheville.
Comme Los du talon n’eft point articulé avec
la jambe', il-fe lâche & s’abbat un peu, quand
i l 11e pôle pas à terre,
P L A N C H E I.
Sguçlctç vu par-devant, d'après V i s a i e .
a. L’os frontal ou çoronal, l ’os du front.
b. Le pariétal.
ç. Lé temporal.
d. Os de la pomette.
e. Os maxillaire, ou os de la mâchoire fupé-
cieure.
f . Maçhoirè inférieure.
g. cinquième vertèbre.
A . B. C. D. .Ces lettres montrent l’étendue
des vertèbres. La lettre A indique les dernières
des lepe vertèbres du col. Depuis les vertèbres
du col jufqu’à B , font les vertèbres du dos,
au nombre de douze. Depuis la lettre B , jufqu’à
C , font celles des reins au nombre de cinq.
Depuis C , jufqu’à D , font celles de l ’os fa-
e ru in au nombre de lix ; 8c ducoxis, au nombre
de quatre.
E. F . G. Marquent le fternum, qu’on appelle
auffi brechet. E eft la pièce fupérieure
qui eft toujours féparée de celle qui fuit. F eft
la partie moyenne, q u i, dans la jeunelfe , eft
©ompofée de cinq à fix pièces, 8c qui n’ en forme
qu’une dans l’âge adulte. G , eft le cartilage
xiphoïde, qu’on nomme quelquefois fourchette.
h. la clavicule.
i. k. Depuis i jufqu’à k , font les fept côtes
vraies.
/. Depuis k exclufivement jufqu’à l , font
les cinq fauffes côtes.
m. L ’os facrum,
n. L’onioplate.'
o. L’umerus ou os du bras.
p. Le cubitus ou os du coude, formant, aveç
le radius, ce qu’on nomme i’ ayant-bras.
f . Lé radius ou rayon.
r . L e c a r p e o u p o i g n e t .
s . L e m é t a c a r p e , o u l a m a in .
t. L e s d o i g t s d o n t c h a c u n e f t c o m p o f é d e
t r o i s o s , n o m m é s p h a l a n g e s . L a d e r n i è r e p h a l
a n g e e f t p lu s c o u r t e q u e l e s a u t r e s ,
u . x . y . L ’ o s in n o m m é o u fa n s n o m , o u l e
g r a n d o s , f u i v a n t V é f a l e . A l a p a r t i e w , i l f e
n o m m e o s d e s î l e s , o s i le iim : A l a p a r t i e * ,
o s p u b i s : à l a p a r t i e ^ , o s j f e h i u m o u i f c h i o n „
c e q u i f i g n i f i e l ’ o s f o r t , n o m q u ’ i l m é r i t e p a r
fa f o r c e r é e l l e , & p a r c e q u ’ i l f o u t i e n t t o u t l e
p o id s d e à ’ h o m m e a f f is .
L e f é m u r , o u o s d e l a c u i f f e ,
i . T ê t e d u f é m u r ,
2 r C o l d u f é m u r .
3* G r a n d t r o c a n t e r ,
4 . P e t i t t r o c a n t e r .
: 5 . L e c o n d y l e in t e r n e .
6 , L e c o n d y l e e x t e r n e : c ’ e f t p a r c e s d e u x
c o n d y l e s o u t ê t e s q u e l e f é m u r s ’ a r t i c u l e a u
t i b i a .
7 . L a r o t u l e ,
o . L e t i b a .
! 9 . L e p é r o n é .
1 0 . M a l l é o l e o u c h e v i l l e in t e r n e .
11. Malléole ou cheville externe.
1 2 . L e t a r f e ; q u ’ o n n o m m e v u l g a i r e m e n t l e
c o u - d e - p i e d .
1 3 . L e m é t a t a r f e , o u l e p i e d .
1 4 * L e s d o i g e s o u o r t e i l s , c om p o f é s c h a c u n
d e t r o i s p h a l a n g e s , c o m m e l e s d o i g t s d e »
m a in s .
P L A N C H E I I .
S q u e lè t e v u d e c ô t é , d 'a p r è s r j u i s .
a . L e f r o n t a l o u c e r o n a l . .
b. L e p a r i é t a l .
c . L ’ o c c i p i t a l .
d . L e c a r p e .
e. L e m é t a c a r p e ,
ƒ ! L e s d o i g t s .
g . L e c u b i t u s ,
h . L e r a d iu s .
i. L’humérus:
k . L a t ê t e d u r a d iu s ;
/. L a t ê t e d e l ’ h u m é r u s .
m. n . o . p . q . r. s . L ’ o m o p la t e , m . t à f o f t c f
f o u s - é p in e u f e . n. L a f o l l e fu r - é p in e u f e . 0. L ’ a -
c r o m i o n . p . L ’ a n g l e p o f t é r ie u r fu p é r i e u r .
L ’ é p in e d e l ’ o m o p l a t e , r . L ’ a n g l e p o f t é r i e u ç
in f é r i e u r , ƒ . L e c o l d e l ’ o m o p la t e , .
t. L a c l a v i c u l e ,
u . L e f t e r n u m .
x . L e c a r t i l a g e x i p h o ï d e .
A . B . C . D . É t e n d u e d e s v e r t è b r e s . V o y e f c
J l a planche I , m êm e s l e t t r e s .
y . J , O s in o o m ü t é , d o q j l a p a r t i e y f e
nomme
nomme os des îles; la partie os pubis; la
partie 1 , ifchion.
2. La tête du fémur, qui s’emboîte dans l’ os
ifchion.
3. Le grand trocanter.
4. Le fémur , ou 05 de la cuiffe.
j . La rotule,
o. Le tibia,
. Le péroné.
. . Le calcanéum, ou os du talon.
O U T R EM E R (fubft. mafe.,) La bafe de
cette couleur bleue , eft 1 e lapis la\ulï, pierre
prccieufe : c’eft ce qui la rend fort chère",
indépendamment des opérations nécelfaires pour
en rirer le bleu qui nelaiffentpas d’être longues
8c pénibles.
Pour çonnoître fi le lapis la[uli dont on veut
tirer la couleur, eft d’ une bonne qualité, 8c propre
à donner un beau bleu, il faut en mettre des
-morceaux fur des charbons ardens 8c les y faire
rougir. S’ ils ne fe çaffent point par la calcination
, & ft après les avoir bien laiffé refroidir,
ils ne perdent rien de l’éclat de leur couleur,
.c’ eft une preuve de leur bonté. On peut encore
les éprouver d’une autre façon : c’eît en faifant
rougir des morceaux de lapis fur une plaque
de fer , & les jettant enfuite tout rouges dans
du vinaigre blanc très-fort. Si la pierre eft ;
d’ une bonne efpèce , cette opération ne lui fera I
rien perdre de fa couleur. Après s’être afluré de !
la bonté du lapis, voici comme il faut le pré- i
parer pour en tirer le bleu d’ outremer. On le j
fait rougir plufieurs fois , & o n l’éte»nt chaque ;
fois dans l’eau, ou dans de fort vinaigre'} ce !
qui vaut encore mieux. Plus on réitéré cette i
^opération , plus il eft facile de le réduire en j
poudre. Cela fait, on commence par piler les
morceaux de lapis : on les broyé fur un porphyre,
en les humeclanc avec de l’eau , du vinaigre,
ou de l’efprit de vin; on continue à broyer,
jufqu’à ce que tout foit réduit en une poudre
impalpable ; car cela eft très-eflentiel : on fait
fécher enfuite cetre poudre après l’avoir lavée
dans l ’eau , & on la met à l’abri de la pouffière
pour en faire l’ufage qu’on va dire.
On fait une pâte avec une livre d'huile de
lin bien pure; de cire jaune, de colophone ,
& de poix-réfine, de chacune une livre ; de
maftic blanc , deux onces. On fait chauffer
doucement l’huile de lin; on y mêle les autres
matières, en remuant le mélange qu’ on fait
bouillir pendant une demi-heure; après quoi,
on paffe ce mélange à travers un linge , 8c on
le laiffe refroidir. Sur huit onces de cette pâte,
©n mettra quatre onces de la poudre de lapis-
la[uli indiquée çi-deffus. On paîtrira longtemps
8c avec foin cette maffe. Quand la poudre
y fera bien incorporée , on verfera de l’eau
chaude par-deffus, 8c on la paîtrira de nouveau-
dans cette eau , qui fe chargera d’une couleur
bleue; on la lai fiera repofer quelques jours ,
jufqj’à ce que la couleur foit tombée au fond
du v.al'c : enfuite de q uoi, on décantera l’eau ,
8c en laiftànt fécher la poudre, on aura du
bleu d’outremer.
Il y a bien des manières de faire la pâte
dont nous venons de parler : mais nous nous
contenterons d’ indiquer encore celle-ci. Poix-
réfine, térébenthine9 cire-vierge , & maftic,
de chacun fix onces : Encens, 8c huile de lin ,
deux onces, qu’on fera fondre dans un plat ver-
niffé. Le refte , comme dans l’opération précédente.
Voici la méthode que Kunchel dit avoir
fuivie avec fuccès pour faire le bléu d’outremer.
Après avoir caffé le Icpis-laïuU en petits
morceaux de la groffeur d’un poix, on le fait
calciner , 8c on l’éteint à plufieurs reprifes dans
du vinaigre diftillé/ Enfuite on le réduit eu
une poudre extrêmement déliée; on prend de
la cire-vierge & de la colophone, chacune de
ces fubftancesen quantité égale , & faifant en-
femble le même poids que le lapis réduit en
poudre. On les fait fondre dans une poêle ou
plat de terre verniffée ; on y jette peu à peu
la poudre, en remuant 8c mêlant avec foin
les matières. On n iê le le mélange ainfi fondu
dans de l’eau c la ire , 8c on l ’y laiffe pendant
huit jours. Au bout de ce temps, on remplit
de grands vafes de terre, d’eau auffi chaude
que la main puiffe la foiiffrir : on prend un linge
bien propre, on paîrrit la maffe, & lorfque
cette première eau fera bien colorée, on retirera
la maffe pour la mettre dans de nouvelle
eau chaude: on procédera de la même façon ju(V
qu’à ce que toute la couleur fo it , exprimée«
C’ eft. cependant la couleur qui s’ eft déchargée
dans la première eau, qui eft la plus pré-
cieufe. On laiffe enfuire repofer l’ eaù colorée
pendant trois ou quatre jours, au bout desquels
on voit que la couleur s’eft précipitée
au fond du vafe. Une même maffe fournit trois
ou quatre fortes de bleu d'outremer ; mais on
n’en retire que fort peu de la plus belle
Il y a encore bien des manières de tirer le
bleu d’outremer: mais comme leur différence
ne confifte que dans la pâte à laquelle on
mêle le lapis pulvérifé, on a cru inutile d’ en
dire davantage. On reconnoît fi le bleu d’outremer
a p i i falfifié, non-feulement au poids
qui eft moindre que celui du véritable ; mais
encore parce qu’il perd fa couleur au feu
( Le baron d ’H o lbach , dans l ’ancienne
çy dopé die, )
Beaux-Arts, Tome IL V y y v.