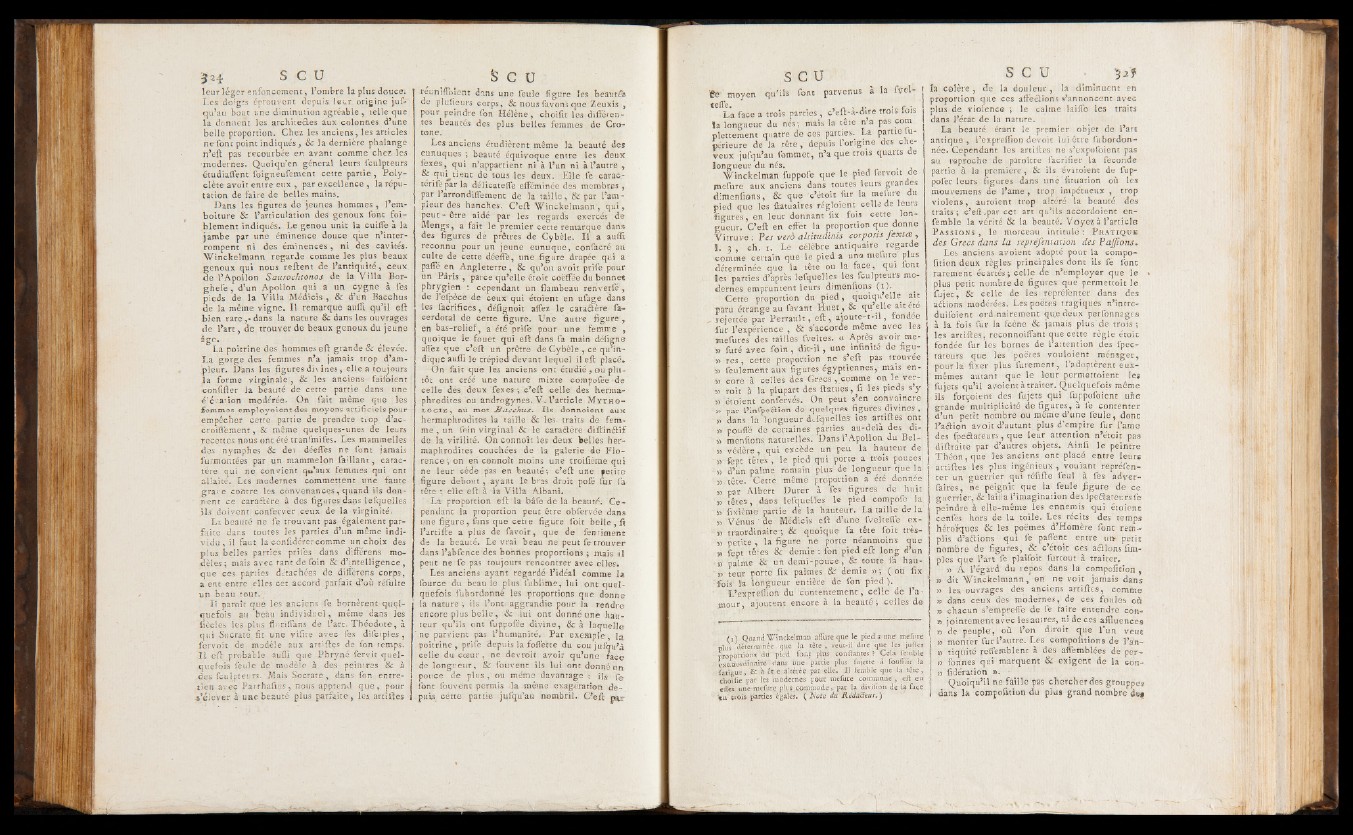
leur léger enfoncement, l’ombre la plus douce;
Les doigts éprouvent depuis.leur origine jufqu’au
bout une diminution agréable , telle que
la donnent les architectes aux colonnes d’ une
belle proportion. Chez les anciens , les articles
ne font point indiqués, & la dernière phalange
n’eft pas recourbée en avant comme chez les
•modernes. Quoiqu’en general leurs fculpteurs
étudiaffent foigneufement cette partie, Poly-
clète avoit entre eux , par excellence , la réputation
de faire de belles mains.
Dans les figures de jeunes hommes , l’em-
boiture & l’articulation des genoux font foi-
blement indiqués. Le genou unit la cuiffe à la
jambe par une éminence douce que n’ interrompent
ni des éminences, ni des cavités.
Winckelmann regarde comme les plus beaux
genoux qui nous relient de l’antiquité, ceux
de l’ Apollon Saurochtonos de la V illa Bor-
g h e fe , d’ un Apollon qui a un cygne à fes
pieds de la V illa Médicis , & d’ un Bacchus
de la même vigne. Il remarque aufli qu’ il eft
bien rare,«dans la nature & dans les ouvrages
de l’a r t, de trouver de beaux genoux du jeune
âge.
La poitrine des hommes eft grande & élevée.
La gorge des femmes n’a jamais trop d’ampleur.
Dans les figures di\ ineSj elle a toujours
la forme virginale, & les anciens faifoient
confifter la beauté de cette partie dans une
é'é-ation modérée. On fait même que les
femmes employoientdes moyens artificiels pour
empêcher cette partie de prendre tiop d’ac-
croifl'ement, & même quelques-unes de leurs
recettes nous ont été tranfmifes. Lès mammelles
des nymphes & des déeflès ne font jamais
furmontées par un mammelon fai lian t, caractère
qui ne convient qu’aux femmes qui ont
allaité. Les modernes commettent une faute
grave contre les convenances, quand ils donnent
ce caraélère à des figures-dans lefquelles
sis doivent confervèr ceux de la virginité.
La beauté ne fe trouvant pas également parfaite
dans toutes les parties d’ un même indiv
id u , il faut la confidérer comme un choix des
plus belles parties prîtes dans diftérens modèles
; mais avec tant de foin & d’ intelligence ,
que ces, parties détachées de diftérens corps,
a ent entre elles cet accord parfait d’où réfulre
un beau tout..
Il paroît que les anciens fe bornèrent quelquefois
au beau individuel, mêm-e dans les
fiècies les plus fleriffans de l’arc. Théodote, à
qui Socrate, fit une vifite avec fes difçiples ,
fervoit de modèle aux artiftes de fon temps.
I l eft probable aufli que Phryné ferait quelquefois
feule de modèle à des peintres & à
des fculpteurs. Mais Socrate , dans fon entretien
avec Parrhafius, nous apprend q u e , pour
s’élever à une beauté plus parfaite , les. artiftes
reunîftoïent dans une feule figure les beautés
de plufieurs corps, & nous favons que Zeuxis ,
pour peindre fon Hélène, choifit les différentes
beautés des plus belles femmes de Cro-
tone.
Les anciens étudièrent même la beauté des
eunuques ; beauté équivoque entre les deux
fexes, qui n’appartient ni à l’un ni à Pautre ,
& quotient de tous les deux. Elle fe carac-
térifeparla délicateffe efféminée des membres,
par l’arrondiffement de la ta ille , & par l’ampleur
des hanches. C’eft 'Winckelmann, q u i,
peut - être aidé par les regards exercés de
Mengs, a fait le premier cette remarque dans
des figures de prêtres de Cybèle. Il a aufli
reconnu pour un jeune eunuque, confacré au
culte de cette déeffe, une figure drapée qui a
paffé en Angleterre , & qu’ on avoit prife pour
un Pâris , parce qu’elle étoit coëffée du bonnet
phrygien : cependant un flambeau renverfé,
de Fefpèce de ceux qui étoient en ufage dans
les facrifices, défignoit affez le caraélère fa-
cerdotal de cette figure. Une autre figure y
en bas-relief, a été prife pour une femme ,
quoique le fouet qui eft dans fa main défigne
affez que c’eft un prêtre de Cybèle ce qu’indique
aufli le trépied devant lequel il eft placé*
On fait que les anciens ont étudié , ou plu-*
! tôt ont créé une nature mixte compofée de
celle dés, deux fexes-; c’ eft celle des hermaphrodites
ou androgynes. V . l’article M y t h o l
o g ie , au mot Bacchus. Us donnoient aux
hermaphrodites la taille & les. traits de femme',
un fein virginal & le caraélère diftinélif
de la virilité. On connoît les deux belles hermaphrodites
couchées de la galerie de Florence
; on eh connoît moins une troifième qui
ne leur cède pas en beauté; c’eft une petite
figure debout, ayant le bras droit pofé fur fa-
tête : elle eft à la V illa Albani.
La proportion eft la bâfe de la beauté; Cependant
la proportion peut être obfervée dans
une figure, fans que cette figure foit belle , fi
l’artifte a plus de favoir, que de fenriment
de la beauté. Le vrai beau ne peut fe trouver
dans l’abfence des bonnes proportions ; mais il
peut ne fe pas toujours rencontrer avec elles^
Les anciens ayant regardé l’ idéal comme la
fource du beau le plus fublime, lui ont quelquefois
fubordonné les proportions que donne
la nature ; ils l’ont aggràndie pour la rendre
encore plus b e lle , & -lui ont donné une hauteur
qu’ ils ont fuppofée divine, & à laquelle
ne parvient pas l’ humanité. Par exemple, la
poitrine , prife depuis la foffette du cou jufqu;à
celle du coeur , ne devroit avoir qu’une face
de longueur, & fouvent ils lui ont donne un
pouce de plus, ou meme davantage : j.]s fe.
font fouvent permis la même exagération depuis
cette partie jufqu’au nombril. C’eft
te moyen qu’ils font parvenus à la fvelteffe.
W H H B I . c .
L a face a trois parties , c’eft-a-dire trois rois
la longueur du nés; mais la tête n’ a pas corn,
plettemenc quatre de ces parties. La partie lu- J
©érieure de la tê te ,' depuis l’origine des cheveux
jufqu’ au Commet, n’a que trois quarts de I
longueur du nés. . ,
Winckelman fuppofe que le pied fervoit ,de
mefure aux anciens dans toutes leurs grandes
dimenfions, & que 'c’étoit fur la melure du
pied que les ftatuaires régloient celle de leurs
figures, en leur donnant fix fois cette longueur,
C’ eft en effet la proportion que donne
Vitruve ; P es verà altitudinis corporis fextee ,
î . 3 , ch., i . Lé célèbre antiquaire regarde
comme certain que le pied a une mefure plus
déterminée que la tête ou la face, qui font
les parties d’après lefquelles les fculpteurs modernes
empruntent leurs dimenfions ( i) .
Cette proportion du pied, quoiqu’ elle ait
paru étrange au favant H u e t, 8c qu’ elle ait ete
_ rejettée par Perrault, e ft, ajoute-t-il, fondée
fur l’expérience , & s’accorde même avec les
snefures des tailles fveltes. « Après avoir me-,
» furé avec fo in , d it- il, une infinité de figu-
» re s , cette proportion ne s’ eft pas trouvée
>■> feulement aux figures égyptiennes, mais en-
» core à celles des Grecs , comme on-lever-
» roit à la plupart des ftatues, fi les pieds s’y
» ‘étoient confervés. On peut s’en convaincre
» par l’ infpeélion de quelques figures divines,
» dans la longueur d<_fquelles les artiftes ont
» pouffé de certaines parties au-delà des di-
•• » mentions naturelles. Dans l’Apollon du Bel-
» védère , qui excède un peu la hauteur de
» fept têtes , le pied qui porte a trois pouces.
: » d’ un palme romain plus de longueur que la
« tête. Cette même proportion a été donnée
» par Albert Durer à fes figures de huit
ÿ> têtes, dans lefquelles le pied eompofe la
» fixième partie de la hauteur. La taille de la
» Vénus ‘ de Médicis eft d’ une fvel teffe ex-
>r traordinaire ; & quoique fa tête foit très-
» petite , la figure ne porte néanmoins que
» fept têtes & demie : fon pied eft long d’un
» palme & un demi-pouce-, & toute fa hau-
» teur porte fix palmes & demie » ; (o u fix
fois la longueur entière de fon pied).
L’exprefnoh du contentement, celle de l ’a '
iiiour, ajoutent encore à la beauté ; celles de
(i) Quand. Winckelman allure que le pied a une mefure
plus déterrai née q,ue la tête, veut-il-dire que les juftes
proportions du'^ied font plus conftantes ? Cela femble
exuàordinaire dans une partie plus fujette à foufi-iir la
fatigue, & à êt.e. altcrce paj-elle. Il femble que la tête,
choifie par les modernes pour mefure commune , eft en
effet une-mefure plus^çoijimode, par la divifion de la face
'(en trois parties égales. { B o t e du Rédacteur.)
îa colère, de la douleur, la diminuent en
proportion que ces affèclions s’annoncent avec
plus de violence ; le calme laiffe les traits
dans A’étàt de la nature.
La beauté étant le premier objet de l’are
antique , i ’expreflion devoit lui être fubordon-
née. Cependant les artiftes ne s’expofoient pas
au reproche de paroître facrifier la fécondé
partie à la première , & ils évitoient de fup-
pofer leurs figures dans une fituation où les
mouvemens de l’ame , trop impétueux , trop
violens, auroient trop altéré la beauté des
traits ; c’eft.par cet art qu’ ils accordoient en-
femble la vérité & la beauté. Voyez à l’article
Passions , le morceau, intitulé : Pratique
des Grecs dans la repréfentation des PaJJîons.
Les anciens avoient adopté pour la compo-
fition deux règles principales dont ils fé font
rarement écartés ; celle de n’employer que le
j plus petit nombre de figures que permettoit le
i fuje t, & celle de les rêpréfenter dans des
a étions modérées. Les poètes tragiques n’ intre-
duifoient ordinairement que deux perfonnages
à la fois fur la fcène & jamais plus'de trois;
les artiftes, reconnoiffant que cette règle étoit
fondée fur les bornes de l’attention des fpec-
tateurs que les poètes vouloient ménager,
pour la fixer plus furemenc, l’adoptèrent eux-
mêmes autant que le leur permertoient les
fujets qu’ il avoient à traiter. Quelquefois même
ils forçoient des fujets qui fuppofoient une
grande multiplicité de figures, à fe contenter
d’ un petit nombre ou même d’une feule, donc
l ’aélion avoit d’autant plus d’empire fur l’ame
des fpeélarèurs, que leur attention n’étoit pas
diftraite par d’autres objets. Ainfi le peintre
Théon, que les anciens ont placé entre leurs
artiftes les plus ingénieux, voulant repréfen-
ter un guerrier qui réfifte feul à fes adver-
faires, ne peignit que la feule jigure de ce
guerrier, & laiiia l’imagination des fpeélateursfe
peindre à elle-même les ennemis qui étoient
cenfés hors de la toile. Les récits des temps
héroïques & les. poèmes d’Homère font remplis
d’aélions qui fe paffent entré un* petit
nombre de figures, & c’étoit ces aétions Amples
que l’art fe platfoit furtout à traiter.
» A l’égard du repos dans la compofîtion ,
j » dit Winckelmann, on ne voit jamais dans
» les ouvrages des anciens artiftes, comme
» dans ceux des modernes, de ces foules où
| » chacun s’empreffe de fe faire entendre con-
] ». jointementavec les autres,, ni de ces affluences
! » de peuple, où l’on diroit que l’un veut
) » monter fur l ’autre. Les compoütions de l ’an-
» tiquité reffemblent à des affemblées de per-
» fonnes qui marquent & exigent de la con-
} » fédération ». -
Quoiqu’ il ne faille pas chercher des grouppes
1 dans la coropofition du plus grand nombre de#