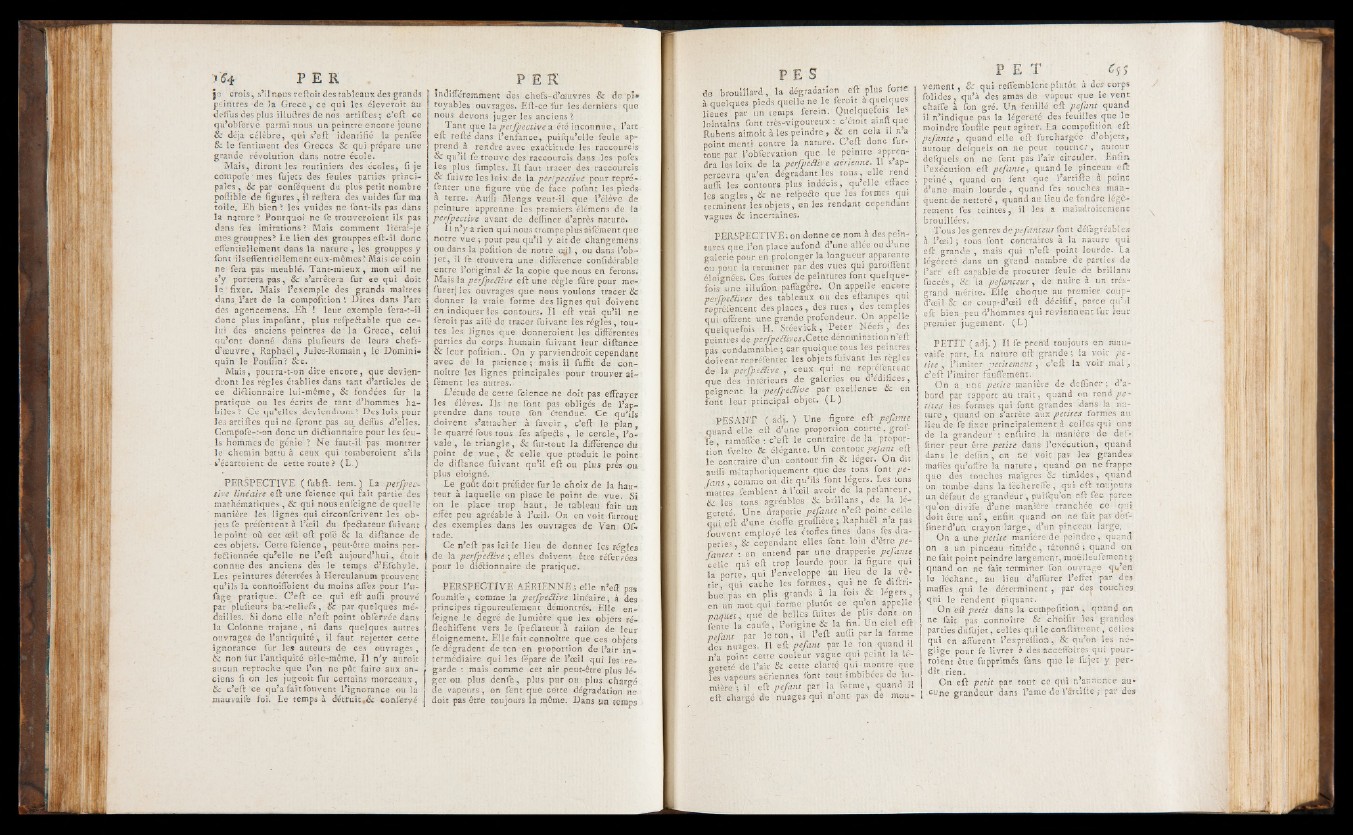
je croîs, s’ il nous reftoit des tableaux des grands
peintres de îa G rece, ce qui les éleveroit au
deffus des plus illuûres de nos artiftes; c’eft ce
qu’obferve parmi nous un peintre encore jeune
& déjà célèbre, qui s’ eft identifié la penfée
8c le fentiment des Greccs & qui prépare une
grande révolution dans notre école.
Mais, diront les routiniers des écoles, fi je
compote’ mes fujets des feules parties principales
, & par conféquènt du plus petit nombre
poflîble de figures , il reftera des vuides fur ma
toile. Eh bien ? les vuides ne font-ils pas dans
la nature ? Pourquoi ne fe trouveroient ilsr pas
dans fes imitations? Mais comment lierai-je
mes grouppes? Le lien dés grouppes eft-il donc
effentiellement dans là nature , les grouppes y
font ils effentiellement eux-mêmes? Mais ce coin
ne fera pas meublé. Tant-mieux, mon oeil ne
s’y portera pas, & s’arrêtera fur ee qui doit
le fixer. Mais l’exemple des grands maîtres
dans l ’art de la compofition i Dites dans l’ art
dès agencemens. Eh ! leur exemple fera-t-il
donc plus impofànt, plus refpe&able que celui
des anciens peintres de la Grece, celui
qu’ont donné dans plu fieu rs de leurs chefs-
d’oeuvre, Raphaël, Jules-Romain, le Domini»
quin le Pouflin? &c.
Mais, pourra-t-on dire encore, que deviendront
les règles établies dans tant d’articles de
ce dictionnaire lui-même, & fondées fur la
pratiqué ou les écrits de. tant d’hommes habités
? Ge qu’elles deviendront? Des loix pour
les artiftes qui ne feront pas au deffus d’elles.
Compofe-r-on donc un dictionnaire pour les feu-
ls hommes dé génie ? Ne faut-il pas montrer
le chemin battu à ceux qui tomberoient s’ ils
s’écartoient de cette route ? (L.)
PERSPECTIVE ( fubft. lem. ) La <pe_rfpec~
tive linéaire éft une faïence qui fait partie des
mathématiques , 8c qui nous en feigne de quelle
manière les lignés qui ci rcô nferivent les objets
fe préfentent à l’oeil du fpeélateur fuivant
le point où cet oeil eft pofé 8c la diftànce de
ces objets. Cette fcience , peut-être moins perfectionnée
Qu’elle ne l’eft aujourd’hui, étoit ■
connue des anciens dès le temps d’Efchyie. j
Les peintures déterrées à Herculanum prouvent j
qu’ ils la connoiffoient du moins affez pour Tu- I
fage pratique. C’eft ce qui eft aufli prouvé J
par plufiëurs bas-reliefs, 8c par quelques me- ]
dailles. Si donc elle n’ eft point obfervée dans j
la Colonne trajane, ni dans quelques autres
ouvrages de l’antiquité j il faut rejetter cette
ignorance fur le* auteurs de ces ouvragés,-
8c non fur l’antiquité elle-même. Il n’y aiiroit
aucun reproche que l’ on ne pût faire aux an- j
ciens fi on les jugeoit fur certains morceaux,
& c’eft ce qu’a fait fouvent l ’ ignorance ou la
mauyaife foi. Le temps à d é t r u i t c o n f e r y é
indifféremment des chefs-d’oeuvres & de pi*
toyables ouvrages. Eft-ce fur les.derniers que
nous devons juger les anciens?
Tant que la petfpective a été inconnue , Part
eft refté dans l’enfance, puifqu’elle feule apprend
à rendre avec exactitude les raccourcis
oc qu’ il fe trouve des raccourcis dans les pofes
les plus fimplès. Il faut tracer des raccourcis
8c fuivre les lcix de la per!p écrive pour représenter
une figure vue de face pofant les pieds
a terre. Aufli Mengs veut-il que l’élève de
peinture apprenne les premiers, é le mens de la
perfpective avant de defliner d’après nature.
Il n’y a rien qui nous trompe plusaifément que
notre vue ; pour peu qu’ il y ait de changemens
ou dans la pofitîon de notre oej.1, ou dans l’obje
t , il fe trouvera une différence confidérable
entre l’original & la copie que nous en ferons.
Mais la perfpective eft une règle , fûre pour me-
furerj lès ouvrages que nous voulons tracer &
donner la vraie forme des lignes qui doivent
en indiquer les contours. I l eft vrai qu’ il ne
feroit pas ai fs de tracer fuivant les régies, toutes
les. lignes que donneroient les différentes
parties du corps humain fuivant leur diftànce
& leur pofition.. On y parviendroit cependant
avec de la patience ;• mais il fuffit de connaître
les lignes principales pour trouver ai-
fement les autres.
L’étude de cette fcience ne doit pas effrayer
les élèves. Ils ne font pas obligés de H
-prendre dans toute fon etendue. Ce qu’ ils
doivent s’attacher - ;à faveir , c’eft le plan ,
le quarréfous tous fes afpeéïs , le cercle, l’ov
a le , le triangle, 8c fur-tout la différence du
point de v u e , & celle que produit le point
de diftànce fuivant qu’ il eft ou plus près ou
plus éloigné.
Le goût doit préfider fur le choix de la hauteur
à laquelle on place le point de vue. Si
on le place trop haut, le tableau fait un
effet peu agréable à l’oeil. On en voit furtout
des exemples dans les ouvrages de Van Of-
tade.
Ce n’eft pas ici le lieu de donner les régies
de îa perfpective•; elles doivent être réferyées
pour le didionnaire de pratique.
PERSPECTIVE AÉRIENNE i elle n’eft pas
folimite , comme îa perfpective linéaire, à des
principes rigoureniement démontrés. Elle en-
feigne le degré de lumière que les objets ré-
flechiffent vers le fpeélateur à raifon de leur
éloignement. Elle fait connoître que ces objets
fe dégradent de ten en proportion de l’air intermédiaire
qui les fépare de l’oeil qui les .regarde
: mais comme cet air peut-être plus léger
ou plus denfe, plus pur ou plus chargé
de vapeurs, on fent que cette dégradation ns
doit pas être toujours la même. Dans un temps
4e brouillard, la dégradation eft plus forte
à quelques pieds quelle ne le feroit a quelques
lieues par un temps ferein. Quelquefois les
lointains font très-vigoureux : c étoit ai nu que
Rubens airaoit à les peindre, & en cela il n’a
point menti contre la nature. C’ eft donc lur-
tout par l’oblefvation que. le peintre apprendra
les loix de la perfpective aérienne. Il s’ap-
percevra qu’en dégradant les tons, elle rend
aufli les contours plus indécis, qu’ elle efface
les angles , & ne rel'pecie que lés formes qui
terminent les objets, en les rendant cependant
vagues & incertaines.
PERSPECTIVE; on donne ce nom à des peintures
que.l’on place aufond d’une allée ou d une
galerie pour en prolonger la longueur apparente
ou pour la terminer par des vues qui paroiffent
éloignées. Ces fortes de peintures font quelquefois
une illufion paffagère. On appelle encore
perfpeclïves des tableaux ou des eftanipes qui
repréientent des places, des rues , des temples
qui offrent une grande profondeur. On appelle
quelquefois H. Stéevick, Peter Né efs, des
peintres de perfpcétiy,es tCsttc dénomination n eft
pas condamnable ; car quoique tous les peintres
doivent repréfenter les objets fuivant les règles
de la perfpective , ceux qui ne repréientent
que des intérieurs de galeries ou d’édifices,
peignent la perfpeétive par exellence. & en
font leur principal objet. (L )
PESANT ( adi. ) Une figure eft pefante
quand elle eft d’une proportion cou rte, greffe^
ramaffée : c’eft le contraire.de fa proportion
fveltc & élégante. Un contour pejant eft
le contraire d’ un contour fin & léger. On dit
aufli métaphoriquement que des tons font pe-
Janf , comme on dit qu’ils font légers. Les tons
"matrès fcmblent à l’oeil avoir dé la pefantéur,
& les tons agréables & brillans, de la lé-
gereté. Une draperie pefante n’ eft point celle
qui eft d’une étoffe, groflière; Raphaël n’a pus
fouvent employé les étoffes fines dans fes draperies,
& cependant elles font loin d’être pe~
fautes : on entend par une drappe.rie./te/àn«
celle: qui eft trop lourde pour la figure qui
la porte, qui l’enveloppe >aù lieu de la v êtir
, qui cache les formes, qui ne fe diftri-
bue pas en plis grands à la fois 8c légers ,
en un mot qui forme plutôt ce qu on appelle
paquet, que de belles fuites de plis dont on
fente la caufe, l’origine & .la fin. Un ciel eft !
pefant par le ton , il l’eft aufli parla forme
des nuages. Il eft pefant par le ton quand il
n’a point cette couleur vague qui peint la légèreté
de l’air & cette clarté qui montre que
les vapeurs aeriennes font tout imbibées de lumière
; il eft pefant par la forme-, quand il
eft chargé de nuages qui n’olit pas de mouvement,
& qui reffemblent plutôt à des corps
folides, qu’ à des amas de vapeur que le vent
chaffe à fon gré. Un feuille eft pefant quand
il n’ indique pas la légèreté des feuilles que le
moindre fouftle peut agiter. La compofition eft
pefante* quand elle eft furchargée d’objets*
autour delquels on ne peut tournes , autour
defquels on ne fent pas l’air circuler. Enfin
l’ exécution eft pefante, quand le pinceau eft
peiné , quand on fent que l’ artifte à peint
d’une main lourde, quand fes touches manquent
de netteté , quand au lieu de fondre légèrement
fes teintes j il les a maladroitement
brouillées.- ‘
Tous les genres de-pefcînteur fônt défagréables
à l’oeil j tous font contraires à la nature qui
eft. grande , mais qui n’eft point lourde. La
légèreté dans un grand nombre de parties de
l’ art eft capable de procurer feule de brillans
fuccès, 8c la pefantzur, de nuire a un très-
grand mérite. Elle choque au premier coup*
d’oeil 8c ce coup-d’oeil eft décifif, parce qu’ il
eft bien peu d’ hommes qui reviennent fur leur
premier jugement. (L )
PE TIT ( adj. ) Il fe prend toujours en mau-
vàife part. La nature eft grande ; la voir pe tite^
l’ imiter petitement, c ’eft la voir mal*,
c’éft l’ imiter fauffement.
On a une petite manière de defiiner ; d’abord
par rapport au trait, quand on rond p e tites
les formes qui font grandes dans la nature,
quand on s’arrête aux petites formes au
lieu de fe fixer principalement à celles qui ont
de la grandeur : enfuité la manière de def-;
finer peut être petite dans l’exécution, quand
dans le defiin , on r.e voit pas les grandes1
maffes qu’offre la nature, quand on ne frappe
que des touches maigres & timides, quand
on, tombe dans la féehereffe , qui eft toujours
un défaut de grandeur , puifiqu’on eft fec parce
qu’on -divife d’ une manière tranchée ce qui
doit être uni , enfin quand on ne fait pas def-
ftnerd’ un crayon large, d’ un pinceau large.
On au ne petite manière de peindre, quand
on a un pinceau timide , tâtonné •, quand on
ne fait point peindre largement, moëlieufement ;
quand on ne fait terminer fon ouvrage qu’en
Ile léchant, au lieu d’affurer l’effet par des
maffes qui le déterminent, par des touches
qui le rendent piquant.
On eft petit dans la compofition, quand on
ne fait pas connoître & choifir les grandes
parties dufujet, celles qui le co n ftitu en tc e lle s
qui en afférent l’expreffion, 8c qu’on les néglige
pour fe livrer à des acceffoires qui pour-
roient être fupprimés fans que le fujet y per--
dît, rien.
On eft petit par tout ce qui n’ar.ncnce au-
J cune grandeur dans l’amc de Târtifte ; par des