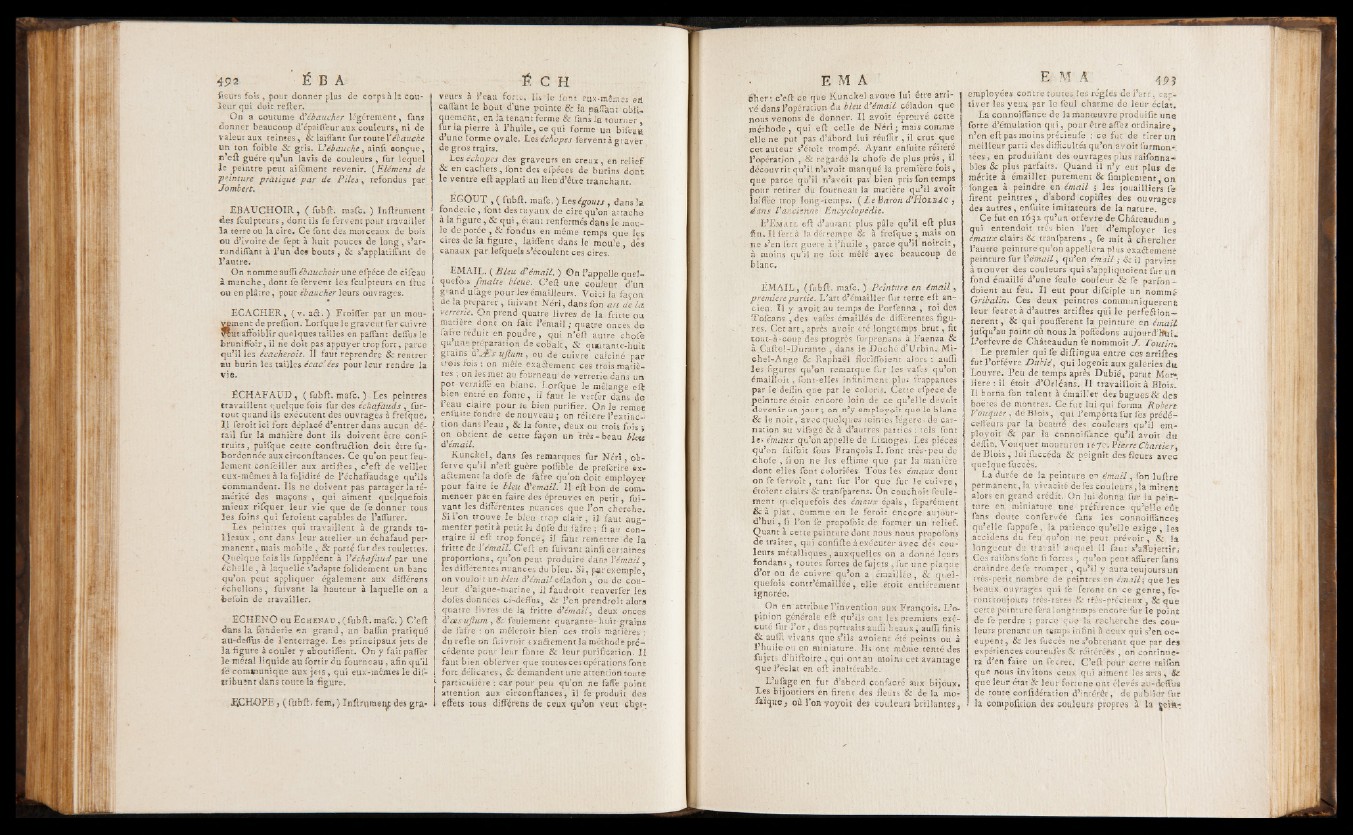
fleurs fois, pour donner plus de corps à h couleur
qui doit relier.
On a coutume ébaucher légèrement, fans
donner beaucoup d’épaifieur aux couleurs, ni de
valeur aux teintes, 8c laiffant fur toute Xébauche
un ton foible & gris. L'ébauche, ainfi conçue ,
îi’eft guère qu’un lavis de couleurs , fur lequel
le peintre peut aifément revenir. ( Elémens de
'peinture pratique par de Piles , refondus par
Jombert.
E B AU CH O IR , ( fubft. mafc, ) Infiniment
des fculpteurs , dont ils fe fervent pour travailler 3a terre ou la cire. Ce (ont dés morceaux de bois
ou d’ivoire de fept à huit pouces de lo n g , s’ar-
rondiffant à l’un des bouts , & s’applatïffant de
l ’autre.
On nomme aufli ébauchoir une efpéce de cifeau
à manche, dont fe fervent les fculpteurs en ftuc
ou en plâtre, pour ébaucher leurs ouvrages.
E CÀ CH ER , ( v. a6t. ) Froifler par un mouvement
de prefiioir. Lorfque le graveur fur cuivre
veut afFoiblir quelques tailles en paffant defïiis le
bruniffoir, il ne doit pas appuyer trop fort, parce
qu’ il les écacheroit. Il faut reprendre & rentrer
au burin les tailles écaclées pour leur rendre la
vie.
ECHAFAUD , ( fubft. mafc. ) Les peintres
travaillent quelque fois fur des échafauds , fur-
tout quand ils exécutent des ouvrages à frefque,
I l feroitici fort déplacé d’ entrer dans aucun détail
fur la manière dont ils doivent être construits,
puifque cette conftruétion doit être fu-
bordonnée auxcirconftances. Ce qu*on peut feulement
confeiller aux artiftes, e’efl de veiller
eux-mêmes à la folidité de Péchaffaudage qu’ils
commandent. Us ne doivent pas partager la témérité
des maçons , qui aiment quelquefois
mieux rifquer leur vie que de fe donner tous
les foins ,qui feroient capables de l ’aflurer.
Les peintres qui travaillent à dé grands tableaux
, ont dans leur attelier-un échafaud permanent
, mais mobile & porté fur des roulettes.
Quelque fois ils fûppléent à l'échafaud par une
échelle , à laquelle s’adapte folidement un banc
qu’on peut appliquer également aux différer.s
■ échellons, fuivant la hauteur à laquelle on a
befoin de travailler.
ECHENO ou Echenau , (fubft. mafc.) C’eft
dans la fonderie en grand, un baflin pratiqué
au-deffus de l’enterrage. Les principaux jets de 3a figure à couler y aboutirent. On y fait pafler
le métal liquide au fortir du fourneau, afin qu’il
fè communique aux je ts , qui eux-mêmes le dif-
tribuînt dans toute la figure.
ÜCHOPE y (fubft. fem, ) Inftrunieiy: des graveurs
a l’eau forte, Us le font eux-mêmes eii
caffant le bout d'une pointe & la paffant obliquement,
en la tenant ferme & fans la tourner,
fur la pierre à l ’huile, ce qui forme un bifeau
d’une forme ovale. Leséchopes fervent à gravfcr
de gros traits.
Les échopes des graveurs en creux, en relief
& en cachets , font des efpeces de burins ddiit
le ventre efl applati au lieu d’être tranchant.
ÉGOUT , ( fubft. mafc. ) Les égouts , dans la
fonderie , font des tuyaux de cire qu’on attache
a la figure, 8c q u i, étant renfermés dans le moule
de potee , & fondus en même temps que les
cires de la figure, laiflent dans le moule, des
canaux par lefquels s’écoulent ces cires.
EMAIL. ( Bleu d'émail. ) On l’appelle quelquefois
fmalte bleue. C’ eft une couleur d’un
g 1 and ufàge pour les émailleurs. Voici la façon
j de la préparer , fuivant Néri, dans fon art de la
verrerie. On prend quatre livres de la. fritte ou
matière donc on fait l ’émail ; quatre onces de
faire réduit en poudre, qui n’eft autre chofe
qu’ iinepréparation de cobalt, & quarante-huit
grains t iÆ s ujlum , ou de cuivre calciné par
trois fois : on mêle exaélement ces trois madères
; on les met au fourneau1 de verrerie dans un
pot vernifle en blanc. Lorfque le mélange eft
bien entré en fonte, i f faut le verfier dans de
i’ eau claire pour le bien purifier. On le remet
enluite fondre de nouveau ; on réitéré l’ extinc-
( tion dans l’eau , 8c la fonte, deux ou trois fois ;
on obtient de cette façon un 'très - beau bleu
à? émail.
Kunckel, dans fes remarques fur N é r i, ob-
ferve qu’ il n’eft guère poffible de preferire exactement
la dofe de faire cju on doit employer
pour faire le bleu à'email. I l eft bon de commencer
par en faire des épreuves en petit, fuivant
les différentes nuances que l’on cherche.
Si 1 on trouve le bleu trop c la ir , i l faut augmenter
petit à petit k dofe du faire : fi au contraire
il eft trop foncé, il faut remettre de la
fritte de Témail. C’eft en fuivant ainfi certaines
proportions, qu’on peut produire dans Vémail,
les différentes nuances du bleu. Si, par exemple,
on voujoît un bleu, d5émail céladon , ou de couleur
d’aigue-marine, il faudroit renverfer les
dofes données ci-deffus, & l’on prendroit alors
quatre livres de la fritte à'émaily deux onces
d’oes ujlum , & feulement quarante-huitgrarns
de fafre : qn mêleroit bien ces trois matières :
du refte on fuivroir exaélement la méthode précédente
pour leur fonte & leur purification. Il
faut bien obferver que toutes ces opérations font
fort délicates, & demandent une attention toute
particulière : car pour peu qu’on ne fa fie point
attention aux circonftances, il fe'produit des
effets tous différens de ceux qu’on veut ch$j>
é W : c’eft ce que Kunckel avoue lui être arrivé
dans l’opération du bleu à.’émail céladon que
nous venons de donner. I l avoir éprouvé cette
méthode , qui eft celle de Néri ; mais comme
elle ne put pas d’abord lui réuffir , il crut que
cet auteur s’étoît trompé. Ayant enfuite réitéré
l ’opération., & regardé la choie de plus près, il
découvrit qu’ il n’avoit manqué la première fois,
que parce qu’ il n’ avoit pas'bien pris fon temps
polir retirer du fourneau la matière qu’ il a voit
laiffee trop long-temps. ( Le Baron d'HoLüAC y
dans l'ancienne Encyclopédie.
L’Email eft d’aurant plus pâle qu’ il eft plus
fin .U fe r tà la détrempe 8c à frefque ; mais on
ne s’en fert guère à l’huile , parce qu’ il noircit,
à moins qu’il ne foit mêlé avec beaucoup de
blanc*
ÉMAIL, (fubft. mafc. ) Peinture en ém a il,
première partie. L’ art d’émailler fur terre eft ancien.
I l y avoit au temps de Porfenna , roi des
Tofcans , des vafes émaillés de differentes figures.
Cet art, après avoir été longtemps b rut, fit
tout-à*coup des progrès furprepans à Faenza &
à Cafteî-Durante , dans le Duché d’Urbin. Michel
Ange 8c Raphaël floriffoient alors : aufli
les figures qu’on remarque fur les vafes qu’on
émail!oit 4 font-elles infiniment plu* frappantes
par le deflin que par le coloris. Cette efpece de
peinture écoic encore loin de ce qu’elle devoit
devenir un jour ; on n’y etnployoît que le blanc
& le noir, arec quelques teintes îêgerè ; de car- .
nation au vifagé & à d’autres paities : tels font
les émaux qu’on appelle de. Limoges. Les pièces
qu’on faifoit fous François I. font très-peu de
chofe , lion ne les eftime que par la manière
dont elles font coloriées. Tous les émaux dont
on fe fer v o it , tant fur l’or que fur le cuivre,
étoierst clairs'& tranfparens. On couchoit feulement
quelquefois des émaux épais, leparément
& à p la t, comme on le feroit encore aujourd’hui
, fi l'on fe propofoit .de former un relief.
Quant à cette peinturé dont nous nous propofons
de traiter, qui confifte à exécuter avec dés couleurs
métalliques , auxquelles on a donné leurs
fondans, toutes fortes de fujets , fur une plaque
d’or ou de cuivre qu’on a émaillée, 8c quelquefois
contr’émaillée, elle étoit entièrement
ignorée.
On en "attribue l’invention aux François. L’opinion
générale eft qu’ils ont les premiers exécuté
fur l’or , des, portraits aufli beaux ; aufli finis
& aufli vïvans que siils a voient été peints ou à
l ’huile ou en miniature. Ils ont même tenté des
fujets d’hiftoire , qui ont au moins cet avantage
que l’éclat en eft inaltérable.
L’ tifage en fur d’abord confacré aux bijoux.
Les bijoutiers en firent des fleurs 8c de la mot
la ïq ue , où l ’on yoyoit des couleurs brillantes,
employées contre tou te lle s régies de l’arc, captiver
les veux par le feul charme de leur éclat.
La connoiffance de la manoeuvre produifit une
forte d’émulation qui , pour être affez ordinaire,
n’ en eft pas moins précieufe : ce fut de tirer un
meilleur parti des difficultés qu’on a voit furmon-,
tées, en produifant des ouvrages plus raifonna-
blés & plus parfaits. Quand il n’y eut plus de
mérite à émailler purement & Amplement, on
fongea à peindre en émail j les jouailiiers fe
firent peintres, d’abord copiftes des ouvrages
des autres, enfuite imitateurs de la nature.
Ce fut en 1632. qu’un orfevre de Châreaudun *
qui entendoit très bien l’art d’employer les
émaux clairs 8c tranfparens , fe mît à chercher
l’autre peinture qu’on appellera plus exaélement
peinture fur l'émail, qu’en émail ; 8c il parvint
à trouver des couleurs qui s’appliquoient fur un
fond émaillé d’une feule couleur & fe parfon-
doient au feu. I l eut pour difciple un nommé
Gribalin. Ces deux peintres .communiquèrent
leur fecret à d’autres artiftes qui le perfe&ion—
nerent, & qui pouffèrent la peinture en émail
jufqu’au point où nous la poffedons aujourd’hPui-
L’orfevre de Châteaudun fe nommoit J. TouiïjK
Le premier qui fe diftingua entre ces artiftes
fut l’orfévre Dubié, qui logeoit aux galeries du
Louvre. Peu de temps après Dubié, parut Mor*
liere : il étoit d’Orléans. I l travailloit à Blois.
Il borna fon talent à émail 1er des bagues & des
boëres de montres. Ce fut lui qui forma Robert
Vouquer. de Blois, qui l’emporta fur fes prédé-
cëffèurs par la beauté des couleurs qu’ il em-
ployoit & par la connoiffance qu’il avoir du
deflin. Vouquer mourut en 1670. Vierre Chartier y
de Blois , lui fuccéda 8c peignit des fleurs avec
quelque fuccès.
La durée de la peinture en ém a il, fon luftre
permanent, la vivacité de fes couleurs ,1a mirent
alors en grand crédit. On lui donna fur la peinture
en miniature une préférence qu’elle eût
fans doute confervée fans les eonnoiffances
qu’elle fuppofe, la patience qu’elle exige , les
accidens du feu qu’ on ne peut prévoir, & la
longueur du travail auquel il faut s’affujettifi
Ces raifonsfont fi fortes , qu’on peut aflurer fans
craindre de fie tromper , qu’ il y aura toujours un
très-petit nombre de peintres en émail; que les
I beaux ouvrages qui fe feront en ce genre, fe-
j ront toujours très-rares 8c très-précieux , & que
cette peinture fera longtemps encore fur le point
de fe perdre ; parce que la recherche des couleurs
prenant un tsmps infini à ceux qui s’ en, occupent,
& les fuccès ne s’obtenant que par des
expériences coureufes & réitérées , on continuera
d'en faire un fecret. C ’eft pour cette raifon
que nous invitons ceux qui aiment les arts, 8c
que leur état & leur fortune ont édevés au-deffus
de toute confidératîon d’ intérêt, de publier fur
la compofiçion des couleurs propres a la gem