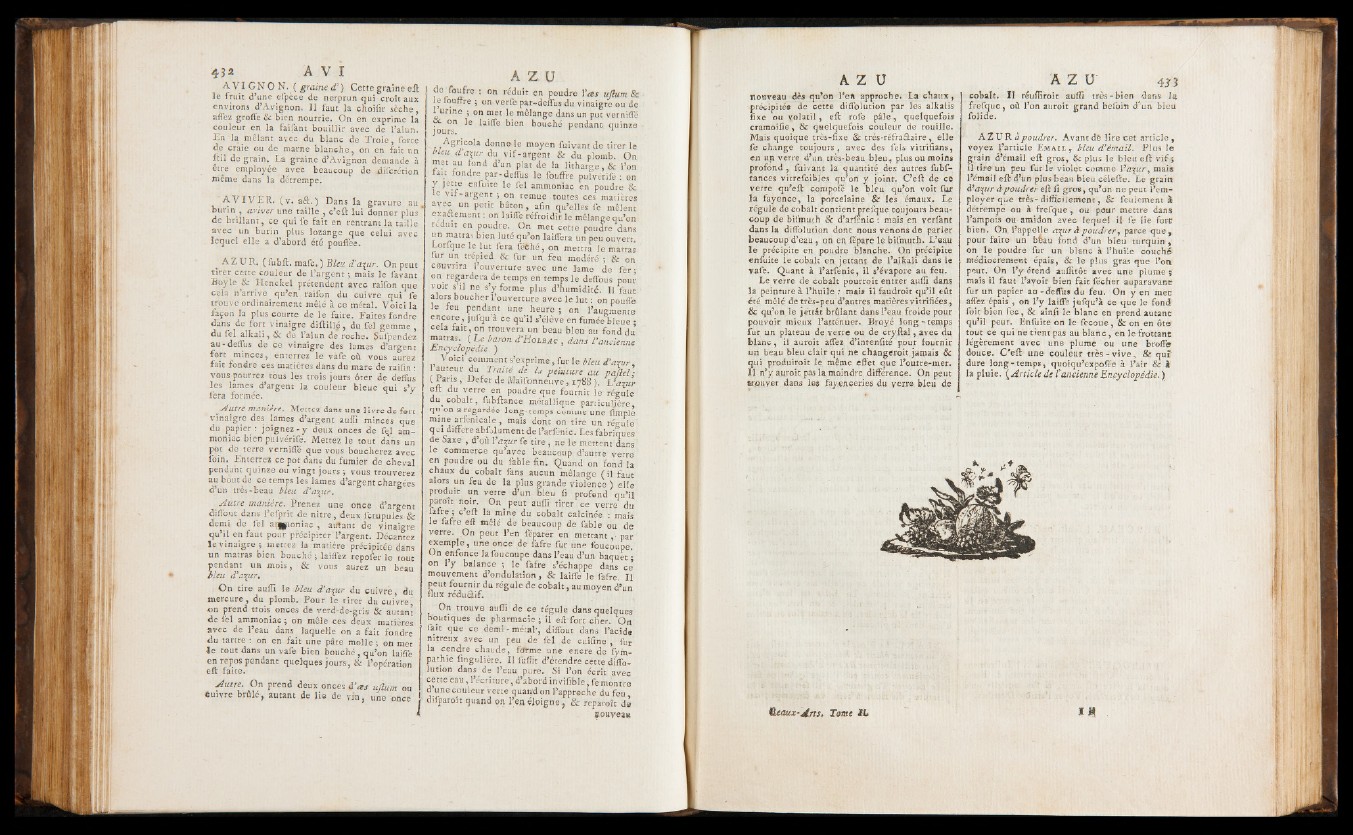
A V I G N O N. ( graine d‘ ) Cette graine eft
le fruit d’une efpcee de nerprun qui croît aux
environs d’Avignon. Il faut la choifir sèche,
allez groffe & bien nourrie. On en exprime la
couleur en la faifant bouillir avec de. l’alun.
En la mêlant avec du blanc de Troie, forte
de craie ou de marne blanche, on en fait un
it il de grain. La graine d’Avignon demande à
être employée avec beaucoup de dilcrétion
même dans la détrempe.
A " ^ V E R . ( v . a f t .) Dans la gravure au,
burin , aviver une taille , c’eft lui donner plus
de brillant, ce qui fe. fait en rentrant la taille
avec un burin plus lozange que celui avec
lequel elle a d’abord été pouffee.
, A Z U R . ( fubfl. mafc. ) Bleu d'azur. On peut
tirer cette couleur de l ’argent ; mais le lavant
B'oyle & Henckel prétendent avec raifon que
cela n’arrive _ qu’en raifon du cuivre qui le
trouve ordinairement mêlé à ce métal. Voici la
façon la plus courte de le faire. Faites fondre
dans de fort vinaigre d iftillp , du fel gemme,
du fel alkali, & de l’alun de roche. Sulpendez
au-deffus de ce vinaigre des lames d’argent
fort minces, enterrez le vàfe où vous aurez
fait fondre ces matières dans du marc de raifin :
vous pourrez tous les trois jours ôter de deffus
les lames d’argent la couleur bleue qui s’y
fera formée. ‘ - ~~
Autre manière. Mettez dans une livred e fart
vinaigre des lames d’argent auffi minces que
du papier: jo ig n e z -y deux onces de fel ammoniac
bien pulvérifé. Mettez le tout dans un
pot de terre verniffé que vous boucherez avec
foin. Enterrez ce pot dans du fumier de cheval
pendant quinze ou vingt jours ; vous trouverez
au bout de ce temps les lames d’argent chargées
d’ un très-beau bleu d’a\ur.
Autre manière. Prenez une once d’ argent
diffout dans l’efprit de nitre, deux fctupules &
demi de fel aijjioniac , autant dé vinaigre
qu’ il en faut pour précipiter l’argent. Décantez
le vinaigre ; mettez la matière précipi'tée.dâns
un matras bien bouché ; laiifez repofer le tout
pendant un mois, & vous aurez un beau
Heu d’a-çtr.
On tire auffi le bleu d’azur du cuivré, du
mercure, du plomb. Pour le tirer du cuivre'
on prend trois onces de verd-de-gris & autant
de fel ammoniac ; on mêle ces deux matières
avec de l’eau dans laquelle on a fait fondre
du tartre : on en fait une pâte molle ; on met
l e tout dans un vafe bien bouché , qu’on laide
en repos pendant quelques jours, & l’opération
eff faite.
Autre. On prend deux onces i ’ats ujlum ou
fcuiyre brûlé, autant de lie de v in , une once
' on réduit en poudre Vas ujhim 8c
le loufrre ; on verfe par-deffus du vinaigre ou de
1 urine ; on met le mélange dans un pot verniffé
on le laiffe bien bouché pendant quinze
jours. 1
^ c ° la donne-le moyen fuivant de tirer le
bleu d’azur du vif-argent & du plomb. On
met au fond d’un plat de la litharge, & l’on
fait fondre par-deffus le fouffre pulvérifé : on
y jette enfuite le fel ammoniac en poudre &
e v if-argen t ; on remue toutes ces matières
avec un petit bâton, afin qu’elles fe mêlent
exactement : on laiffe refroidir le mélange qu’on
réduit en poudre. On met cette poudre dans
un matras bien juté qu’on laiffera un peu ouvert.
Lorfque le lut fera féêhé, on mettra le matras
fur un trépied & fur un feu modéré -, & on
couvrira l’ouverture avec une lamo de fer ;
°n. regardera de temps en temps le deffous pour
voir s’il ne s’y forme plus d’humidité. Il faut
alors boucher l’ouverture avec le lut : on pouffe
le feu pendant fine heure ; on l’augmente
encore, jufqu’à ce qu’il s’élève en fumée bleue ;
cela fait, on trouvera un beau bleu au fond du
matras. ( Le baron iI’Holbac , dans Vancienne
JtLncyclopedie. )
Voici comment s’exprime, fur le bleu i ’axur ,
; auteur du Traité de U peinture au pa/lel:
<• a T * Defer üM a ifo n n eu v e , 1788 ). Va-yir
eit du verre en poudre que fournit le' régule
du cobalt, fubftance métallique particulière
qu on a regardée long-temps comme une {impie
mine arfénicale , mais dont on tire un régiiie'
qui différé absolument de l’arfénic. Les fabriques
de Saxe , d’ où l’azur fe tire , ne le mettent dans
le commerce qu’avec beaucoup d’autre verre
en poudre ou du fable fin. Quand on fond la
chaux du cobalt fans aucun mélange ( il faut
alors un feu de la plus grande violence ) elle
produit un verre d’un bleu fi profend qu’il
parolt noir. On peut auffi tirer , ce verre du
faire ; c’eft la mine du cobalt calcinée : mais
le fafre efl mêlé de beaucoup de fable ou de
verre. On peut l’en féparër en mettant, par
exemple, une once de lafre fur une fbucoupe.
On enfonce iafoucoupe dans l’eau d’un baquet -
on l ’y balance ; le fafre s’échappe dans ce
mouvement d’ondulation, 8c laiffe le fafre. I l
peut fournir du régule de cobalt, au moyen d’un
flux réduéfif.
On trouve auffi de ce régule dans quelques
boutiques de pharmacie ; il efl fort cher. On
fait que ce demi - métal-, diffout dans l’acide
nitreux avec un peu de' fel de cuifine , fur
la cendre chaude, forme une encre de iym-
pathie fingulière. Il fiiffit d’ étendre cette diffo-
. lution dans de l’eau pure. Si l’on écrit avec
; cette eau, l’écriture, d’abord in vifible, fe montre
d’une couleur verte quand on l’approche du feu
I difparoît quand on l’en élpigne, & reparoît de
k pouvea»
nouveau dès qu’on l’eft approche. La chaux,
précipitée de cette diffolution par les alkalis
fixe ou v o la til, efl: rofe pâle, quelquefois
cramoifie, 8c quelquefois couleur de rouille.
Mais quoique très-fixe & très-réfraéiaire, elle
fe change toujours, avec des Tels vitrifians,
en un verre d’ un, très-beau bleu, plus ou moins
profond , fuivant la quantité des. autres fubf-
tances vitrefçibles qu’ on y joint. C’eft de ce
verre qu’eft compofe le bleu qu’on voit fur
la fayence, la porcelaine & les émaux. Le
régulé de cobalt contient prefque toujours beaucoup
de bilmuth 8c d’arfenic : mais en verfant
dans la diffolution dont nous venons de parler
beaucoup d’eau , on en fepare le bifmuth. L’eau
le précipite en poudre blanche. On précipite
enfuite le cobalt en jettant de l’alkali dans le
vafe. Quant à l’arfenic, il s’évapore au feu.
Le verre de cobalt pourrait entrer auffi dans
la peinture à l’huile.: mais il faudrait qu’ il eût
^té mêlé de très-peu d’autres matières vitrifiées ,
& qu’on le jéttât brûlant dans l’eau froide pour
pouvoir mieux l’atténuer. Broyé long-temps
fur un plateau de verre ou de c ryftal, avec du
blanc, il aurait affez d’intenfité pour fournir
un beau bleu clair qui ne changeroit,jamais &
qui produirait le même effet que l’outre-mer.
I l n’y auroit pas la moindre différence. On peut
trouver dans les faycnceries du verre bleu de
cobalt. Il réuffiroit auffi très-bien flans la
frefque, où l ’on aurait grand befoin d'un bleu
folide.
A Z U R à poudrer. Avant dè lire cet article ,
Voyez l’article Email, bleu d’émail. Plus le
grain d’émail eft gros, & plus le bleu eft v if $
il tire un peu fur ie violet comme 1 ’ üT[ur, mais
l’émail eft d’ün plus beau bleu célefte. Le grain
d’<z$7/r à poudrer eft fi gros, qu’ on ne peut l’employer
que très-difficilement, 8c feulement à
détrempe ou à frefque, ou pour mettre dans
l ’ampois ou amidon avec lequel il fe lie fore
bien. On. Eàppelle a-$iir à poudrer, parce que ,
pour faire un beau fond d’ un bleu turquin ,
on le poudre fur un blanc à l?huile couché
médiocrement épais, & le plus gras que l’on
peut. On l’y étend auffitôt avec une plume ?
mais il faut l ’ayoîr bien fait fécher auparavant
fur un papier au -deffus du feu. On y en mec
affez épais , on l’y laiffe jufqu’ à ce que le fond
foit bien fe c , 8c ainfi le blanc en prend autant
qu’ il peut. Enfuite on le fecoue, & on en ôte
tout ce qui ne tient pas au blanc, en le frottant
légèrement avec une plume ou une broffe
douce. C ’eft une couleur t r è s - v iv e , & quî
dure long-temps, quoiqu’ expofée à l’air & à
la pluie. {Article de Vancienne Encyclopédie. )
&taux-4ris. Tome IL I 3