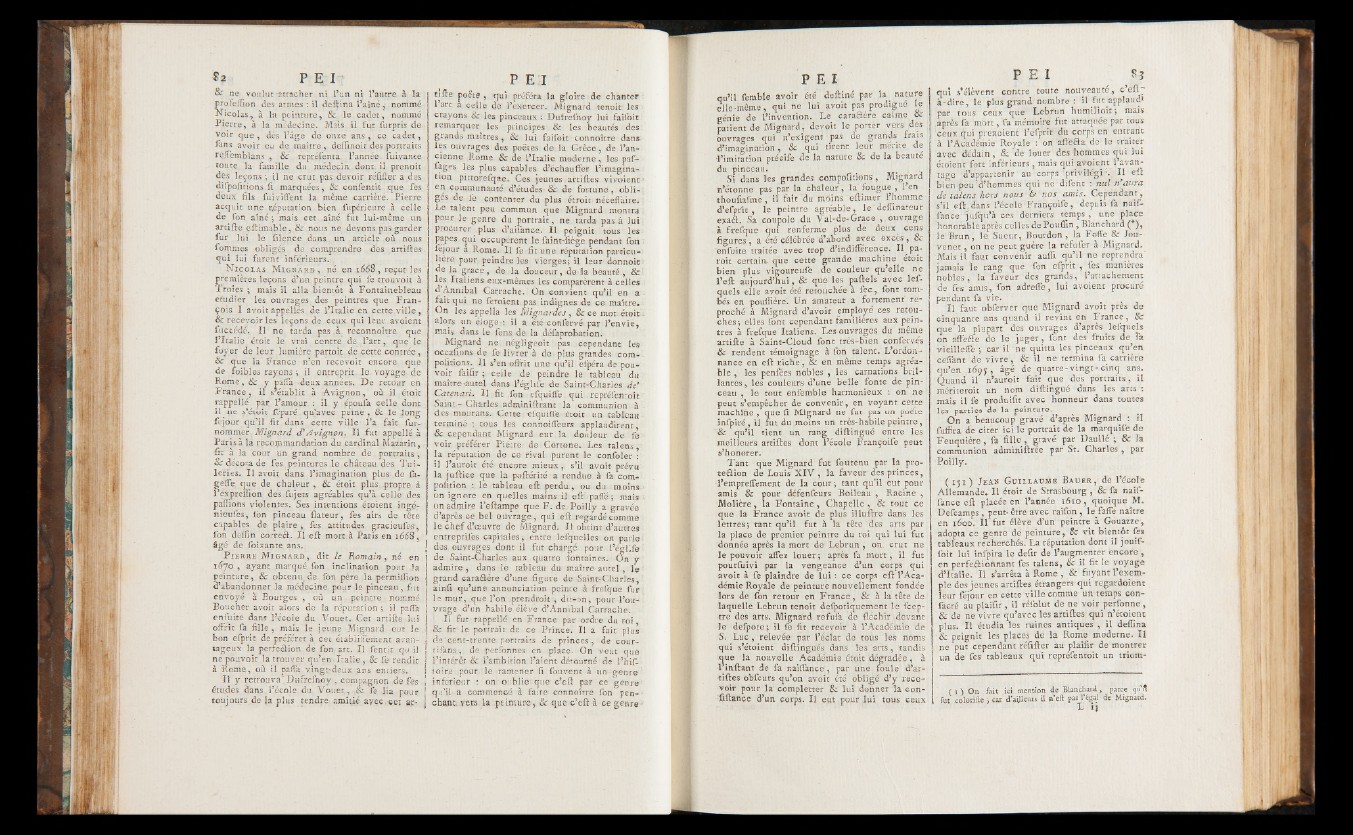
& ne voulut attacher ni l’ un ni l’autre à la
profeffion des armes : il deftina l ’aîné, nommé
Nicolas, à la peinture, & le cadet, nommé
P’ierre, à la médecine. Mais il fut furpris de-
voir q u e , dès l’âge de onze ans, ce cad et,
fans avoir eu de maître, deflinoit des .portraits
refiemblans ., 8c représenta l’année fui vante
toute la famille du médecin dont, il prenoit
des leçons-, il né crut,pas,devoir réfiüer à des
difpofitions fi marquées, & corifentit que fes
deux fils fuiviffent la même carrièré., Pierre
acquit une réputation bien fupérieure à celle
de fon aîné -, mais cet. aîné fut lui-même un
artifte eftimable, & nous ne devons pas garder
fur lui le fil en ce dans,, un article où nous
fommes obligés de comprendre des artiftes
qui lui furent' inférieurs. .
N ico la s . Mig n a r d , né en 1668, reçut les
premières leçons d’un peintre qui fe trou voit à
Proies ; mais il alla bientôt à Fontainebleau
etudier les ouvrages des peintres que François
I avoit appelles, de l’Italie.en cette.ville,
& recevoir fes leçons de ceux qui leur avoient
fiiçcédé. Il ne tarda pas à. reconnaître que
l ’ Italie étoit le vrai centre d e .l’ar t, que le
foyer de leur lumière .partoit de cette contrée,
& que la France n’ en recevoit encore que
de foibles rayons -, il entreprit , le voyage de
Rome, & y pafia deux années. De retour en
F ran c e , il s’établit à Avignon, où il étoit
rappelle par l’amour : il y époufa çell.e dont
il ne s’étoit féparé qu’avec peine, & Je clorrg
féjour_ qu’il fit dans cette v ille l ’a fait fur-
nommer Mignard d?Avignon. Il fu t appellé à
Paris à la recommandation du cardinal Mazarin,
fit à la cour un grand nombre de portraits,
8c décora de fes peintures le château des T u ileries.
Il avoit dans l’ imagination plus de Page
fie, que de chaleur , 8c étoit plus propre à
l ’expreffion dés. lu jets agréables qu’à celle des
pafijons violentes. Ses intentions étoient ingé-
niéufes, lbn pinceau flateur, fes airs de tête
capables de plaire, fes attitudes gracieufes,
fon deffin correâ. I l e ft mort à Paris en 1668,
âgé de foixante ans..
Pierre Mignard, dit le Romain, né en
167.0 , ayant marqué fon inclination pour la
peinture, 8c obtenu de. fon père, la permillion
d’abandonner la médecine pour le pinceau, fut
envoyé à Bourges , où un peintre nommé
Boucher avoit alors de la réputation ; il pafia
enfuite dans l’école du. Vouet. Cet artifte lui
offrit fa fille , mais le jeune Mignard eut le
bon efprit de préférer, à cet établifiement avantageux
la perfection de fon art. Il fentit qu.il
ne pouvoit la trouver qu’en Italie , & fe rendit
à Rome, où il pafia vingt-deux ans entiers.
I l y retrouva' Dufrefnoy , compagnon de fes ■
études dans, l’école du Vouet., - 8c fe lia pour
toujours de la plus tendre .amitié.avec,cet artifte
poète , qui préféra la gloire de chanter
lare à celle dé l’exercer. Mignard tenoif les
crayons & les pinceaux ; Dufrefnoy lui faifoit
remarquer les principes & les beautés des
grands maîtres , 8c lui faifoit connoître dans
les ouvrages des poètes de là Grèce, de l’ancienne
Rome 8c de l’ Italie moderne, les paf-
'fag.es 1 es plus capables d’échauffer l’imagination
pittorefqae. Ces jeunes artiftes vivoient
en communauté d’études & de fortune, obliges
de le contenter du plus étroit néceflàire.
i--e talent peu commun que Mignard montra
pour le genre du portrait, ne tarda pas à lui
piocurer plus d’aifance. I l peignit tous les
papes qui occupèrent'le faint-^fiège pendant fon
lejour a Rome. Il fe fit une; réputation partie it-
lièrê: pour peindre les vierges, il leur donnoit
de la grâce, de la douceur, de la beauté, &
les Italiens euxamêmes les comparèrent à celles
d Annibal Carrache. On convient qu’ il en a
fait qui ne feroient. pas indignes de ce maître.
On les appelle les Mignardes, & ce mot. étoit
alors un éloge-; il a. été confervéi par l’envie,
mais dans le fens.de la dél’aprobation.
Mignard ne négligeoit pas cependant les
occafions de fe livrer à de.- plus grandes, com-
pofitions. Il s’en offrit une qu’ il efpéra de pouvoir
faifir - celle de peindre le tableau du
maître-autel dans l’églife de Saint-Charles de*
Catenari. I l fit fon efquifie qui . repréfentoit
, Saint - Charles adminiftrant la communion à
des mourans. Cette efquifTe-.étoit un tableau
; terminé ; tous les. connoifleurs applaudirent,
& cependant Mignard eut. la douleur de- fe
voir préférer Piètre deiCortone. Les talens,
la réputation de ce rival purent le confoler ;
il l’auroit été encore mieux, s’il avoit prévu
la juftice que la poftérité a rendue à fa com-
pofition : le tableau eft perdu., ou du moins
on ignore en quelles mains il eft .pafie;;. mais
on admire l’eftampe que F. de. Poilly a gravée
d’après.ce.bel ouvrage, qui .èft regardé comme
le chef d’oeuvre de Mignard. I l obtint d’autres
entreprilés capitales, .entre lefqueiles on parle
J des, ouvrages dont il fut chargé .pour .l’églife
de Saint-Charles aux quatre fontaines. - On y
admire, dans le tableau du maître-autel , le
grand caraâère d’ une figure de Saint-Charles,
ainfi qu’une annonciation peinte à frefque fur
le mur, .que l’on ..prendroitdiï>on, pour l’ouvrage
d’un habile élève d’Annibal Carrache.
Il fut rappelle en France par ordre du r o i,
8c fit le portrait de ce Prince. Il a fait plus
de'cent-trente portraits de princes, de cour-
tifans, de per l’on nés. en place. On veut que
l’ intérêt 8c l’ambition l’aient détourné de l’hif.
toire pour le ramener fi fouvent à un genre
i inférieur ; on oublie que' c’eft par ce genre
] qu’il a commencé à faire connoîrrè fon pen-
| ch an tie rs la .peinture, 8c que c’eft à ce genrequ’
il femble avoir été deftiné par la nature
elle-même, qui ne lui avoit pas prodigué le
génie de l’invention. Le caraélère calme &
patient de Mignard, devoit le porter vers des
ouvrages qui n’exigent pas de grands frais
d’imagination , & qui tirent leur mérite, de .
■ l’imitation précité de la nature Sc de la beauté
du pinceau. t .
Si dans les grandes compofitions, Mignard
n’étonne pas par la chaleur, la fougue , 1 en
thoufiafme, il -fait du moins eftimer l’homme-
d’efprlt , le peintre agréable , l e ’ defiinateur
exaét. Sa coupole du Val-de-Grace , . ouvrage
à frefque qui renferme plus de deux cens
figures, a été célébrée d’abord avec excès, 8c
enfuite traitée avec trop d’ indifference. I l pa-
roit certain- que cette grande machine étoit
bien plus vigoureufe de couleur qu’elle ne ■
l ’eft aujourd’h u i, 8c que les çaftels avec lef-
quels elle avoit été retouchée a fe c , font tombés
en poufiièré. Un amateur a fortement ré~
proché à Mignard d’avoir employé ces retouches;
elles font cependant familières au£ peintres
à frefque Italiens. Les ouvrages du même
artifte à Saint-Cloud font très-bien confervés
8c rendent, témoignage à fon talent. L’ordonnance
en eft riche, oc en même temps agréât
b l e , les penfées nobles , les carnations brillantes
, les couleurs d’une belle fonte de pinceau
, le tout enfemble harmonieux ; on ne
peut s’ empêcher de convenir, en voyant cette
machine , que fi Mignard ne fut pas un poète
infpiré , il fut. du .moins un très-habile peintre,
& qu’il tient un rang diftingué entre les
meilleurs artiftes dont l’école Françoife peut
s’honorer.
Tant que Mignard fut foutenu par la protection
de Louis X I V , la faveur des princes,
-l’empreffément de la cour; tant qu’il eut pour
amis & pour défenfeurs Boileau , Racine ,
Molière, la Fontaine, Chapelle, & tout ce
que la France avoit de plus illuftre dans les
lettres; tant qu’ il fut à la tête des arts par
la place de premier peintre du roi. qui lui fut
donnée après la mort de Lebrun , on. crut ne
le pouvoir afiez louer ; après fa mort, il fut
pourfuivi par la vengeance d’un corps qui
avoit à fe plaindre de lui : ce corps eft l’Académie
Royale de peinture nouvellement fondée
lors de fon retour en France, & à la tête de
laquelle Lebrun tenoit defpotiquêment le feep-
tre des arts. Mignard refufa de fléchir devant
le defpote ; il fe fit recevoir à l ’Académie de
S. L u c , relevée par l’éclat de tous les noms
qui s’étoient diftingués dans les arts, tandis
que la nouvelle Académie étoit dégradée, à
l’ inftant de fa naiflànce, par une foule d’ar-
tiftes obfcurs qu’on avoit été obligé d’y recevoir
pour la completter & lui donner la con-
fiftançe d’ un corps. I l eut pour lui tous ceux
qui s’élèvent contre toute nouveauté., c’ eft7
à-dire, le plus grand nombre : il fut applâud1
par tous ceux qde Lebrun hiimilioit; mais
.après fa mbrt, fa mémoire fut attaquée par tous
ceux qui prenoient l’efprit du corps en entrant
à l’Académie Royale ; on aftéêla de le traiter
avec dédain, & de louer des hommes qui lui
étoient'fort inférieurs, mais qui avoient l’avantagé
d’ appartenir ' au : corps "privilégia. U eft
bien peu 'd’ hommes qui ne difent : nul n’aura
de talens hors nous 6* nos amis. Cependant,
s’il eft.dans l’école Françoife, depuis fa naif-
fanCe jufqu’ à ces derniers temps, une place
honorable après celles de Pouflin, Blanchard (*),
le 'Brun, le Sueur, Bourdon, la Foffe & Jou-
y en e t, on ne peut guère la refufer a Mignard.
Mais il faut convenir aufii qu’ il ne reprendra
jamais le rang que fon efprit , fes manières
nobles, la faveur des grands, l ’attachement
de fes amis, fon adreffe, lui avoient procuré
pendant'fa vie.
I l faut obferver que Mignard avoit près de
cinquante ans quand il revint en France, &
que la plupart des ouvrages d’après, lefquels
on àftè&e dé le juge r, font des fruits de fa
viëiilefie ; car il ne quitta les pinceaux qu’en
cefiant de vivre , & il ne termina fa carrière
qu’en ,i6 ç j , âgé de .quatre-vingt-cinq ans.
Quand il n’auroit fait que des portraits, il
mériteroit lin nom diftingué - dans les arts t
mais il fe produifit avec honneur dans toutes
les parties de la peinture.
On a beaucoup gravé d’après Mignard : il
fuffira de citer ici le portrait de la marquife de
Feuquière, fa fille , gravé par Daullé ; & ïâ
communion adminiftree par St. Charles , par
Poilly.
( 1 5 1 ) Jean Guillaume Bauer, de l ’école
Allemande. I l étoit de Strasbourg, & fa naif-
fance eft placée en l’aanée 1610, quoique M.
Defcamps , peut-être avec raifon , le fafie naître
en i6qo. I l fut élève d’un peintre à Gouazze,
adopta ce genre de peinture, 8c v it bientôt fes
tableaux recherchés. La réputation dont il jouif-
foit lui infpira le defir de l’ augmenter encore ,
en perfectionnant fes talens, 8c il fit le voyage
d’Italie. I l s’arrêta à Rome , 8c fuyant l’ exemple
des jeunes artiftes étrangers qui regardoient
leur féjour en cette v ille comme un temps con-
facrë au plaifir , il réfolut de ne voir perfonne,
& de ne vivre qu’avec les artiftes qui n’étoient
plus. Il étudia les ruines antiques , i l deflina
& peignit les places de la Rome moderne. I l
ne put cependant réfifter au plaifir de montrer
un de fes tableaux qui repréfentoit un triom-
( 1 ) On fait ici mention de Blanchard, parce qu i!
fut colorifte 3 car d’ailleurs il »’eft pas l’égal de Mignard.
L i j