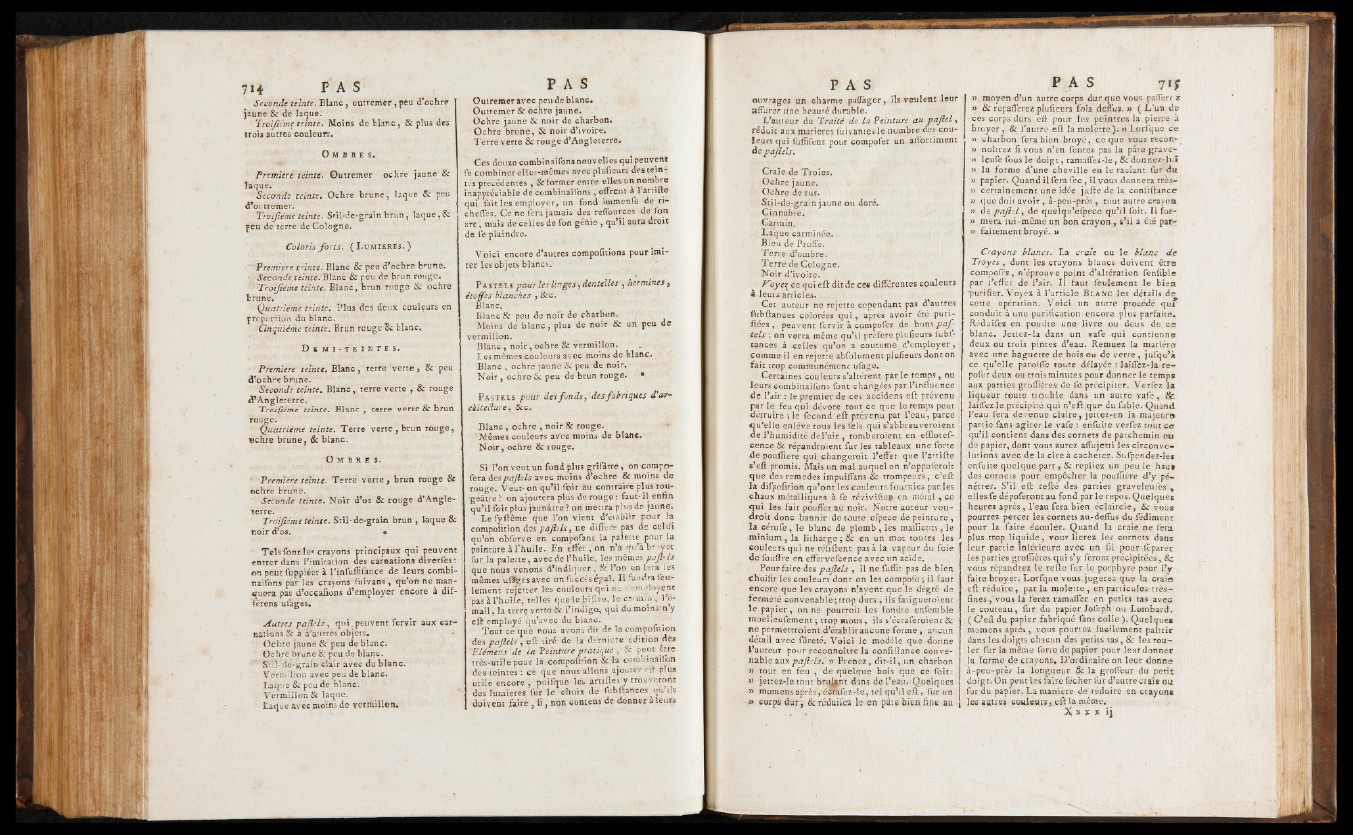
7 1 4 P A S
Seconde teinte. Blanc, outremer,peu d’ochre
jaune & de laque. Troifiéme teinte. Moins de blanc, & plus des
trois autres couleurs.
O m b r e s .
Première teinte. Outremer ochre jaune &
laque. Seconde teinte. Ochre brune, laque & peu
d’outremer. Troijiéme teinte. Stil-de-grain brun, laque, &
peu de terre de Cologne.
Coloris forts. ( L umières. )
Première teinte. Blanc & peu d’ ochre bmne.
■ 'Secondeteinté. Blanc & peu de brun rouge.
' Troijiéme teinte. Blanc, brun rouge & ochre
brune. Quatrième teinte. Plus des deux coulçurs en
proportion du blanc. Cinquième teinte. Brun reuge & blanc.
D e m i - t e i n t e s .
Première teinte. Blanc, terre verte , & peu
d’ochre brune. Seconde teinte. Blanc, terre verte , & rouge
d’Angleterre. Troifiéme teinte. Blanc , terre verte & brun
rouge. Quatrième teinte. Terre verte , brun rouge,
ochre brune, & blanc.
O m b r e s .
- Première teinte. Terre v e r te , brun rouge &
ochre brune. Seconde teinte. Noir d’os & rouge d’Angleterre.
Troijiéme teinte. Stil-de-grain brun , laque &
noir d’os. •
Tels fbnt-le* crayons principaux qui peuvent
entrer dans l’ imitation des carnations diverfes *.
o-n peut fuppléer à l’ infuffilànce de leurs combinations
par lèà crayons fuivans , qu’on ne manquera
pas d’occafions d’ employer encore a dif-
férens ulages.
Autres pajlels, qui peuvent feryir aux carnations
& à d’antres objets. *
Ochre jaune & peu de blanc.
Ochre brune & peu de blanc.
S: il-dé-grain clair avec du blanc.
Verm’Iîon avec peu de blanc.
Laque & peu de blanc.
Vermillon & laque.
Laque ayee moins de vermillon*
Outremer avec peu de blanc*
Outremer & ochre jaune.
Ochre jaune & noir de charbon.
Ochre brune, & noir d’ ivoire.
Terre verte & rouge d’Angleterre.
Ces douze combinaifons nouvelles qui peuvent
fe combiner elles-mêmes avec plusieurs des teintes
précédentes , & former entre elles un nombre
inappréciable de combinaifons , offrent a l artifte
qui fait les employer, un fond immenfe de ri-
cheffes. Ce ne fera jamais des reffources de fon
are , mais de celles de fon géhie , qu’ il aura droit
de. le plaindre.
V o ic i encore d’autres compofitions pour imiter
les objets blancs.
P a s t e l s pour les linges, dentelles , hermines,
étoffes blanches , &c.
B l a n c .
Blanc.& peu de noir de charbon.
Moins de blanc, plus de noir & un peu de
vermillon.
Blanc, noir,ochre & vermillon.
le s mêmes couleurs avec moins de blanc.
Blanc , ochre jaune & peu de noir.
Noir , ochre & peu de brun rouge. } •
P a s t e l s pour des fonds ^ des fabriques d'or*
cïiteclure, & c .
Blanc, ochre , noir & rouge.
Mêmes couleurs av*ec moins de blanc.
N o ir , ochre & rouge.
Si l’on veut un fond plus grifâtre, on comparera
despajlels avec moins d’ochre & moins de
rouge. Veut-on qu’ il foit au contraire plus rougeâtre
? on ajoutera plus de rouge : faut- il enfin
qu’ il foit plus jaunâtre ? on mettra plus de jaune.
Le fyftême que l’on vient d’établir pour la
compofition des pajlels, ne differfe pas de celu'i
qu’on obferve en cojnpofant la palette pour la
peinture à l’huile. En effet, on n’a qurà br >ye4:
fur la palette, avec de l’ huile, les mêmes pajltls
que nous venons d’ indiquer, & l’on en fera les
mêmes uHl^esavec un luecèségal. Il faudra feulement
rejetter les couleurs qni ne : nrnoloyervt
pas à l’huile, telles que le.biftre, le csiiiiiu, 1 é-
mail, la terre verte & i’ indigo, qui du moins*n y
eft employé qu’avec du bianc.
Tout ce que nous avons dit de la compofition
des pajlels , eft tiré-de la dsrniere édition des
Elémens de la Peinture pratique , & peut être
'très-utile pour là compofition & la combination
des teintes : ce que nous allons ajouter eft plus
utile encore , puil’que les artiftes y trouveront
des lumières fur le choix de fubftances qu’ ils
doivent faire , f i , non coniens de donner a leurs
ouvrages un charme paffager, ils veulent leur
affurer une beauré durable.
L’auteur du Traité de la Peinture au pajlel,
réduit aux matières fuivamesle n'ombre des couleurs
qui fufïifent pour compofer un aflortiment
de pajlels.
Craie de Trôles.
Ochre jaune.
Ochre de rut.
Stil-de-grain jaune ou doré.
Cinnabre.
Carmin.
Laq ue carminée..
Bleu de Prufle.
Terre d’ombre.
Terre de Cologne.
Noir d’ivoire. T^oye^ ce qui eft dit de ces différentes couleurs
à leurs articles.
Cet auteur ne rejette cependant pas d’autres
fubftances colorées q u i, après avoir été purifiées,
peuvent fervir à compofer tels de bons pof- : on verra même qu’ il préféré plulieurs lubl-
tances à celles qu’on a coutume d’employer,
comme il en rejette abfolument plu/îeurs dont on
fait trop communément ufage.
Certaines couleurs s’altèrent par le temps, ou ,
leurs .combinaifons font changées par l’ influence |
de l’air : le premier de ces accidens eft prévenu 1
par le feu qui dévore tout cc que le temps peut j
détruire *, le fécond eft prévenu par l’eau, parce '
qu’elle enlève tous les Tels qui s’abbreuveroient j
de l ’humidité de l’air , tomberoient en effloref-
cence & répandroient fur les tableaux une forte
de pouffiere qui changeroit l’effet que l ’artifte
s’ eft promis. Mais un mal auquel on n’oppoferoit
que des remedes impuiffans & trompeurs, c ’eft
la difpofirion qu’ont les couleurs fournies par les
chaux métalliques à fe revivifie# en métal , ce
qui les fait pouffer au noir. Notre auteur vou-
droit donc bannir de toute efpece de peinture ,
la cérufe, le blanc de plomb , les maflicots, le
minium, la litharge ; & en un mot toutes les
couleurs qui ne réfiftenc pas à la vapeur du foie
de fouffre en eff’ervefcence avec un acide.
Pour faire des pajlels , il ne fuffi: pas de bien
choifir les couleurs dont on les compofe ; il faut
encore que les crayons n’ayent que le degré de
fermeté convenable; trop durs , ils fatigueroient
le papier, on ne pourroit les fondre enfemble
moelleufement ; trop mous, ils s’écraferoienc &
ne permettroient d’établir aucune forme, aucun
oecail avec fûreté. Voici le modèle que donne
1 auteur pour reconnoître la confiftance convenable
aux pajlels.'» Prenez, dit-il, un charbon
» tout en feu , de quelque bois que ce foit:
» jettez-le tout brûlant dans de l’eau. Quelques
» momens après, écrafez-le, tel qu’ il e ft, fur tin
» corps dur, & réduifez le en pâte bien fine au
» moyen d’un autre corps dur que vous pafferc z
» & repaierez plufieurs fois deffus. » ( L ’un de
ces corps durs eft pour les peintres la pierre à
broyer , & l ’autre eft la molette ). » Lori’que ce
» charbon fera bien broyé, ce que vous recor.*-
» noîtrez fi vous n’en fentez pas la pâte grave-
» leufe fous le d oigt, ramaffez-le, & donnez-luï
» la forme d’une cheville en le raclant fur du
» papier. Quand il ferâ fe c , il vous donnera très-
» certainement une idée jufte de la confiftance
! » que doit avoir , à-peu-près , tout autre crayon
» de p a jle l, de quelqu’efpece qu’ il foit. Il for-
>» mera lui-même un bon crayon , s’ il a été par-
» faitement broyé. »
Crayons blancs. La craie ou le blanc de
Troyes , dont les crayons blancs doivent être
compofés, n’éprouve point d’altération fenfible
par l ’effet de l’air. Il faut feulement le bien
•purifier. Voyez à l’article Blanc les détails de
cette opération. Voici un autre procédé qui
conduit à une purification encore plus parfaite*
Réduifez en poudre une livre ou deux de ce
blanc. Jettcz-la dans un vafe qui contienne
deux ou trois pintes d’eau. Remuez la matière
avec une baguette de bois ou de verre , jufqu’à
ce qu’elle paroiffc toute délayée : laiffez-la repolir
deux ou trois minutes pour donner le temps
aux parties groflières de fe précipiter. Verfez la
liqueur toute tiouble dans un autre vale , &
laiffez le précipité qui n’ eft que du fable. Quand
l’eau fera devenue claire, jettez-en la majeur®
partie fans agiter le vafe : enfuire verfez tout ce
qu’il contient dans des cornets de parchemin ou
de papier, dont vous aurez affujetti les circonve-
Iutions avec de la cire à cacheter. Snfpendez-Ies
enfuite quelque part, & repliez un peu le haut
des cornets pour empêcher la pouflière d’y pénétrer.
S’ il eft refté des parties graveléufes -
elles fe dépoferont au fond par le repos. Quelques
heures après,, l’eau fera bien éclaircie, & vous
pourrez percer les cornets au-deffus du fédimenc
pour la faire écouler. Quand la craie ne fera
plus trop liquide, vous lierez les cornets dans
leur partie inférieure avec un fil pour féparec
les parties groflières qui s’y feront précipitées, 8c
vous répandrez le refte fur le porphyre pour l’y
faire broyer. Lorfque vous^jugerez que la craie
j eft réduire, parla molette, en particules très-
fines,'vous la ferez ramaffer en petits tas avec
le couteau, fur du papier Jofeph ou Lombard.
( C’eft du papier fabriqué fans colle ). Quelques
momens après, vous pourrez facilement paîtrir
dans les doigts chacun des petits tas, & les rouler
fur la même forte de papier pour leur donner
la forme de crayons. D’ordinaire on leur donne
à-peu-près la longueur & la groffeur du petit
doigt. On peut les faire fécher fur d’autre craie ou
fur du papier. La manière de réduire çn crayons
les autres couleurs, eft la même. |
X x x x i j