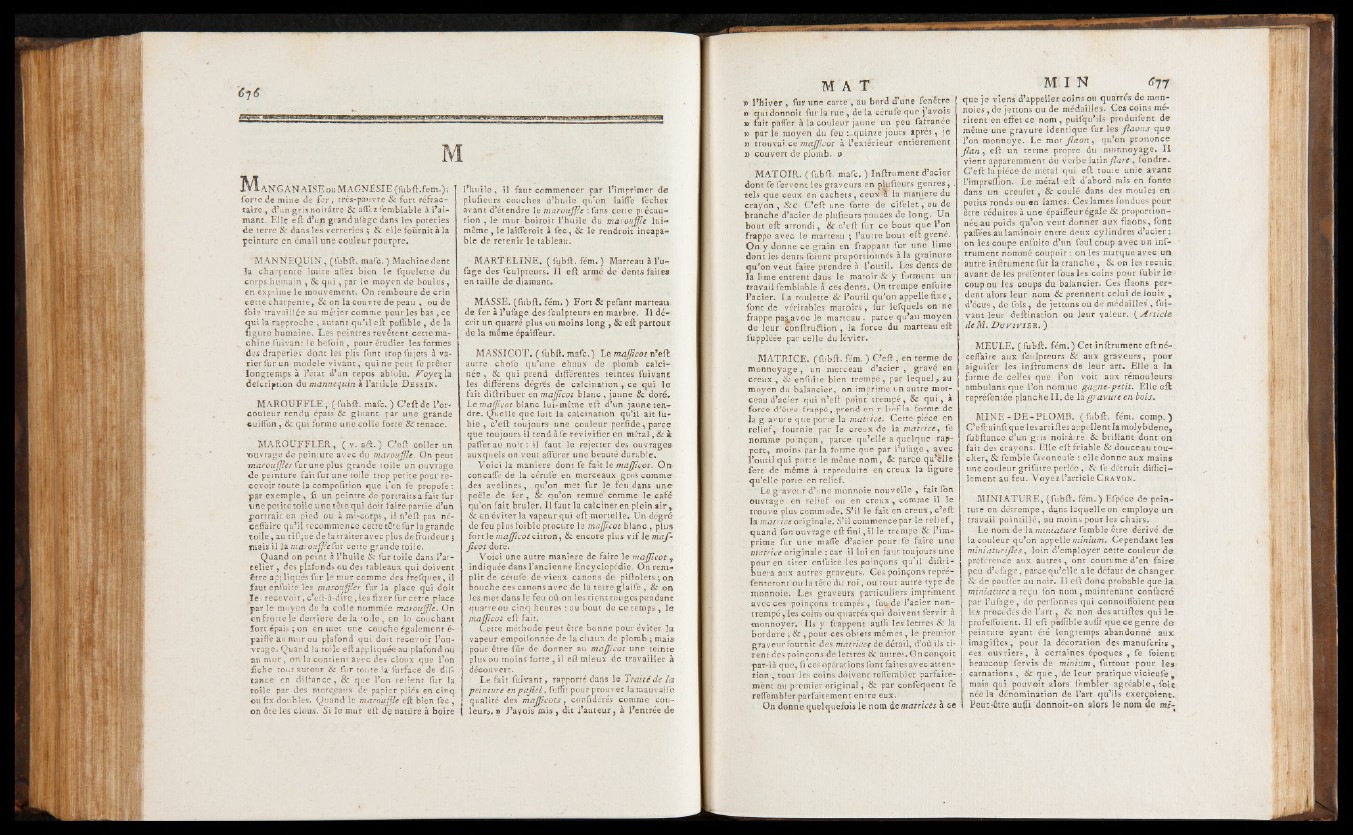
'6-16
M
3V l ANG AN AISE ou MAGNESIE (fubfhfem.);
forte de mine de fe r , très-pauvre & fort réfractaire
, d’un gris noirâtre & affez femblable à l’aimant.
Elle eft d’ un grand ufage dans les poteries
de terre & dans les verreries ; & elle fournit à la
peinture en émail une couleur pourpre.
MANNEQUIN, (fubft. mafc. ) Machine dont 3a charpente imite affez bien le fquelette du
corps humain , & q u i , par le moyen de boules,
en exprime le mouvement. Gn remboure de crin
cette charpente, & on la couvre de peau , ou de
foieNtravaillée au métier comme pour les bas , ce
qui la rapproche , autant qu’ il eft pofîible , de la
ligure humaine. Les peintres revêtent cette ma-
_ chine fuivan: le befoin, pour étudier les formes
des draperies dont les plis font tropfujets à varier
fur un modèle v ivan t, qui ne peut fe prêter
longtemps à l’état d’ un repos abfolu. Voye-^la
delcription du mannequin k l’article Dessin.
MAROUFFLE, (fubft. mafc. ) C’eftde l’or-
couleur rendu épais & gluant par une grande
•cuifïbn , & qui forme une colle forte & tenace.
MAROUFFLER, ‘(.y . a a . ) C’eft coller un
’ouvrage de peinture avec du maroitffle. On peut.
maroufler fur une plus grande toile un ouvrage
de peinture fait fur une toile trop petite pour recevoir
toute la compétition que l’on fe propofe :
par exemple, fi un peintre de portraits a fait fur
une petite toile une têtequi.doit faire partie d’un
portrait en pied ou à mi-corps, il n’eft pas nc-
ceffaire qu’ il recommence cette tête fur la grande
to ile , au rifquè de la traiteravec plus defroideur j
mais il la marozifflefur-cette grande toile.
Quand on peint à l’huile & fur toile dans.l’ar-
telier , des plafonds ou des tableaux qui doivent
être apf liqués fur le mur comme des frefqiies, il
faut enfuite les marùufjler fur la place qui doit
le ; recevoir , c’eii-à-dirë^, les fixer fur cette place
par le moyen de la colle nommée maioujfle. On
en frotte le derrière delà toile , en le couchant
fort épais ; on en inet une couche également é-
paifTe au mur ou plafond qui doit recevoir l’ouvrage.
Quand la toile eft appliquée au plafond ou
ail mur, on la contient avec des doux que l’on
fiche toux autour & fur toute la furface de distance
en diftance, & que l’on retient fur la
toile par des morceaux de papier pliés en cinq
ou fix doubles. Quand le maroujfïe eft bien fec ,
on ôte les clous. Si le mur eft de nature à boire
l’h u ile , il faut commencer par l’imprimer de
plufieurs. couches d’huile qu’on laiffe fécher
avant d’étendre le maroujfïe : fans cette précau-*
tion , le mur Êoiroit l’huile du maroujfïe lui-
même, le laifferoit à fec , & le rendroit incapable
de retenir le tableau.
MARTELINE. ( fubft. fém. ) Marteau à l’u-
fage des fculpteurs. I l eft armé de dents faites
en taille de diamant.
MASSE, (fubft. fém. ) Fort & pefant marteau
de fer à l’ufage des fculpteurs en marbre. Il décrit
un quarré plus ou moins long , & eft partout
de la même épaiifeur.
MASSICOT, ( fubft. mafc.) Le majjicot n’eft
autre, chofe qu’ une ehaux de plomb calcinée,
& qui prend différentes teintes fuivant
les différens degrés de calcination , ce qui le 1
fait diftribuer en majjicot blanc , jaune & doré.
Le majjicot blanc lui-meme eft d’un jaune tendre.
Quelle que foit la calcination qu’il ait fu-
bie , c’ eft toujours une couleur perfide, parce
que toujours il tend.àfe revivifier en métal , & à
paffer au noir : il faut le rejetter des ouvrages
, auxquels on veut affurer une beauté durable.
Voici la maniéré dont fe fait le majjiçot. Oit-
concaffe de la cérufe en morceaux gros comme
des avelines, qu’on met fur le feu dans une
poêle de fe r , & qu’on remue* comme le café
qu’on fait brûler. Il faut la calciner en plein a ir ,
& en éviter la vapeur qui eft mortelle. Un degré
de feu plusfoible procure le majjicot blanc , plus
fort le mafjicot citron, & encore plus v if le ttiaf-
Jicot doré.
Voici une autre maniéré de faire 1 ermajjicot 9
indiquée dans l’ancienne Encyclopédie. On remplit
de cérufe de vieux canons de piftolets ; on
bouche ces canons avec de la terre g la ife , & ora
les met dans le feu où on les tient rouges pendant
quatre ou cinq heures : au bout de ce temps , le
majjicot eft fait.
Cette méthode peut être bonne pour éviter la
vapeur empoifonnée de la chaux ,de plomb ; mais
pour être fûr de donner au majjicot une teinte
plus ou moin/forte , il eft mieux de travailler à
découvert.
Le fait fuivant, rapporté dans le Im ité de la
peinture enp'ajlel, fuffir pour prouver la mauvaife
qualité des majjicots, confidérés comme couleurs.
» J’avois ioiis, dit l’auteur, à l ’entrée de
M A T
» l’hiver , fur une carte , au bord d’une fenêtre
»• qui donnai t fur la rue , de la cérufe que j’avois
» fait paffer à la couleur jaune un peu fafranée
» par le moyen du feu '...quinze jours après , je
» trouvai ce mafjicài à l’extérieur entièrement
» couvert de plomb. »
MATOIR. ( fubft. mafc. ) Inftrument d’acier
dont le fervent les graveurs en plufieurs genres, .
tels que ceux en cachets, ceu^a la maniéré du
crayon, Scc~ C’eft une forte de c ife le t, ou de
branche d’acier de plufieurs pouces de long. Un
bout eft arrondi, & c’ eft fur ce bout que l’ on
frappe avec le marteau ; l’autre bout eft grené.
On y donne ce grain en frappant fur une lime
dontlesdents foient proportionnés à la grainure
qu’on veut faire prendre à l’outil. Les dents de
la lime entrent daus le maroir & y forment un |
travail femblable â ces dents. On trempe enfuite
l’acier. La roulette & l’outil qu’ on appelle fixe,
font de véritables'matôirs, fur lefquels on ne
frappe pa&avec le marteau g parce qu’au moyen
de leur conftru&ion , la force du marteau eft
fuppléée par celle du lévier.
MATRICE, (fubft. fem. ) C’e f t , en terme de
monnoyage, un morceau d’acier , gravé en
creux , & enfuite bien trempé, par leque l, au
moyen du balancier, on imprime un autre morceau
d’acier qui n’eft point trempé, & q u i, à
force d’ être frappé, prend en relief la forme de
la gravure que porte la matrice. Cette pièce en
relief,1 fournie par le creux de la matrice^ fe
nomme poinçon , parce qu’elle a quelque rapport,
moins par la forme que par l’uîage , avec
l’outil qui porte le même nom, & parce qu’elle
fert de même à reproduire en creux la figure
qu’elle porte en relief.
Le graveur d’une monnoie nouvelle , fait (on
ouvrage en relief ou en creux, comme il le
trouve plus commode. S’ il le fait en creux, c’ eft
la matrice originale. S’ il commence par le relief,
quand fon ouvrage eft fini, il le trempe & l’ imprime
fur une maffe d’acier pour fe faire une
matrice originale ; car il lui en faut toujours une
pour en tirer enfuite les poinçons qu il diftri-
buera aux autres graveurs. Ces poinçons repré-
fenteronc ou la tête du ro i, ou tout autre type de
monnoie. Les graveurs particuliers impriment
avec Ces poinçons trempés , fui* de l’acier non-
trempé , les coins ou quarrés qui doivent fervir a
monnoyer. Us y frappent au (fi les lettres & la
bordure v& , pour ces obiets mêmes , le premier
graveur fournit des matriceç de détail, d’où ils tirent
des poinçons de lettres & autres. On conçoit
par-là que, fi ces opérations font faites avec attention
,tous les coins doivent reffembler parfaitement
au premier original, & par çonfëquent fe
reffembler parfaitement entre eux.
On donne quelquefois le nom de matrices à ce
M I N 6 7 7
que je viens d’appeller coins ou quarrés de mon-
noies, de jettons ou de médailles. Ces coins méritent
en effet ce nom, puifqu’ ils produifent de
même une gravure identique fur les flaons que
l’on moniioye. Le mot fla o n , qu’on prononce
f la n , eft un terme propre du monnoyage. I l
vient apparemment du verbe latin flare , fondre.
C ’eft la pièce de métal qui eft toute unie avant
l’impremon. Le métal eft d’abord mis en fonte
dans un creufet, & coulé dans des moules en
petits ronds ou en lames. Ces lames fondues pour
être réduites à une épaiffeur égale & proportion-
néerau poids qu’on veut donner aux flaons, font
paffées au laminoir entre deux cylindres d’acier:
on les coupe enfuite d’ nn feul coup avec un inftrument
nommé coupoir : on les marque avec un
autre inftrument fur la tranche , & on lés recuit
avant de les préfenter fous les coins pour iubir le
coup ou les coups du balancier. Ces flaons perdent
alors leur nom & prennent celui de louis ,
d’écus , de fols , de jettons ou de médailles’ , fuivant
leur deftination ou leur valeur. ( Article
deM. Du Vivian. )
MEULE, (fubft. fém.) Cet inftrument eftné-
ceffaire aux fculpteurs & aux graveurs, pour
aiguifer les inftrumens de leur art. Elle a la
forme de celles que l’on voit aux rémouleurs
.ambulans que l’on nomme gagne-petit. Elle eft
repréfentée planche II. de la gravure en bois.
M IN E - DE -P LOMB , (fubft. fém. comp. )
C’eft ainfi que les arriftes appellent la molybdène,
fiibftance d’un gris noirâtre & brillant dont on
fait des crayons. Elle eft friable & douce au toucher,
& femble favori eufe : elle donne aux mains
une couleur grifàtre perlée, fe détruit difficilement
au feu. Voyez l’article Crayon.
MINIATURE, (fubft. fém.) Efpece de peinture
en détrempe , dans laquelle on employé un
travail pointillé, au moins pour les chairs.
Le nom de \z miniature femble être dérivé de
la couleur qu’on appelle Tjiinium. Cependant les
miniaturijles, loin d’employer cette couleur de
préférence aux autres, ont coutume d’ en faire
peu d’ufage, parce qu’elle a le défaut de changer
& de pouffer au noir. I l eft donc probable que la
miniature a .reçu fon nom, maintenant confacré
par l’ufage, de pèrfonnes qui connoiffoient peu
les procédés de l’a r t, & non des artiftes qui le
profeffoient. Il eft peffible auffi que cegenré de
peinture ayant été longtemps abandonné aux
) imagiftes, pour la décoration des manuferirs _
ces ouvriers, à certaines époques ,. fe foient
beaucoup fervis de minium, furtout pour les
carnations, & q u e , de leur pratique vicieufe 9
mais qui pouvoit alors fembjer agréable, foit
née la dénomination de l’art qu’ ils exerçoient.
Peut-être auffi donnoit-on alors le nom de oef