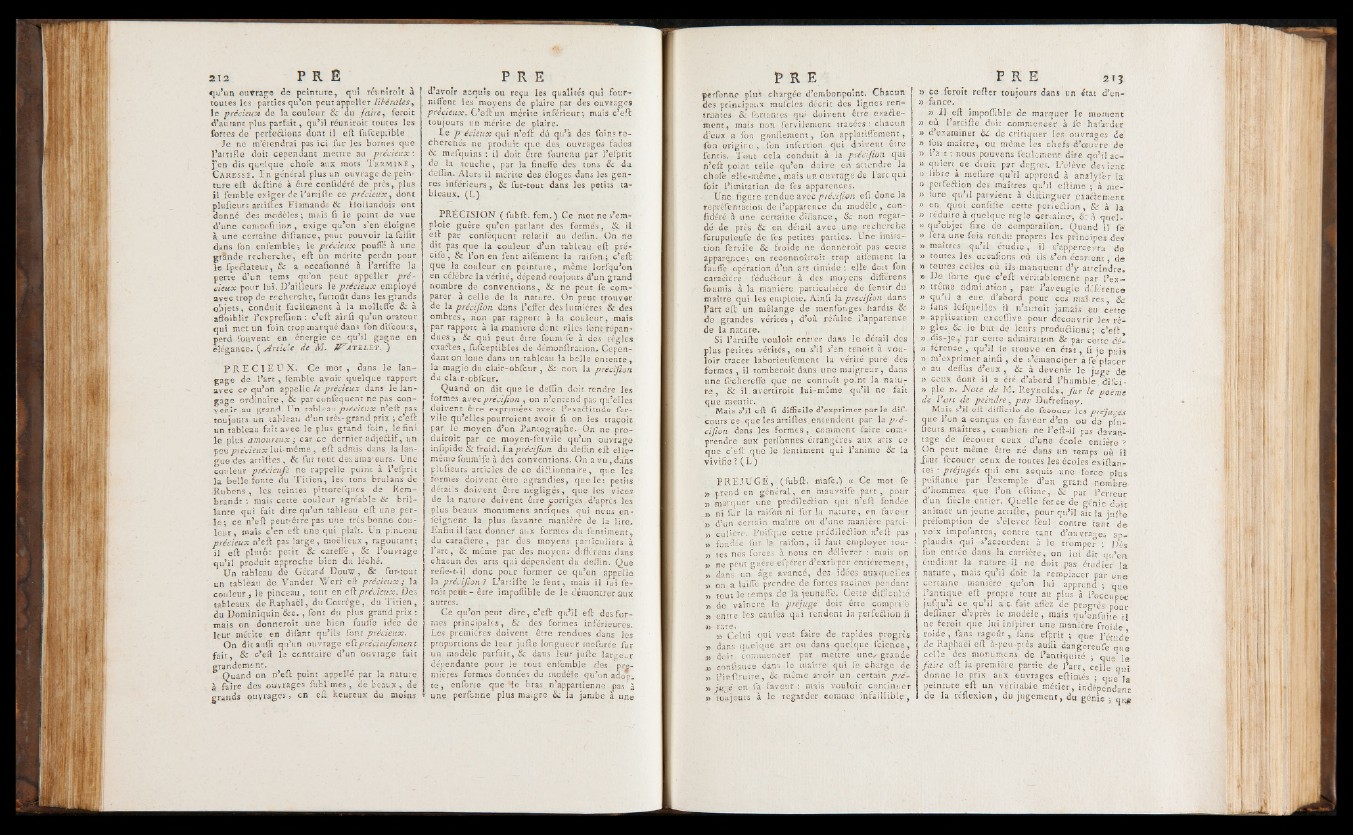
«fu’ un ouvrage de peinture, qui réunirait à
toutes les parties qu’on peutappeller libérales,
le précieux de la couleur & du faire, feroit
d’autant plus parfait, qu’ il réuniroit toutes les
fortes de perfeélions dont il eft ftifceptible
Je ne m’étendrai pas ici fur les bornes que
l ’artifle doit cependant mettre au précieux :
j'en dis quelque chofe aux mots T erminé ,
C a r e s s é . En général plus un ouvrage de peinture
eft deftiné à être confidéré de près, plus
il ferr.bîe exiger de l ’arrifle ce précieux, dont
plufteurs artiftes Flamands & Holiandois ont
donné des modèles; mais fi le point de vue
d’une conipofitioF!, exige qu’on s’en éloigne
à une certaine diftance, pour pouvoir lafaifir
dans fon en femble;- le précieux pouffé à une
grlnde recherche, eft un mérite perdu pour
le fpeefateur, & a occafionné à l’artifte la
perte d’ un tems qu’on peut appelkr précieux
pour lui. D’ailleurs le précieux employé
avec trop de recherche, furtoût dans les grands
objets, conduit facilement à la molleffe & à
affoiblir Texprefiicn : c’ e-ft air.fi qu’ un orateur
qui met un foin trop marqué dan« fon dilcouvs,
perd fouvent en énergie ce qu’ il gagne en
élégance. ( Article de M. )
P R E C I E U X . Ce mot , dans le langage
de l’a r t , femble avoir quelque rapport
avec ce qu’on appelle le précieux dans le langage
ordinaire , & par conséquent ne pas convenir
au grand. Un tableau précieux n’eft pas
toujours un tableau d’ un très-grand prix ; c’eft
un tableau fait avec le plus grand foin, le fini
le plus amoureux; car ■ ce dernier adjectif, un.
peu précieux lui-même , eft admis dans la langue
des artiftes, & fur tout des amateurs. Une
couleur précieufe ne rappelle point à l’efprit
la belle fonte du T itien , les tons brui ansde
Rubens , les teintes pittorefqties de Rembrandt
: mais cette couleur agréable 8c brillante
qui fait dire qu’ un tableau eft une perle
; ce n’eft peut-être pas une très bonne couleur,
mais c’en eft une qui plaît. Un pinceau
précieux n’eft pas large, moelleux , ragoûtant;
il eft plutôt petit 8c carefle , & l ’ouvrage
qu’ il produit approche bien du léché.
Un tableau de Gérard Douw, & fur-tout
un tableau de. Vander Wer f eft précieux; la
couleur, le pinceau , tout en eft.précieux. Des
tableaux de Raphaël, du Corrcge,. du- T itien ,
du Dominiquin & c . , font du plus grand prix :
mais on donneroit -une bien fauffe idée de
leur mérite en difant qu’ ils font précieux.
On ditaufli qu’un ouvrage efi:préejeufement
fa it, & c’eft la contraire d’un ouvrage fait
grandement. . ■
Quand on n’eft point appelle par la .nature,
à faire des ouvrages fub lm e s , de beaux, de
grands ouvrages, en eft. heureux du moins
d’avoir acquis ou reçu lès qualités qui four-
niffent les moyens de plaire par dés ouvrages
précieux. C’eft un mérite inférieur; mais c’eft
toujours un mérite de plaire.
Le p é ci eux qui n’eft dû qu’à des foins recherchés
ne produit que des. ouvrages fades
ik mefquins : il doit être foutenu par l’ efpric
de la touche, par la finefle des tons 8c du
deflin. Alors il mérite des éloges dans les genres
inférieurs, 8c fur-tout dans les petits tableaux.
(L)
PRÉCISION (fubft. fem.) Ce mot ne s’emploie
guère qu’ en parlant des formes, &. il
eft par conféquent relatif au deflin. On ne
dit pas que la couleur d’un tableau eft p.ré-
c ife , & l’on en fent aifément la rai fon.; c’eft
que la couleur en peinture, même lorfqu’on
en célèbre la vérité, dépend Toujours d’un grand
nombre de conventions, & ne peut fe comparer
à celle de la nature. On peut trouver
de la précijion dans l’effet des lumières & des
ombres, non par rapnorc à la couleur, mais
-par rapport à la manière dent elles font répandues
, & qui peut être founi’ fè à des règles
exaftes , fufceptibles de démon fl: ration. Cependant
oh loue dans un tableau la belle entente ,
la- magie du clair-obfcur , 8c non la précijion
du clatr-obfcur.
Quand on dit que le deflin doit, rendre les
formes avec précijion , oh n’entend pas qu’elles
doivent être exprimées avec l’exaélitude fer-
vile qu’elles pourroient avoir fi on les traçoit
par le moyen d’un Pantographe. On ne produirait
par ce moyen-fervile qu’ un ouvrage
infipide 8c froid, La précijion du deflin eft elle-
même foumife à des conventions. On a vu , dans
plufieurs articles de ce diflionnaire, que les
formés doivent être agrandies, que ley petits
détails doivent être négligés, que les vices
de la nature doivent être corrigés d?après les
plus beaux monumens antiques qui nous en-
feignent la plus favante manière de la lire.
Enfin il faut donner aux formes du fentimënt,
du caractère, par des moyens particuliers à
l’arc, 8c même par des moyens diftéréns dans
. chacun des arts qui dépendent du deflin. Que
refte-t-ii donc pour former ce qu’on .appelle
la précijion? L’artifte le fent, mais il fui ferait
peut - être impofîible de le démontrer aux
autres.,
Ce qu’on peut dire, c’eft qu’ il eft des formes
principales, 8c des formes inférieures.
Les premières doivent être rendues dans les
proportions de leur jtifle longueur mefurée fur
un modèle parfait, 8c dans leur jufte largeur
dépendante pour le tout enfemble des premières
formes données du modèle qu’on adop.
te , enforce que He bras, n’appartienne pas à
* une perfenne plus maigre 8c la jambe à une
pèrfonne plus chargée d’embonpoint. Chacun
des principaux mufcles décrit des lignes rentrantes
& (ocrantes qu’1 doivent être exactement
, mais non fervilément tracées : chacun
d’eux a fon gonflement, fon applatifiement,
fon origine., fon infertion qui doivent être
Ternis. Tout cela conduit à la précijion qui
n’eft point telle- qu’on doive, en attendre la
chofe elle-même , mais un ouvrage de l’art qui
foie l’ imitation de les apparences.
Une figure rendue avec précijion eft donc la
repréfentation de l’apparence du modèle, confidéré
à une certaine dîftance, 8c non regardé
de près 8c en détail avec une recherche
fcrupuleufe de les petites parties. Une imitation
fer vile & froide rie donneroit pas cette
apparence; on reconnoîtroit trop aifément la
fauffe opération d’un art timide : elle doit fon !
caractère, féduéteur à des moyens diftérens
fournis à la manière particulière de fentir du
maître qui les emploie. Ainfi la précijion dans
l ’art eft un mélange de menfonges hardis 8c
de grandes vérités, d’où .réfulte l’apparence
de la nature.
Si l’artifte vouloit entrer dans le. détail des
plus petites vérités, ou s’ il s’en tenoît à vouloir
tracer laborieufement la vérité -puré dés
formes , il tomberait dans une maigreur, dans
une fécherefle que ne connuît point la natur
e , 8c il. avertirait lui-même qu’ il ne fait
que mentir.! ■,
IVlais s’ il eft fi difficile d’exprimer parle dift
cours ce, que les artiftes. entendent par la p>é-
cïjion dans lès formes, comment faire, comprendre
aux perfonnes étrangères aux arts ce
que c’eft que le fentiment qui l ’anime & la
vivifie ? ( L ) -
P R É JU G É , (fubft. niafc.) « Ce mot fe
» prend en général, en mauyaife part , pour
» marquer une prédile&ion qui n’eft fondée
„ ni fur la rajfôn ni fur la nature, en faveur
,> d’ un certain maître ou d’une manière pani-
» culière. Puifque cette prédilection n’ eft pas
» fondée fur la raifon, il faut employer tou-
» tes nos forces à nous en délivrer : mais.on
» ne petit guère eTpérer d’extirper entièrement,
» dans un âge avancé, des idées auxquelles
» on a laiflè prendre de fortes racines pendant
» tout le temps de lajeunefle. Cette difficulté
» de vaincre le préjugé doit être comprile
» entre les caufes qui rendent la perfection fi
-» rare. ~ ' _ '
m Celui qui veut faire de rapides progrès
» dans quelque art ou dans quelque fcience,
.» doit commencer par mettre' une/-grande
jo confiance dans le maître qui fe charge de
» l’ inftruire, & même avoir un certain pré-
„ j uré en fa faveur : mais vouloir continuer
» toujours à le regarder comme in fa illib le ,
» ce ferait refter toujours dans un état d’en-
» Tance. ,
» Il eft impoflible de marquer le moment
» où l ’artifte doit commencer à fe ha farder
» d’examiner 8c de critiquer les ouvrages de
» fou maître, ou même les chefs d’oeuvre de
» l’art : nous pouvons feulement dire qu’ il ac-
» quiert ce droit par degrés. L’élève devient
» libre à mefure qu’il apprend à anal y 1er' la
» perfeélion des maîtres qu’ il eftime ; à me-
» lure qu’ il parvient à diitinguer exactement
» en "quoi confifte cette perieétion , 8c à la
'» réduire à quelque règle certaine*, 8: n quel-
» qu’objet, fixe de comparaifon. Quand il fe'
» fera une fois rendu propres les principes des
» maîtres, qu’ il étudie, il s’appercevra de
» toutes les oc caftons où ils s’en écanent , de
» toutes celles où ils manquent d’y atteindre.
» De farte- que c’eft véritablement par l’e x -
» trêrae admiration , par l ’aveugle déférence
» qu’ il a eue d’abord pour ces maures, 8c
n fans lefquelles il n’auroit jamais eu cette
» application exceflive pour découvrir les
» gîes 8c le but de leurs pro du étions ; c ’eft
».d is- je, par cette admiration & par cette dé-
n férence , qu’ il le trouve en éta t, fi je puis
» m’exprimer ainfi , de s’émanciper à fe placer
» au defliis d’eux , 8c à devenir le juge de
» ceux dont il a été d’abord l’humble, difei-
» pie ». Note de M, Reynolds, fu r le poème
de Van de peindre, par Dufrefnoy.
Mais s’ il eft difficile de fecouer les préjugés
que Ton a conçus en faveur d’un ou de plufieurs
maîtres, combien ne l ’eft-if pas davantage
de fecouer ceux d’une école entière t*
On peut même être né dans un temps où il
iauc fecouer ceux de toutes les écoles exiftantes
• préjugés qui ont acquis une -force plus
puiflante par l’exemple d’ un grand nombre
d’hommes que l’on eftime, 8c par Terreur
d’un fiècle entier. Quelle force de génie doit
animer un jeune .arnfte, pour qu’ il aie la jufte
j préfomption de s’élever leul contre tant de
j voix impofantes, contre tant d’ouvrages ap-
; plaudis qui s’accordent à le tromper 1 Des
Ion entrée dans la carrière, on lui dit qu’en
étudiant la r.attire 11 ne doit .pas étudier la
nature , mais qu’ il doit la remplacer par une
certaine manière qu’ on lui apprend ; que
l’ antique eft propre tout au plus à l’occupée
jufqu’a ce qu’ il ait- fait afiez de progrès pour
defiiner d’après le modèle , mais qu’enfuiie il
ne ferait que lui infpjrer une manière froide
roide , fans ragoût, fans efprit ; que l ’étude
de Raphaël eft à-peu-près aufîi dangereufe que
' celle des monumens de l’antiquité ; q ue ie
faire eft la première partie de Tarr, celle qui
donne le prix aux ouvrages eftimés ; que îa
peinture eft un véritable métier, indépendant
de la réflexion, du jugement, d« génie ; qi^