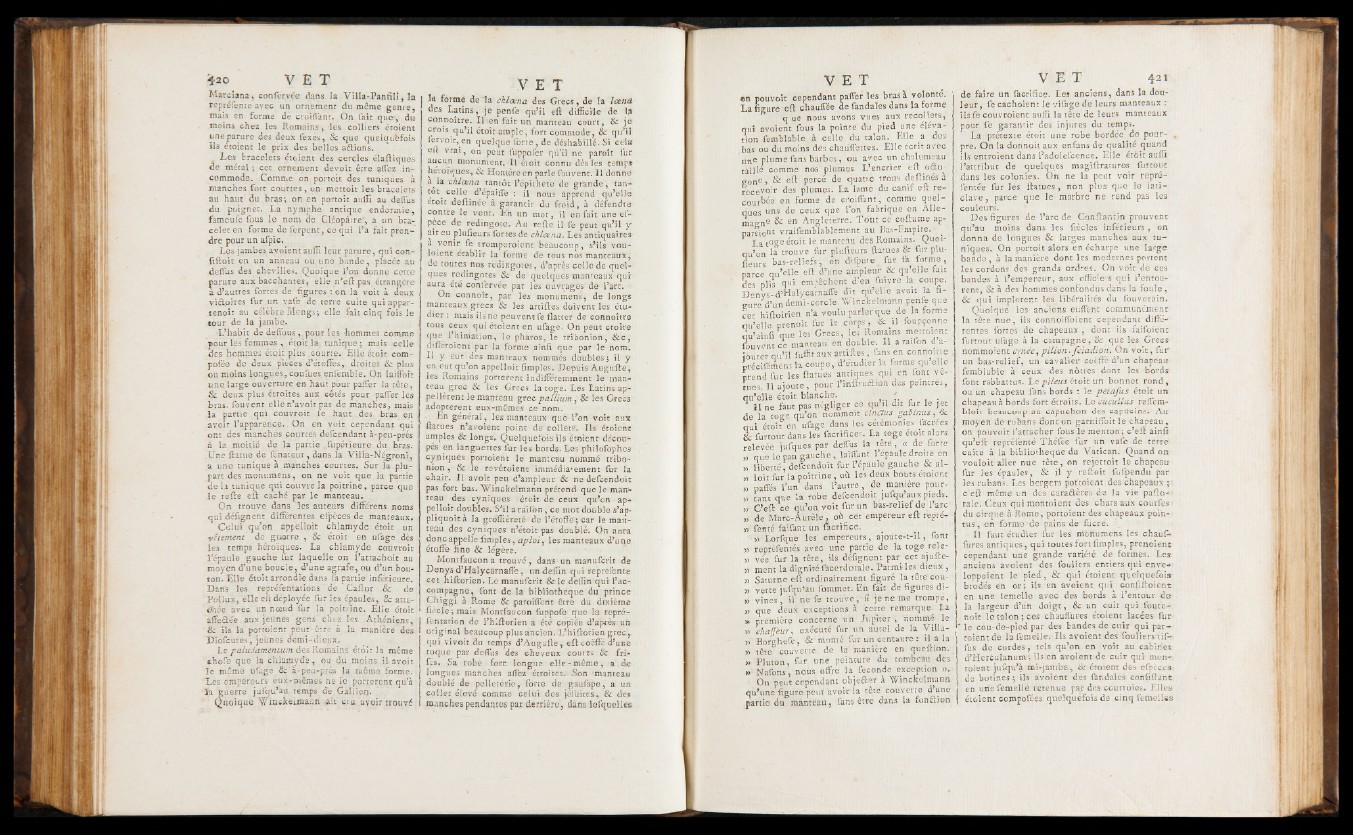
Marciana, confervée dans la V illa-Panfili, la
repréfente avec un ornement du même genre,
mais en forme de croiffant. On fait q u e , du
moins chez les Romains, les colliers étoient
une parure des deux lèxes, & que quelquefois
ils étoient le prix des belles a étions.
Les bracelets étoient des cercles élaftiques
ue métal -, cet ornement de voit être affez incommode.
Comme on portoit des tuniques à
manches fort courtes, on mettoit les bracelets
au haut du bras; on en portoit auffi au de (fus
du poignet. La nymphe antique endormie,
fameufe fous le nom de Cléopâtre*, a un bracelet
en forme de ferpent, ce qui l’ a fait prendre
pour un afpic.
Les jambes avoient aufii leur parure, qui con-
fiftoit en un anneau oïi une bande, placée au
deffus des chevilles. Quoique l ’on donne cette
parure aux bacchantes, elle nJeft pas étrangère
a d’autres fortes de figures : on la voit à deux
viélpires fur un vafe de terre cuite qui appar-
tenoit au célèbre Mengs ; elle fait cinq fois le
tour de la jambe.
L’habit de de do us, pour les -hommes comme
pour les femmes , étoit la, tunique ; mais celle
des hommes étoit plus .courre. Elle étoit com-
pofée de deux pièces d’étoffes, droites & plus
ou moins longues, coufues enfemble. On laifibit
une large ouverture en haut pour paffer la tête,
& deux plus étroites aux côtés pour pafTer les
bras, fouvent elle n’avoit pas de manches, mais
la partie qui couvroit le haut des bras en
avoit l’apparence.. On en voit cependant qui :
ont des manchès courtes defeendant à-peu-près
à la moitié de la partie .fupétieure du bras.
Une ftatue de fénateut, dans la Villa-Négroni,
a une tunique à manches courtes. Sur la plupart
des monumens, on ne voit que la partie
de la tunique qui couvre la poitrine, parce que
le refte eft caché par le manteau.
On trouve dans les auteurs différens noms
qui défignent différentes efpèces de manteaux.
Celui qu’ on appelloit chlamyde étoit un
yîttment de guerre , & étoit en ufage dès
les temps héroïques. La chlamyde couvroit
l ’épaule gauche fur laquelle on l’attachoit au
moyen d’une boucle, d’une agrafe, ou d’ un bouton.
Elle étoit arrondie dans l'a partie inférieure.
Dans les repréfentations de Caftor 8c de
Pollux, elle efi déployée fur les épaules, & attachée
avec ur. noeud fur la poitrine. Elle étoit
affeâée aux jeunes gens chez les Athéniens,;
& ils la portoient peut-être à la manière dés
Diofcures, jeunes demi-dieux.
Le paludamentum desKcmains étoit la même
choie que la chlamyde , on du moins .il avoit
le même ufage & à-peu-près la même forme.
Les empereurs eux-mêmes ne le portèrent qu’à
la guerre jufqu’au, temps de Gàlîien.
Quoique Winskeixnaim ait cru avoir trouvé
I la formé de 'la chloena des Grecs, de la lotnd
des Latins, je penfe qu’ il eft difficile de la
connoître. I l en fait un manteau court, & je
crois qu’ il étoit ample, fort commode, 8c qu’ il
fervoit,en quelque forte, de déshabillé. Si cela
eft vrai, on- peut fuppofer qù’il ne paroît fur
aucun monument. Il éioit connu dès lés temps
héroïques, & Homère en parle fouvent. Il donné
a^la chloena tantôt l’épithete de grande, tantôt^
celle d’épaiffe : il nous apprend qu’elle
étoit deftinée à garantir du froid, à défendre
contre le vent. En un mot, il en fait une ef-
pece de redingote. Au refte il le peut qu’ il y
ait eu plufieurs fortes de chloena. Les antiquaires-
a venir fe tromperoient beaucoup, s’ ils vou-
loient établir la forme de tous nos manteaux,
de toutes nos redingotes, d’après celle de quelques
redingotes 8c de quelques manteaux qui
aura etc conlervée par les ouvrages de l’art.
On connoît, par les monumens, de longs
manteaux grecs 8c les artiftes doivent les étudier
: mais il^ne peuvent fe flatter de connoître
tous ceux qui étoient en ufage. On peut croire
l’hiroation, le pharos, le fîibonion, & c ,
différoient par la forme aïnfi que par le nom-.
Il y eut des manteaux nommés doubles ; il y
en eut qu’on appelloit fimplès. Depuis Augufte,
les Romains portèrent indifféremment le manteau
grec & les Grecs la toge. Les Latins appelèrent
le manteau grec pallium, 8c les Grecs ;
adoptèrent eux-mêmes ce nom.
En général, les manteaux qué l’on voit aux
ftatues n’avoient point de collets'. Ils étoient
amples & longs. Quelquefois ils étoient découpés
en languettes fur les bords. Les philofophcs
cyniques portoient le manteau nommé tribo-
nion , & le revêtoient immédiarement fur la
chair. Il avoit peu d’ampleur & ne defeendoit
pas fort bas. Winckelmann prétend que le manw
teau des cyniques étoit de ceux qu’on appelloit
doubles.-S’ il a railon, ce mot double s’ap-
pliquoità la groffièrecé de l’étoffe-; car le manteau
des cyniques n’étoit pas double. On aura
donc appelle ftmples, aploï ,• les manteaux d’une
étoffe fine & légère.
Montfaucon a trouvé, dans un manuferit de
Denys d’Halycarnaffe, undeffin qui repréfente
cet hiftorien. Le manuferit & le defiin qui l’accompagne
, font de la bibliothèque du prince
^ iggi-.à.Rome & paroiffent être du dixième
fiècie ; mais: Montfaucon fuppofe que la repré-
fentation de l ’hiftorïen a été copiée d’après un
original beaucoup plus ancien. L’ hiftorien grec ,.
.qui vivoit du temps d’Augufte, eft coëffé d’une
toque par deffus des cheveux court;. & fri-
fés. Sa robe fort longue elle-même., a de
longues manches affez étroites;-Son 'manteau
doublé de pelleterie, forte de gaufape, a un
collet élevé comme celui des jéfuites, & des
manches pendantes par derrière, dans lefqu elles.
©n pouvoit cependant paffer les bras à volonté.
La figure eft chauffée de fandales dans la forme
q ue nous avons vues aux recollets,
qui avoient fous la pointe du pied une élévation
femblable à celle du talon. Elle a des
bas ou du moins dès chaiiffettes. Elle écrit avec
nne plume fans barbes, ou avec un chalumeau
taillé comme nos plumes L’encrier eft °&°v'
g one , & eft percé de quatre trous deft.inés a
recevoil* dès plumes. La lame du canif eft recourbée
en forme de croiffant, comme quel-
qUes uns de ceux que l’on fabrique en A ile - j
magne '& en Angleterre. Tout ce coftume ap-
partie11 c vrailemblablement au Bas-Empire.
La t°g e étoit le manteau des Romains. Quoiqu’on
la trouve fur plufieurs ftatues 8c fur plu-
fieurs bas-reliefs, on difpute fur fa forme ,
parce qu’elle eft d’ une ampleur 8ç qu’ elle fait
dés plis qui empêchent d’en fuivre la coupe.
Denys-d’Halycarnaffe dit qu’elle avoit la figure
d’ un demi-cercle. Winckelmann penfe que
cet hiftoirieii n’a voulu parler que de la forme'
qu’elle prenait fur le corps, & l\ foupçonne
qu’ainfi que ■ Grecs, les Romains mettoient
fouvent ce manteau en doublé. I l a raifon da-
jouter qu’ il luffit aux artiftes-, fans en connoître
préciféiftent la coupe, d’etudier la forme qu elle
prend fur les ftatues antiques qui en font vêtues.
Il ajoute, pour l’ inftruclion des peintres,
qu’ elle étoit blanche. H H H . .
I l ne faut pas négliger ce qu il dit fur le jet
de la toge qu’on nommoit cinclus gahinus, 8c
qui étoit en ufage dans les cérémonies fa'crées
èc furtout dans les facrifices. La toge étoit alors
relevée jufquës par deffus la têcé, « de forte
» que le pan gauche, laiffant 1 épaulé,droite en
» liberté, defeendoit fur l’épaule gauche & al-
>3 loit fur la poitrine, où les deux bouts étoient
» paffés l’un dans l’autre, de manière pour-
| tant que la robe defeendoit jufqu’ aux pieds.
C’ eft ce qu’on voit fur un bas-relief de l’ arc
» de Marc-Aurèle, où cet empereur eft repré-
33 fente faifant un facrifice.
• >3 Lorfque les empereurs, ajoute-t-il, font
33 repréfentés avec une partie de la toge reîe-
>3 vée fur la tête, ils défignent par cet ajufte-
>3 ment la dignité façerdorale.. Parmi les dieux ,
» Saturne eft ordinairement figuré la tête cou-
33 verte jufqu’ au fommet. En fait de figures di-
33 vines, il ne fe trouve ,vfî je ne me trompe,
33 que deux exceptions à cette remarque- La
» première concerne un Jupiter, nommé- le
3) chaffeur, exécuté fur un autel de la Villa -
>3 Borghefe, & monté fur un centaure : il a la
» tête couverte de la manière en queftion.
» Pluton, fur une peinture du tombeau des
» Nafons, nous offre la fécondé exception ».
On peut cependant objefter à Winckelmann
qu’ une figure peut avoir la tete couverte d une
partie du manteau, fans être dans la fonction
de faire un facrtfice. Les anciens, dans la douleur,
fe cachoient le vifage de leurs manteaux :
ils fe couvroient au fil la tête de leurs manteaux
pour fe garantir des injures du temps.
La prétexte étoit une robe bordée de pour- ,
pre. On la donnoit aux enfans de qualité quand
ils entroient dans l’ adolefcence. Elle étoit aufll
l’attribut de quelques magiftratures furtout
dans les colonies. On ne la peut voir repré-
fentëë fur les ftatues, non plus que le ia ti-
c la v e , parce que le marbre ne rend pas les
couleurs.
Des figures de l’arc de Conftannn prouvent
qu’au moins dans les fiècles inférieurs, on
donna de longues & larges manches- aux tuniques.
On portoit alors en écharpe une large
bande, à la manière dont les modernes portent
les cordons des grands ordres. On voit de ces
bandes à l’empereur, aux officie-s qui l’entourent,
8c à des hommes confondus dans la foule ,
8c qui implorent les libéralités du fouverâin.
Quoique les anciens euffent communément
la tête nue, ils connoiffoient cependant différentes
forres de chapeaux , dont ils faifoient
furtout ufage à la- campagne, & qué les Grecs
nommoiept cynée, pilion. feiadion. On voit, fur
un bas-relief, un cavalier coéff’é d’un chapeau
femblable à ceux des nôtres dont les bords
font rabbattus. Le pileus étoit un bonnet rond,
ou un chapeau fans bords : le petafus étoit un
chapeau à bords fort étroits. Le cucullus reffem-
bloit beaucoup au capuchon des captîcins. Au
moyen de rubans dont on garr.iffoitle chapeau,
on pouvoit l’attacher fous le menton; c ’eft ainfi
qu’eft repréfente Théfée fur un vafe de terre
cuite à la bibliothèque du Vatican. Quand on
vouloit aller nue tête, on rejettoit le chapeau
fur les épaules, & il y reftoit fufpendu par
les rubans. Les Isergers portoient des chapeaux
c'eft même un des caradères de la vie pafto--<
raie. Ceux qui montoient des chars aux courfes
du cirque à Rome, portoient des chapeaux pointus,
en forme‘de pains de fucré.
Il faut étudier fur les monumens les chauf-
fures antiques, qui toutes fort {impies, prenoient
cependant une grande variété de formes. Les
anciens avoient des foujiers entiers qui enveloppaient
le pied , & qui étoient quelquefois
brodés én or; ils en avoient qui conliftoient
en une iemelle avec des bords à l’entour de
la largeur d’ un doigt, 8c un cuir qui fou te-
noit le talon ; ces chaufiures étoient lacées fur
' le cou-de-pied par des bandes de cuir qui par-
\ toient de la femelle* Ils avoient des fouiiers tif-
fus de cordes, tels qu’on en voit au cabinet
d’Herculanum ; ils en avoient de cuir qui montoient
jufqu’ à mi-jambe., 8c étoient des efpce.es:
de botines ; ils avoient des fandales confiftane
en unefemellé retenue par des courroies. Elles
étoient compofées quelquefois de cinq femelles