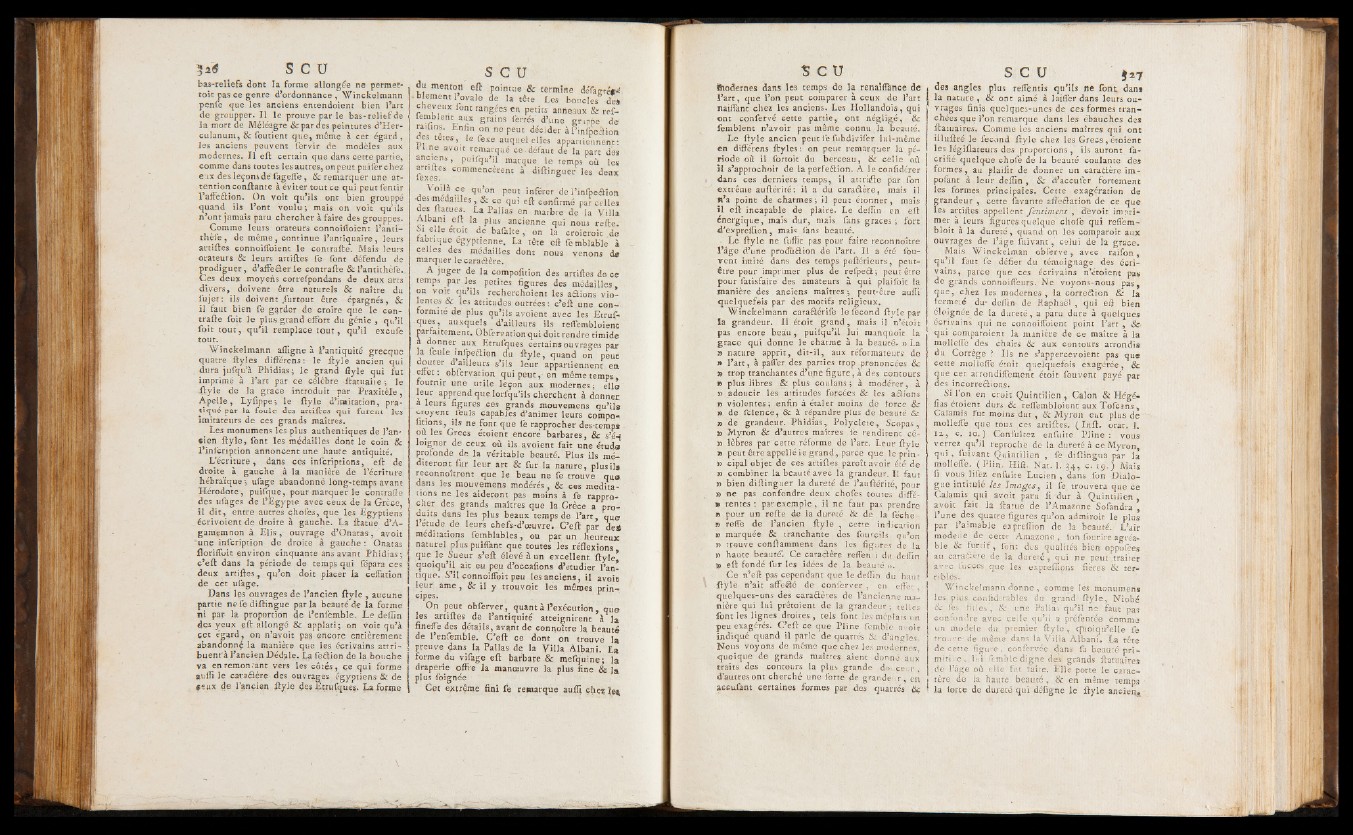
S C U
bas-reliefs dont la forme allongée ne permet-
toit pas ce genre d’ordonnance , Winckelmann
penfe que les anciens entendoient bien l’art
de groupper. I l le prouye par le bas-relief de
la mort de Méléagre & par des peintures d’Her-
culanunt, & foutient que, même à cet égard,
les anciens peuvent fervir de modèles aux
modernes. I l eft certain que dans cette partie,
comme dans toutes les autres, on peut puiferchez
eux des leçons de' fageffe, & remarquer une attention
confiante à éviter tout ce qui peut fentir
l ’affeâion. On voit qu’ ils ont bien grouppé
quand ils l’ont Voulu; mais on voit qu’ ils
n’ont jamais paru chercher à faire des grouppes.
Comme leurs orateurs connoiffoient l’anti-
th è fe , de même, continue l’antiquaire, leurs
artiftes connoiffoient le contrafte. Mais leurs
orateurs & leurs artiftes fe font défendu de
prodiguer, d’affeâer le contrafte & l’antithèfe*.
Ces deux moyens correfpondans de deux arts
divers, doivent être naturels & naître du
lujet: ils doivent .furtout être épargnés, &
il faut bien fe garder de croire que le cen-
trafte foit le plus grand effort du génie , qu’ il
foit tou t, qu'il remplace to u t, qu’ il excufe
tout.
Winckelmann affigne à l’antiquité grecque
quatre ftyles différens: le ftyle ancien qui
dura jufqu’à Phidias; le grand ftyle qui fut
imprimé à l ’art par ce célèbre ftatuaiie; le
f ty le de la grâce introduit par Praxitèle
A p e lle , Lyfippe; le ftyle d’imitation, pratiqué
par la foule des artiftes qui furent les
imitateurs de ces grands maîtres.
Les monumens les plus authentiques de l’ancien
fty le , font les médailles dont le coin &
l ’infcription annoncent une haute antiquité.
L’écriture , dans ces infcriptions, eft de
droite à gauche à la manière de l’écriture,
hébraïque; ufage abandonné long-temps avant
Hérodote , puifque, pour marquer le contrafte
des ufqges de l’Egypte avec ceux de la Grèce,
i l d it, entre autres çhofes, que les Egyptiens
écrivoient de droite à gauche. La ftatue d’A-
gamemnon à E lis , ouvrage d’Onatas, a voit
une infcription de droite à gauche : Onatas
floriflbit environ cinquante ans avant Phidias;
ç ’eft dans la période de temps qui fépara ces
deux artiftes, qu’on doit placer 1^ ceflation
de cét ufage.
Dans lps ouvrages de l’ ancien ftyle , aucune
partie nefediftingue parla beauté de la forme
ni par la proportion qe l’enfemble. Le deffin
des yeux eft allongé 8c applati; on Voit qu’à
çct égard, on n’avoit pas encore entièrement
abandonné la manière que les écrivains attri-
buent'à l’ancien Dédale. La feftion de la bouche
va en remontant vers les côtés, çe qui forme
aufli le cara&ère des ouvrages égyptiens & de
feux de l’ancien ftyle des Etrufques. La forme
S C U
du menton eft pointue & termine défapré.J
blement 1ovale de la tête Les boucles de»
cheveux font rangées en petits anneaux & ref-
lemblent aux grains ferrés' d’une grippe de
railins. Lnfin on ne peut décider à l ’ infpeâion
des têtes, le fexe auquel elles appartiennent;
r iin e a voit remarqué ce défaut de la part des
anciens, puilqu’ il marque le temps où les
artiftes commencèrent à diftinguer les deux
lexes.
Voilà ce qu’on peut inférer de l ’infpeélion
-des médaillés, & ce qui eft confirmé par celles
des ft a tu es. La Pallas en marbre de la Villa
Albani eft la plus ancienne qui nous refte.
bi ede etoit de bafalte, on la croieroic de
fabrique égyptienne. La tête eft femblable à
celles des médailles dont nous venons de
marquer lecara&ère.
A juger de la compofition des artiftes de ce
temps par les petites figures des médailles,
on voit qu’ ils recherchoient les a&ions violentes
& les attitudes outrées : c’eft une conformité
de plus qu’ ils avoient avec les Etruf*
-ques, auxquels d’ailleurs ils reffembloienc
parfaitement. Obfervationqui doit rendre timide
a donner aux Etrufques certains ouvrages par
la feule infjjeélion du fty le , quand on peut
douter d’ailleurs s’ ils leur appartiennent en
effet: obfervation qui peut, en même temps,
fournir une utile leçon aux modernes ; elle
leur apprend que lorfqu’ils cherchent à donner
a leurs figures ces grands mouvemens qu’ils
croyent feuls capables d’animer leurs compo-
fitions, ils ne font que le rapprocher des-temps
où les Grecs étoient encore barbares, & s’éq
loigner de ceux où ils avoient fait une étude
profonde de la véritable beauté. Plus ils méditeront
fur leur art & fur la nature, plus ils
reconnoîtront que le beau ne fe trouve que
dans les mouvemens modérés, & ces méditations
ne les aideront pas moins à fe rapprocher
des grands maîtres que la Grèce a produits
dans les plus beaux temps de l’art, qu©
de leurs chefs-d’oeuvre. C’eft par de*
méditations femblables, ou par un heureux
naturel pluspuiflant que toutes les réflexions,
que le Sueur s’eft élevé à un excellent ftyle ,
quoiqu’ il ait eu peu d’occafions d’étudier l ’antique.
S’ il connoiffoit peu les anciens, il avait
leur ame, & |1 y trouvait les mêmes principes.
r
On peut obferver, quant à l’exécution , que
les artiftes de l’antiquité atteignirent à la
fineffe des détails, avant de connaître la beauté
de l ’enfemble. C’eft ce dont on trouve la
preuve dans la Pallas de la V illa Albani. La
forme du vifage eft barbare & mefquine; la
draperie offre la manoeuvre la plus fine & la
plus foignée
Cet extrfme fini fe remarque auflj. chez, lez
S C U
Ihodernes dans les temps de la renaïffance de
l’art, que l’on peut comparer à ceux de l’ art
naiffant chez les anciens. Les Hollandois, qui
ont confervé cette partie, ont négligé, &
femblent n’avoir pas même connu la beauté.
Le ftyle ancien peut fe fubdivifer lui-même
en difïerens ftyles: on peut rertiarquer la.période
où il fortoït du berceau, & celle où
il s’approchoir de la perfeétion. A le confidérer
dans ces derniers temps, il attriifte par fon
extrême auftérité: il a du caraéière, mais il
»’a point de charmes; il peut étonner, mais
il eft incapable de plaire. Le defïin en eft
énergique, mais dur, mais, fans grâces; fort
d'eypreflion, mai« fans beauté.
Le ftyle ne fuffit pas pour faire reconnoître
l’ âge d’une produélion de l’art. Il a été fou-
vent imité dans des temps poftérieurs, peut-
être pour imprimer plus de refpeâ; peut-être
pour fatîsfaire des amateurs à qui plaifoit la
manière des anciens maîtres ; peut-être aufli'
quelquefois par des motifs religieux.
Winckelmann cara&érife le fécond ftyle par
la grandeur. Il étoit grand, mais il n’étoit
pas encore beau, puifqu’ il lui manqùoit la
grâce qui donne le charme à la beauté. » La
» nature apprit, d it-il, aux réformateurs de
» l’art, à paffer des parties trop prononcées &
» trop tranchantes d’ une figure, à des contours
» plus libres & plus coulans ; à modérer, à
» adoucir lès attitudes forcées & les aâions
» violentes; enfin à étaler moins de force 8c
» de fcience, & à répandre plus de beauté 8c
» de grandeur. Phidias, Polyclete, Scopas,
» Myron & d’autres maîtres fe rendirent cé-
» lèbres par cette réforme de l’art. Leur ftyle
» peut être appellé le grand, parce que le prin-
» cipal objet de ces artiftes paroît avoir été de
» combiner la beauté avec la grandeur. U faut
» bien diftinguer la dureté de l’auftérité, pour
» ne pas confondre deux chofes toutes diffé-
» rentes: par exemple, il ne faut pas prendre
» pour un refte de la dureté & de la feche
» refte de l’ancien ftyle , cette indication
» marquée & tranchante des fourcils qu’on
s> trouve conftammen-t dans les figures de la
» haute beauté". Ce caractère reflen i du deflln
» eft fondé fur les idées de la beauté ». '
Ce n’ eft pas cependant que le defiin du haut
ftyle n’ait affeâé de conferver , en effet •
quelques-uns des cara&ères de l’ancienne manière
qui lui prêtoient de la grandeur ; telles
font les lignes droites , tels font les méplats un
peu exagérés. C’eft: ce que Pline femble avoir
indiqué quand il parle de quarrés & d’angles.
Nous voyons de même qu,e chez les modernes
quoique de grands maîtres aient donné aux
traits des contours la plus grande do: ceur
d’autres ont cherché une forte de grandeur en
acculant certaines formes par des quarrés & I
s c U f 37
des angles plus refientis qu’ils ne font, dan»
la nature , & ont aimé à laifler dans leurs ouvrages
finis quelques-unes de ces formes tranchées
que l’ on remarque dans les ébauches des
ftatuaires. Comme les anciens maîtres qui ont
illuftré le fécond ftyle chez les Grecs, éroienc
les lëgiflateurs des proportions ,' ils auront fa-
crifié quelque choie de la beauté coulante des
formes, au plaifir de donner un caractère im-
pofant à leur defiin , 8c d’acculer forcement
les formes principales. Cette exagération de
grandeur , cette favante affeélation de ce que
les artiftes appellent fentiment , de voit imprimer
à leurs figures quelque choie qui reffem-
bloit à la dureté, quand on les comparoit aux
ouvrages de l’âge fuivanc, celui de la grâce.
Mais Winckelman obferve, avec raifon,
qu il faut fe défier du témoignage des écrivains,
parce que ces écrivains n’étoient pas
de grands connoiffeurs. Ne voyons-nous pas,
que, chez les modernes , la correftion 8c la
fermeté du* defiin- de Raphaël , qui eft bien
éloignée de la dureté, a paru dure à quelques
.écrivains qui ne connoiffoient point l’art , Sequi
comparoient la minière de ce maître à la
molleffe des chairs & aux contours arrondis
du Corrège ? Us ne s’appereevoient pas que
cette molleffe étoit quelquefois exagérée, &
que cet arrondiffemenc étoit lbuvent payé par
des incorre&ions.
Si l’on en croit Quintilien , Calon & Hégé-
fîas étoient durs & reffembloient aux Tofcans ,
Calamis fut moins dur, & Myron eut plus de
molleffe que tous ces artiftes. ( In ft. orar. 1.
i z , c. io .) Confultez enfuite Pline : vous
verrez qu’il reproche de la dureté à ce Myron,
qui , fuivant Quintilien , fe diftingua par la
molleffe. (Piin. Hift. Nat. 1. 34, c. 19 .) Mais
fi vous lifez enfuite Lucien , dans fon Dialogue
intitulé les Images, il fe trouvera que ce
Calamis qui avoir paru fi dur à Quintilien,
avoir fait la ftatue de l’Amazone Sofandra ,
l’ une des quatre figures qu’on admiroit le plus
par l’aimable expreffion de la beauté. L’air
modelle de cette Amazone, fon fourire agréable
& fu rd f , font des qualités bien oppofées
au caraitère de la dureté, qui ne peut trairer
avec luccès.que les expréfïions fières 8c terribles.
Winckelmann donne , comme les monumens
les plus confidcrables du grand fty le , Niobé
8c les filles une Pallas qu’ il ne. faut pas
confondre avec celle qu’ il a préfentée comme
un modèle du, premier ftyle , qlioiqu-’elle fe
trouve de même dans la Villa Albani. La tête
de cette figure , confervée dans fa beauté prim
i t iv e lu i femble digne des grands ftatuaires
de l’âge où elle fut faite. Elle porte le carac-
* tère de la haute beauce , & en même temps
! la forte de dureté qui défîgne le ftyle an c ien