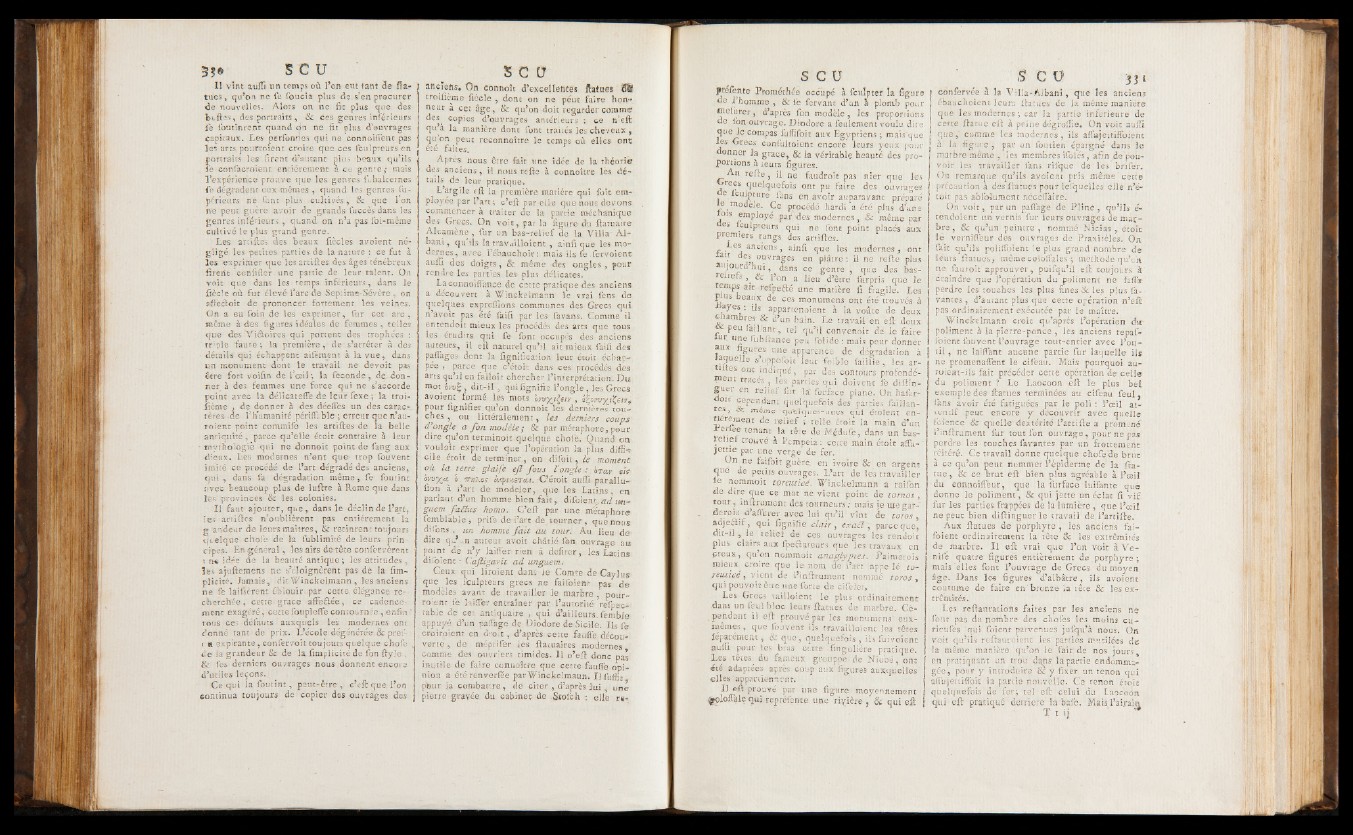
I l vînt auflî un temps où l’ on eut tant 3e fia- 1
tues, qu’on ne Ce foucia plus de.s’en procurer
de nouvelles. Alors on ne fie plus que des
bufies, des portraits , & ces genres inférieurs
le Soutinrent quand dn ne fit plus d’ouvrages
çapicaux. Les perfonnes qui ne connoifiént pas
les arts pourroient croire que ces fculpreurs en
portraits les firent d’autant plus beaux qu’ils ,
le conîacroienr. entièrement a ce genre,- mais
l ’expérience prouve que les. genres fi; bal ternes '
fê dégradent eux-mêmes , quand les genres fiu-
périetirs ne font plus cultivés, & que l’on
ne peut guère avoir de grands fuccès dans les
genres inférieurs , quand on n’a pas foi-même
cultivé le plus grand genre.
Les a r ci fies des beaux fiècles avoient négligé
les petites parties de la nature : ce fut à
les exprimer que lesartiftes des âges ténébreux
firent confifler une partie de leur talent. On
voit que dans les temps inférieurs, dans le
fiée Ve où fut élevé l’arc de Sepiime-Sévère, on
affeétoit de prononcer fortement les veines.
On a eu foin de les exprimer, fur cet a rc ,
même à des figures idéales de femmes , telles
que des Vi&oires qui portent des rrophées :
tr ’-ple faute-, la première,’ de*s’arrêter à des
détails qui échappent ai feras ht à la v u e , dans
un monument dont le travail ne devoit pas
être fort voifin de l’oeil ; la fécondé, de^donner
à des femmes une force qui ne s’accorde
point avec la délicateffe .de leur fexe ; la troi-
fièrae , de donner à des déeflés un des caractères
-de l’Kumanité périfllble ; erreur quen’au-
roient point commife les artiftes de la belle
anriquité, parce qu’elle étoit contraire à leur
mythologie qui ne donnoit point de fan g aux
dieux. Les modernes n’ont que- trop fouvent
imité ce procédé de l’ art dégradé des anciens,
qui , dans fa dégradation même, fe fourint
avec beaucoup plus de luftre à Rome que dans
les provinces & les- colonies.
Il faut ajouter, que, dans le déclin de l’art,
le? artiftes n’oublièrent pas entièrement la
g andeur de leurs maîtres, & retinrent toujours
quelque-chofe de la fublimité de leurs prin
cipes.. En-général, les airs de-tête confervèrent
i rre idée de la beauté antique ; les attitudes ,
les ajuftemens ne s’éloignèrent pas de la fim-
plicité. Jamais, ditWinckelmann , les anciens
ne fe laifsèrent éblouir par cette, élégance recherchée,
cette grâce affeélée, ce cadence*
ment exagéré, cette foupleffe contournée , enfin '
rous ces défauts auxquels les modernes ont
donné tant de prix. L’école dégénérée & pref-
< n expirante, confervoit toujcnrs quelqne chofe ,
de la grandeur & de la fimplicité de fon ftyle
& fes derniers Ouvrages nous donnent encore
d’utiles leçons.
Ce qui la foutint, peut-être , c ’eft que l ’ on
continua toujours de copier des ouvrages des
anciens. On eonnoît d’excellentes ftatues
troifieme fiècle , dont on ne peut faire honneur
a cet âge , & qu’on doit regarder comme
des^ copies d’ouvrages antérieurs : ce n’eft
qu a la manière dont font traités les cheveux ,
qu on peut reconnoître le temps où elles ont
été faîtes.
Après nous être fait une idée de la théorie
des anciens, il nous refte à connoître les détails
de leur pratique-,
L argile eft la première matière qui foit employée
par l’art; c’efi par elle que nous devons
commencer à traiter de la partie méchanique
des Grecs. On v o it, par la figure du ftatuaire
Alcamène, fur un bas-relief de la Villa* A l-
bani, qu’ ils la travailloient , ainfi que les modernes,
avec l’ébauchoir: mais ils fe fervoient
aum des doigts, & même des ongles , pour
rendre les parties les plus délicates.
Laconnoiffance de cette pratique des anciens
a découvert à Winckelmann le vrai fens de
quelques exprefiions communes des Grecs qui
n avoit pas été faifi par les favans. Comme il
entendoit mieux les procédés des arts que tous
les érudits qui fe font occupés des anciens
auteurs, il efi naturel qu’ il ait mieux faifi des
paffages donc la lignification leur étoit échappée
> parce que c’étoit dans ces procédés des
arts qu’ il en falloir chercher l’ interprétation. Du
mot bvv%, dit-il , qui fignifie l ’ongle , les Grecs
avoient forme les mots , s^owyj^siVf
pour lignifier qu’on donnoit les dernières touches
, ou littéralement, les derniers coups
d’ongle a fon modèle ; & par métaphore, pour
dire qu’on terminoit quelque chofe. Quand on
vouloir exprimer que l’opération la plus diffi*?
cile étoit déterminer., on d ifo it,7 e moment
ou lu terre glaife ejl fous l ongle r qtclv sic
ovvx& o. 'snrhoç cL<pmsTou. C’étoit aulli parallu-
iion à i’ art de modeler, que les Latins, en
parlant d’un homme bien fait, difoient.#7 im~
guem fachis homo. C’efi: par une métaphore
femblable , prile de: l’art de tourner , que nous
dilons . un homme fa it au tour. Au fieu de
dire qu? ,.n auteur avoit châtié fon ouvrage au
point dé n’y laiffer rien à defirer, les Latins
difoient -. Caftigavit ad unguem.
Ceux qui liroient dans ie Comte de Cayfiis
que les îculpteùrs grecs ne faifoient pas de
modèles avant de travailler le marbre , pourvoient
fe laiffer entraîner par l ’autorité refpec-
table de cet antiquaire , qui d’ailleurs, femble
appuyé d’un paffage de Diodore de Sicile. Us fe
croiroient en droit, d’après cette faufié découverte
, de méprifer les ftacuaires modernes
comme des ouvriers timides. Il n’eft donc pas
inutile de faire connoître que cette faulfe opinion
a etérenverfée par Winckeimaun. U fume
pbur la combattre., dé citer , d’après lui . une
pierre gravée du cabinet de $tofch : elle rspréfente
Prométhée occupé à fculpter la figure
;• l ’homme , & fe fer van t d’ un â plomb pour
mefurer, d’après fon modèle, les proportions
de fon ouvrage. Diodore a feulement voulu dire
que le compas fuffifoit aux Egyptiens ; maisTjue
ies Grecs confultoient encore leurs yeux pour
donner la grâce, & la véritable beauté des proportions
a leurs figures.
Au r e fie , il ne faudroit pas nier que les
vrecs quelquefois ont pu faire des ouvrages
ê Iculpture fans en avoir auparavant préparé
e modèle. Ce procédé hardi a été plus d’une
ois employé pajAdes modernes, & même par
e« sculpteurs qui ne font point placés aux
premiers rangs des artiftes.
es anciens, ainfi que les modernes , ont
ai5 ouvrages en plâtre : il ne refte plus
aujourd h u i, dans ce genre , que des bas-
re ie s >. ^ l’on a fieu d’être lurpris que le
temps ait refpefté une matière fi fragile. Les
p us beaux de ces monumens ont été trouvés à
ayes : ils appartenoient à la voûte de deux
chambres & d’ un bain. Le travail en efi doux
peu {’aillant, tel qu’ il conyenoit dé. le faire
Ur U^e ^kftaace peu folide : mais pour donner
aux figures une apparence de dégradation à
laquelle s’oppofoit leur foible faillie , les ar-
I es ont indiqué, par des contours profondément
tracés, les parties qui doivent fê diftin-
guer en relief fur la' furface plane. On hafar-
° 1C ^®FenA^anc quelquefois des parties faillan-
*es, & même quelques-unes qui étoient en-
ifierement de relief -, telle étoit la main d’ un
tenant J a têre de Médufe, dans un bas-
relief trouvé à Pcmpeia : cette main étoit affu-
jettie* par une verge de fer.
Omne faifoit guère, en ivoire & en argent
que de petits ouvrages. L’art de les travaillei
le nommoit toreuticé. Winckelmann a raifon
de dire que ce mot ne vient point de tornos.
tour, inftrument des tourneurs ; mais je tue gàr-
derois^ d’affurer avec lui qu’ il vînt de toros ,
adjeélif, qui fignifie clair , exa ct, parce que,
d it - il, le relief de ces ouvrages les "rendoit
plus clairs aux fpeéfateurs que les travaux en
preux, qu’on nommoit anaglyptes. l ’aimêfois
mieux croire que ie nom de l’ art appe lé to-
reuùcé, vient de l’ inftrument nommé toros,
qui pouvott être une force de cifelec,
Les Grecs taUloient le plus ordinairement
dans un feul bloc leurs ftatues de marbra. Cè-
pendant il eft prouvé par les monumrns eux-
mêmes, que fouvent ils travailloient les têtes
féparement, & q u e , quelquefois , ils fuivoient
^ufli pour ies bras cette fingulière pratique.
Les têtes du fameux grouppe de Niché j ont
été adaptées après coup aux figures auxquelles
«lies appartiennent.
II eft prouvé par une figure moyennement
^ploffgle qui repréfente une rivière , & qui eft
1 confervée à la V illa -A lb an i, que les anciens
ébauchoient leurs ftatues de la même manière
que les modernes ; car la partie inferieure de
cette ftatue eft à peine dégroilie. On voit auflî
que,' comme les modernes, ils afîujettiffoient
a la figure , par un foutien épargné dans le
marbre même , les membres ifolés, afin yle'pou-
voir les travailler fans rifque de les brifer.
On remarque qu’ ils avoient pris même cette
précaution à des ftatues pour lesquelles elle n’é-
toic pas abfoîument nécellâire.
i
On v o it , par un paffage de P lin e , qu’ils é-
tendoient un vernis fur leurs ouvrages de marbre
, & qu’ un peintre, nommé Nicias , étoit
le verniffeur des ouvrages de Praxirèles. On
fait qu’ ils poîiffoient îe plus gland nombre de
leurs ftatues, même coloffaies • méthode qu’oit
ne fauroit approuver, puifqu’ il eft toujours à
craindre que l’opération du poliment ne faff»
perdre les touches les plus fines &: les plus lavantes
, d’aurant plus que cette opération n’ eft:
pas ordinairement exécutée par le maître.
Winckelmann croit qu’après l’opération dtr
poliment à la pierre-ponce , les anciens repaf-
foient fouvent l’ouvrage tout-entier avec l’outil
, ne laiffant aucune partie fur laquelle ils
ne promenaffent le cifeau. Mais pourquoi au-
roient-ils fait précéder cette opération de celle
du poliment ? Le Laocoon eft le plus bel
exemple des ftatues terminées au cifeau feu l,
làns avoir été fatiguées par le poli : l’oeil attentif
peut encore y découvrir avec quelle
fcfence & quelle dextérité l ’artifte a promené
l’ inftrament fur tout fon ouvrage, pour ne pas
perdre les touches lavantes par un frottement
réitéré. Ce travail donne quelque chofe de brut
a ce qu’on peut nommer l’épiderme de la ftatu
e , & ce brut eft bien plus agréable à l ’oeil
du eonnoiffeur, que la furface luifante que
donne le poliment, & qui jette un éclat fi v if
fur les parties frappées de la lumière , que l’oeil
ne peut bien diftinguer le travail de i’ artifte.
Aux ftatues de porphyre , les anciens faifoient
ordinairement la tête & les extrémités
de marbre. I l eft vrai que l’on voit à V e -
nife quatre figures entièrement de porphyre ;
mais elles font l’ouvrage de Grecs du moyen
âge. Dans lé« figures d’aibâtre, ils avoient
coutume de faire en'bronze la tête & les ex-»
t-rêmi tés.
Les reftauratiohs faites par les anciens ne
font pas du nombre des choies les moins curie
ü fes qui foient parvenues jufqu’à nous. On
voit qu’ils reftauroient ies parties mutilées de
la même manière qu’on le fait'de nos jours,
en pratiquant un rrou d^ns la parrie endommagée,
pour y introduire & y fixer un tenon qui
affujettiffoit la partie nouvelle. Ce tenon étoit
quelquefois de fer; tel eft celui du Laocodn
qui eft pratiqué derrière la bafe. Mais. l’ airain
T t ij